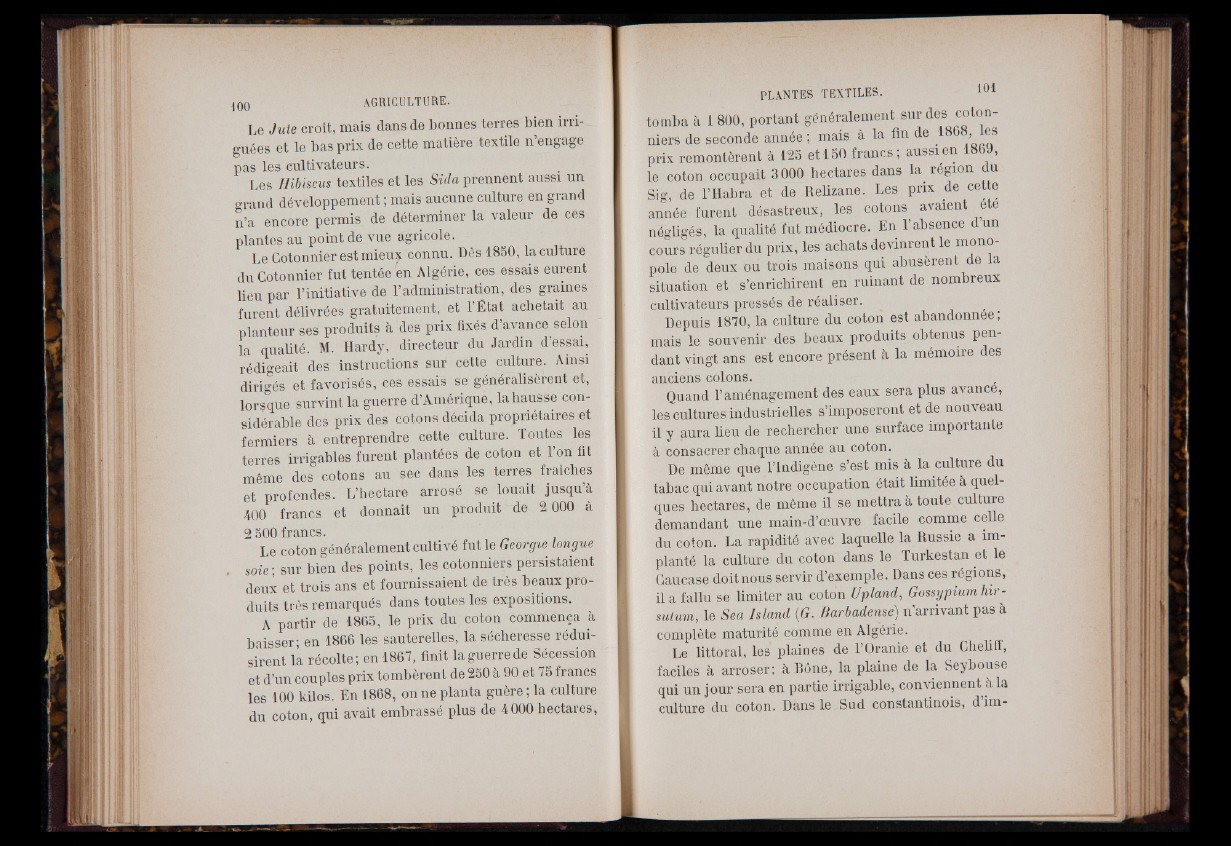
Le Jute croît, mais dans de bonnes terres bien irriguées
et le bas prix de cette matière textile n engage
pas les cultivateurs.
Les Hibiscus textiles et les Sida prennent aussi un
grand développement ; mais aucune culture en grand
n ’a encore permis de déterminer la valeur de ces
plantes au point de vue agricole.
Le Cotonnier est mieux connu. Dès 1850, la culture
du Cotonnier fut tentée en Algérie, ces essais eurent
lieu par l’initiative de l’administration, des graines
furent délivrées gratuitement, et l’État achetait au
planteur ses produits à des prix fixés d’avance selon
la qualité. M. Hardy, directeur du Jardin d’essai,
rédigeait des instructions sur cette culture. Ainsi
dirigés et favorisés, ces essais se généralisèrent et,
lorsque survint la guerre d’Amérique, la hausse considérable
des prix des cotons décida propriétaires et
fermiers à entreprendre cette culture. Toutes les
terres irrigables furent plantées de coton et l’on fit
même des cotons au sec dans les terres fraîches
et profondes. L’hectare arrosé se louait jusqu’à
400 francs et donnait un produit de 2 000 à
2 500 francs.
Le coton généralement cultivé fut le Géorgie longue
soie ; sur bien des points, les cotonniers persistaient
deux et trois ans et fournissaient de très beaux produits
très remarqués dans toutes les expositions.
A partir de 1865, le prix du coton commença à
baisser; en 1866 les sauterelles, la sécheresse réduisirent
la récolte; en 1867, finit la guerre de Sécession
et d’un couples prix tombèrent de 250 à 90 et 75 francs
les 100 kilos. En 1868, on ne planta guère ; la culture
du coton, qui avait embrassé plus de 4000 hectares,
tomba à 1 800, portant généralement sur des‘ cotonniers
de seconde année ; mais à la fin de ,. e s
prix remontèrent à 125 et 150 francs; aussi en 1869,
le coton occupait 3000 hectares dans la région du
Sig, de l’Habra et de Relizane. Les prix de cette
année furent désastreux, les cotons avaient e
négligés, la qualité fut médiocre. En l’absence d u n
cours régulier du prix, les achats devinrent le monopole
de deux ou trois maisons qui abusèrent de la
situation et s’enrichirent en ruinant de nombreux
cultivateurs pressés de réaliser.
Depuis 1870, la culture du coton est abandonnée,
mais le souvenir des beaux produits obtenus pendant
vingt ans est encore présent à la mémoire des
anciens colons.
Quand l’aménagement dés eaux sera plus avance,
les cultures industrielles s’imposeront et de nouveau
il y aura lieu de rechercher une surface importante
à consacrer chaque année au coton.
De même que l’Indigène s’est mis à la culture du
tabac qui avant notre occupation était limitée à quelques
hectares, de même il se mettra à toute culture
demandant une main-d’oeuvre facile comme celle
du coton. La rapidité avec laquelle la Russie a implanté
la culture du coton dans le Turkestan et le
Caucase doit nous servir d’exemple. Dans ces régions,
il a fallu se limiter au coton Upland, Gossypium hir-
sutum, le Sea lsland (G. Barbadense) n ’arrivant pas à
complète maturité comme en Algérie.
Le littoral, les plaines de l’Oranie et du Cheliff,
faciles à arroser; à Bône, la plaine de la Seybouse
qui un jour sera en partie irrigable, conviennent à la
culture du coton. Dans le Sud constantinois, d im -