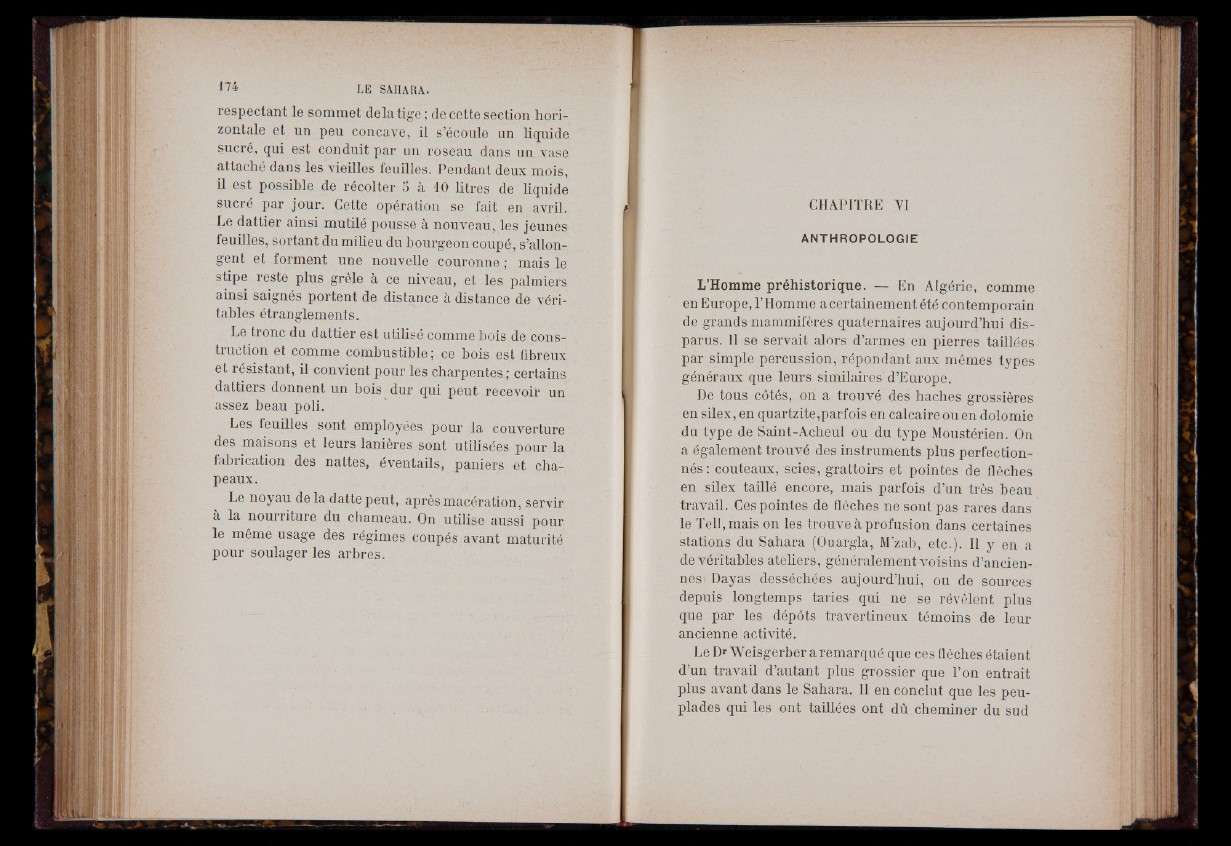
respectant le sommet de la tige ; de cette section horizontale
et un peu concave, il s’écoule un liquide
sucré, qui est conduit par un roseau dans un vase
attaché dans les vieilles feuilles. Pendant deux mois,
il est possible de récolter o à 10 litres de liquide
sucré par jour. Cette opération se fait en avril.
Le dattier ainsi mutilé pousse à nouveau, les jeunes
feuilles, sortant du milieu du bourgeon coupé, s’allongent
et forment une nouvelle couronne ; mais le
stipe reste plus grêle à ce niveau, et les palmiers
ainsi saignés portent de distance à distance de véritables
étranglements.
Le tronc du dattier est utibsé comme bois de construction
et comme combustible; ce bois est libreux
et résistant, il convient pour les charpentes ; certains
dattiers donnent un bois dur qui peut recevoir un
assez beau poli.
Les feuilles sont employées pour la couverture
des maisons et leurs lanières sont utibsées pour la
fabrication des nattes, éventails, paniers et chapeaux.
Le noyau de la datte peut, après macération, servir
à la nourriture du chameau. On utilise aussi pour
le même usage des régimes coupés avant maturité
pour soulager les arbres.
CHAPITRE VI
ANTHROPOLOGIE
L’Homme préhistorique. — En Algérie, comme
en Europe, l’Homme a certainement été contemporain
de grands mammifères quaternaires aujourd’hui disparus.
11 se servait alors d’armes en pierres taillées
par simple percussion, répondant aux mêmes types
généraux que leurs similaires d’Europe.
De tous côtés, on a trouvé des haches grossières
en silex, en quartzite,parfois en calcaire ou en dolomie
du type de Saint-Acheul ou du type Moustérien. On
a également trouvé des instruments plus perfectionnés:
couteaux, scies, grattoirs et pointes de flèches
en silex taillé encore, mais parfois d’un très beau
travail. Ces pointes de flèches ne sont pas rares dans
le Tell, mais on les trouve à profusion dans certaines
stations du Sahara (Ouargla, M’zab, etc.). Il y en a
de véritables atebers, généralement voisins d’anciennes
» Dayas desséchées aujourd’hui, ou de sources
depuis longtemps taries qui ne se révèlent plus
que par les dépôts travertineux témoins de leur
ancienne activité.
Le D«1 Weisgerber a remarqué que ces flèches étaient
d’un travail d’autant plus grossier que l ’on entrait
plus avant dans le Sahara. Il en conclut que les peuplades
qui les ont taillées ont dû cheminer du sud