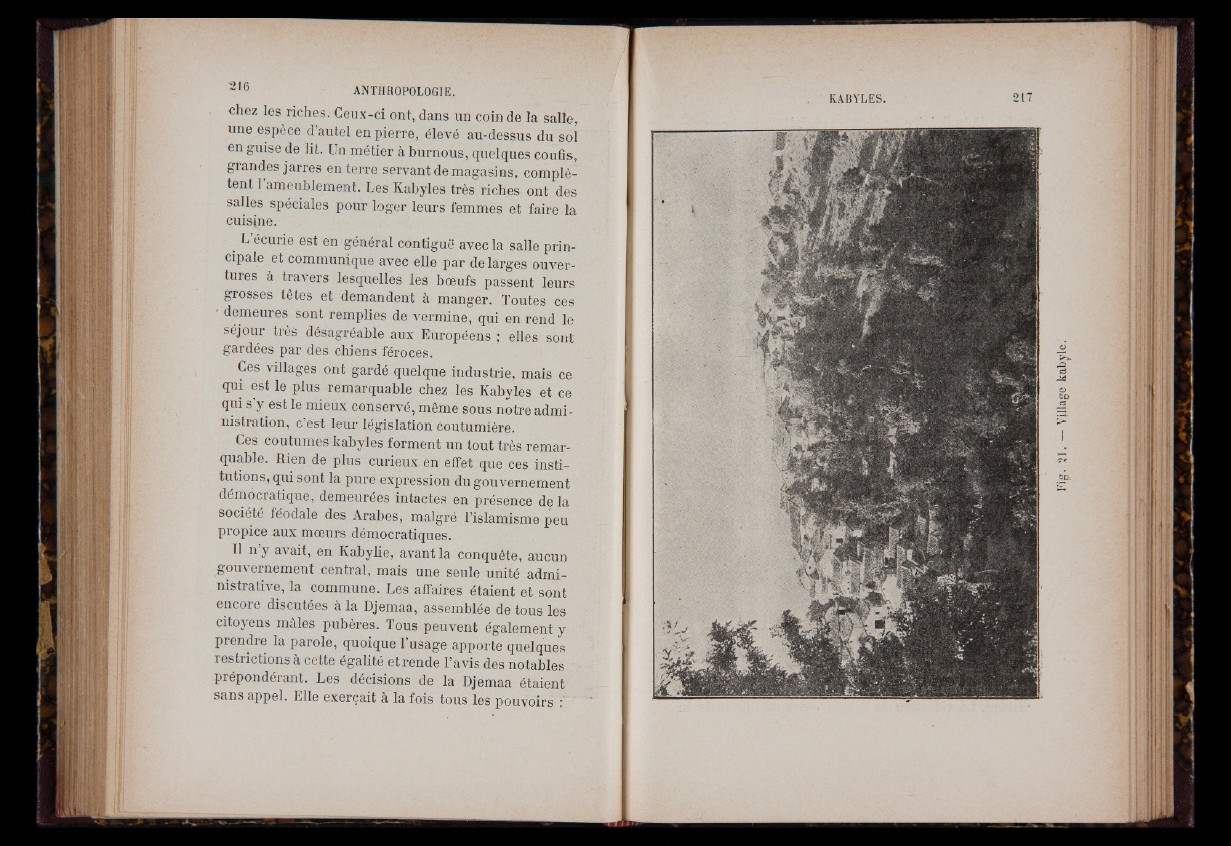
chez les riches. Ceux-ci ont, dans un coin de la salle,
une espèce d’autel en pierre, élevé au-dessus du sol
en guise de lit. Un métier à burnous, quelques couûs,
grandes jarres enterre servant de magasins, complètent
l’ameublement. Les Kabyles très riches ont des
salles spéciales pour loger leurs femmes et faire la
cuisjne.
L’écurie est en général contiguë avec la salle principale
et communique avec elle par de larges ouvertures.
à travers lesquelles les boeufs passent leurs
grosses têtes et demandent à manger. Toutes ces
' demeures sont remplies de vermine, qui en rend le
séjour très désagréable aux Européens ; elles sont
gardées par des chiens féroces.
Ces villages ont gardé quelque industrie, mais ce
qui est le plus remarquable chez les Kabyles et ce
qui s’y est le mieux conservé, même sous notre administration,
c est leur législation coutumière.
Ces coutumes kabyles forment un tout très remarquable.
Rien de plus curieux en effet que ces institutions,
qui sont la pure expression du gouvernement
démocratique, demeurées intactes en présence de la
société féodale des Arabes, malgré l’islamisme peu
propice aux moeurs démocratiques.
Il n ’y avait, en Kabyhe, avant la conquête, aucun
gouvernement central, mais une seule unité administrative,
la commune. Les affaires étaient et sont
encore discutées à la Djemaa, assemblée de tous les
citoyens mâles pubères. Tous peuvent également y
prendre la parole, quoique l’usage apporte quelques
restrictions à cette égabté et rende l ’avis des notables
prépondérant. Les décisions de la Djemaa étaient
sans appel. Elle exerçait à la fois tous les pouvoirs f