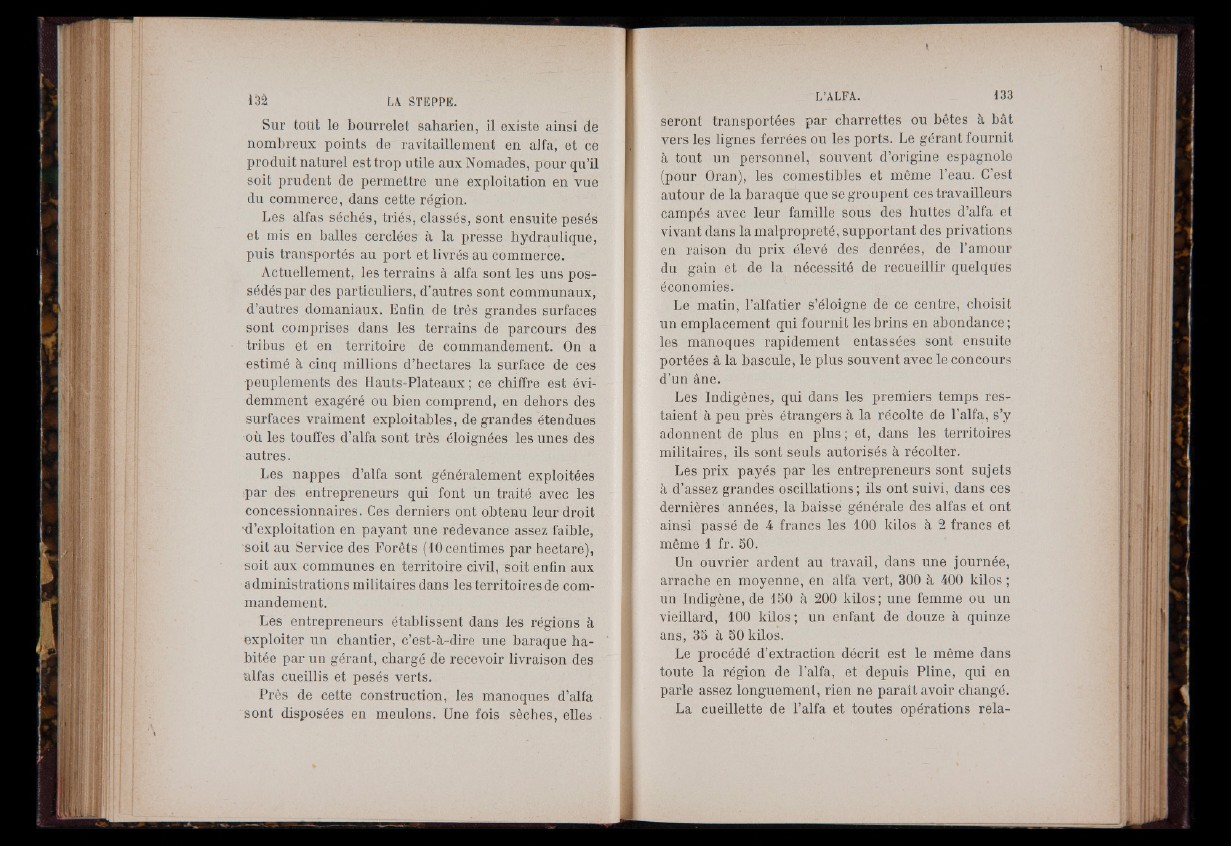
iàà l a s t e p p e .
Sur tout le bourrelet saharien, il existe ainsi de
nombreux points de ravitaillement en alfa, et ce
produit naturel est trop utile aux Nomades, pour qu’il
soit prudent de permettre une exploitation en vue
du commerce, dans cette région.
Les alfas séchés, triés, classés, sont ensuite pesés
et mis en balles cerclées à la presse hydraulique,
puis transportés au port et livrés au commerce.
Actuellement, les terrains à alfa sont les uns possédés
par des particuliers, d’autres sont communaux,
d’autres domaniaux. Enfin de très grandes surfaces
sont comprises dans les terrains de parcours des
tribus et en territoire de commandement. On a
estimé à cinq millions d’hectares la surface de ces
peuplements des Hauts-Plateaux ; ce chiffre est évidemment
exagéré ou bien comprend, en dehors des
surfaces vraiment exploitables, de grandes étendues
où les touffes d’alfa sont très éloignées les unes des
autres.
Les nappes d’alfa sont généralement exploitées
>par des entrepreneurs qui font un traité avec les
concessionnaires. Ces derniers ont obtenu leur droit
'd’exploitation en payant une redevance assez faible,
soit au Service des Forêts (10 centimes par hectare),
soit aux communes en territoire civil, soit enfin aux
administrations militaires dans les territoires de commandement.
Les entrepreneurs établissent dans les régions à
■(exploiter un chantier, c’est-à-dire une baraque habitée
par un gérant, chargé de recevoir livraison des
alfas cueillis et pesés verts.
Près de cette construction, les manoques d’alfa
sont disposées en meulons. Une fois sèches, elles
L’ALFA. 133
seront transportées par charrettes ou bêtes à bât
vers les lignes ferrées ou les ports. Le gérant fournit
à tout un personnel, souvent d’origine espagnole
(pour Oran), les comestibles et même l’eau. C’est
autour de la baraque que se groupent ces travailleurs
campés avec leur famille sous des huttes d’alfa et
vivant dans la malpropreté, supportant des privations
en raison du prix élevé des denrées, de l’amour
du gain et de la nécessité de recueillir quelques
économies.
Le matin, l’alfatier s’éloigne de ce centre, choisit
un emplacement qui fournit les brins en abondance;
les manoques rapidement entassées sont ensuite
portées à la bascule, le plus souvent avec le concours
d’un âne.
Les Indigènes, qui dans les premiers temps restaient
à peu près étrangers à la récolte de l’alfa, s’y
adonnent de plus en plus ; et, dans les territoires
militaires, ils sont seuls autorisés à récolter.
Les prix payés par les entrepreneurs sont sujets
à d’assez grandes oscillations; ils ont suivi, dans ces
dernières années, la baisse générale des alfas et ont
ainsi passé de 4 francs les 100 kilos à 2 francs et
même 1 fr. 50.
Un ouvrier ardent au travail, dans une journée,
arrache en moyenne, en alfa vert, 300 à 400 kilos ;
un Indigène, de 150 à 200 kilos; une femme ou un
vieillard, 100 kilos; un enfant de douze à quinze
ans, 35 à 50 kilos.
Le procédé d’extraction décrit est le même dans
toute la région de l ’alfa, et depuis Pline, qui en
parle assez longuement, rien ne paraît avoir changé.
La cueillette de l’alfa et toutes opérations rela