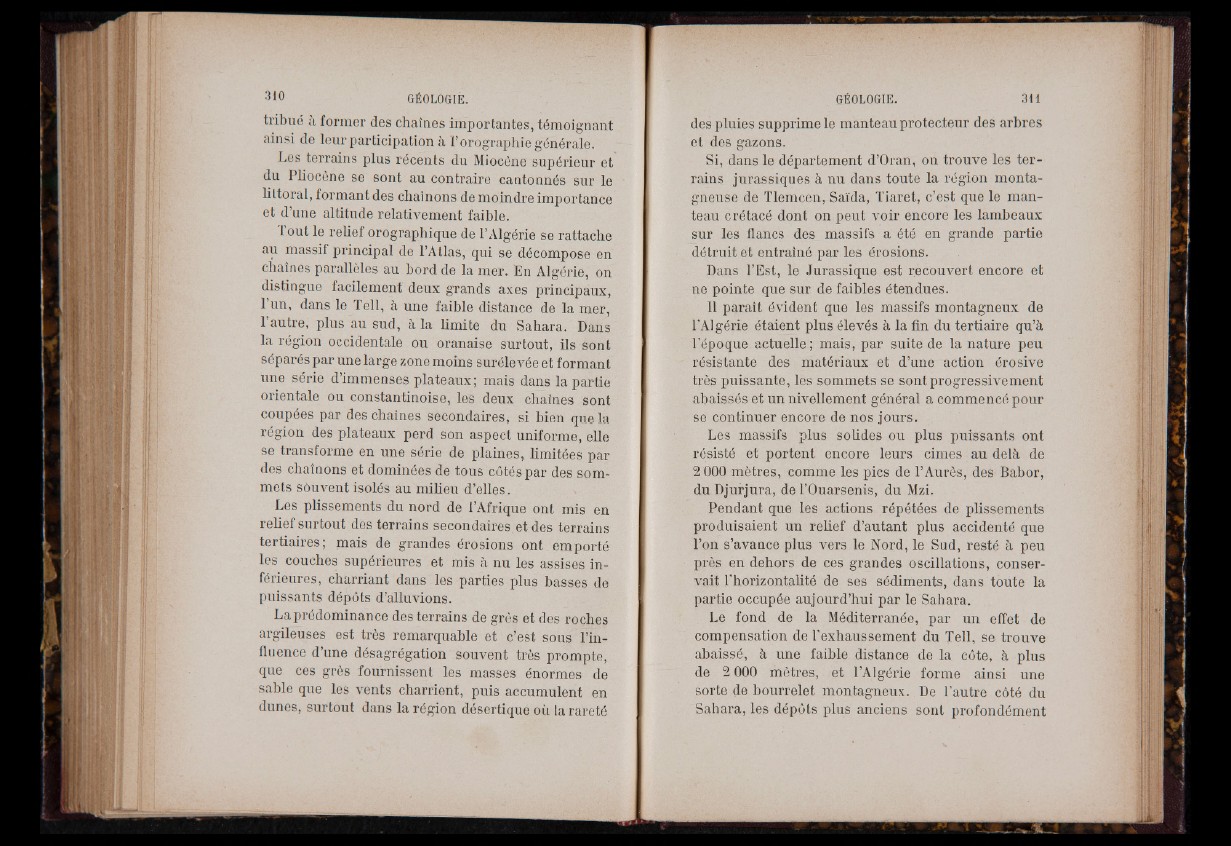
tribué à former des chaînes importantes, témoignant
ainsi de leur participation à l’orographie générale.
Les terrains plus récents du Miocène supérieur et
du Pliocène se sont au contraire cantonnés sur le
littoral, formant des chaînons de moindre importance
et d’une altitude relativement faible.
Tout le relief orographique de l’Algérie se rattache
au massif principal de l’Atlas, qui se décompose en
chaînes parallèles au bord de la mer. En Algérie, on
distingue facilement deux grands axes principaux,
l’un, dans le Tell, à une faible distance de la mer,
l’autre, plus au sud, à la limite du Sahara. Dans
la région occidentale ou oranaise surtout, ils sont
séparés par une large zone moins surélevée et formant
une série d’immenses plateaux; mais dans la partie
orientale ou constantinoise, les deux chaînes sont
coupées par des chaînes secondaires, si bien que la
région des plateaux perd son aspect uniforme, elle
se transforme en une série de plaines, limitées par
des chaînons et dominées de tous côtés par des sommets
souvent isolés au milieu d’elles.
Les plissements du nord de l’Afrique ont mis en
relief surtout des terrains secondaires et des terrains
tertiaires; mais de grandes érosions ont emporté
les couches supérieures et mis à nu les assises inférieures,
charriant dans les parties plus basses de
puissants dépôts d’alluvions.
La prédominance des terrains de grès et des roches
argileuses est très remarquable et c’est sous l ’influence
d’une désagrégation souvent très prompte,
que ces grès fournissent les masses énormes de
sable que les vents charrient, puis accumulent en
dunes, surtout dans la région désertique où la rareté
des pluies supprime le manteau protecteur des arbres
et des gazons.
Si, dans le département d’Oran, on trouve les te rrains
jurassiques à nu dans toute la région montagneuse
de Tlemcen, Saïda, Tiaret, c’est que le manteau
crétacé dont on peut voir encore les lambeaux
sur les flancs des massifs a été en grande partie
détruit et entraîné par les érosions.
Dans l’Est, le Jurassique est recouvert encore et
ne pointe que sur de faibles étendues.
Il paraît évident que les massifs montagneux de
l'Algérie étaient plus élevés à la fin du tertiaire qu’à
l ’époque actuelle; mais, par suite de la nature peu
résistante des matériaux et d’une action érosive
très puissante, les sommets se sont progressivement
abaissés et un nivellement général a commencé pour
se continuer encore de nos jours.
Les massifs plus solides ou plus puissants ont
résisté et portent encore leurs cimes au delà de
2 000 mètres, comme les pics de l’Aurès, des Babor,
du Djurjura, de l’Ouarsenis, du Mzi.
Pendant que les actions répétées de plissements
produisaient un relief d’autant plus accidenté que
l’on s’avance plus vers le Nord, le Sud, resté à peu
près en dehors de ces grandes oscillations, conservait
l'horizontalité de ses sédiments, dans toute la
partie occupée aujourd’hui par le Sahara.
Le fond de la Méditerranée, par un effet de
compensation de l’exhaussement du Tell, se trouve
abaissé, à une faible distance de la côte, à plus
de 2 000 mètres, et l’Algérie forme ainsi une
sorte de bourrelet montagneux. De l’autre côté du
Sahara, les dépôts plus anciens sont profondément