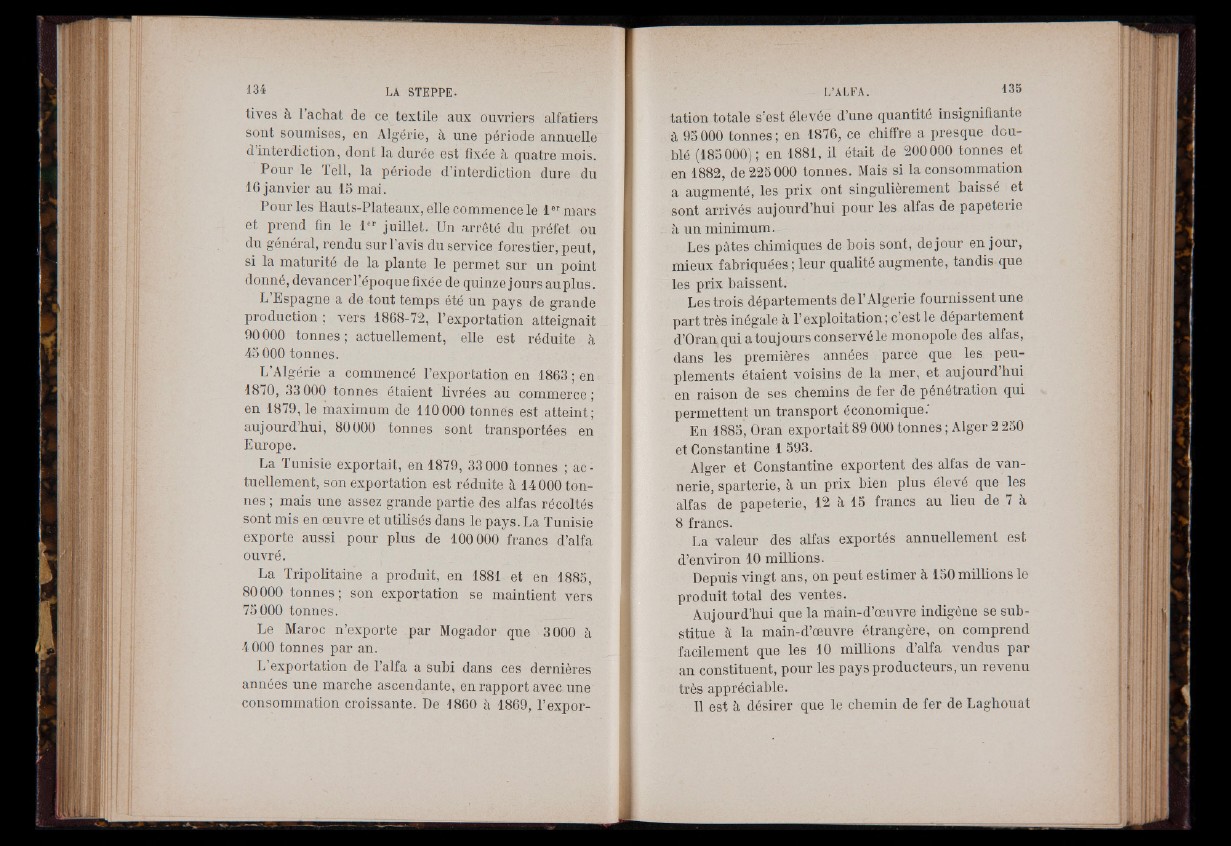
tives à 1 achat de ce textile aux ouvriers alfatiers
sont soumises, en Algérie, à une période annuelle
d’interdiction, dont la durée est fixée à quatre mois.
Pour le Tell, la période d’interdiction dure du
16 janvier au 15 mai.
Pour les Hauts-Plateaux, elle commence le 1er mars
et prend fin le 1er juillet. Un arrêté du préfet ou
du général, rendu sur l’avis du service forestier, peut,
si la maturité de la plante le permet sur un point
donné, devancer l’époque fixée de quinze jours au plus.
L’Espagne a de tout temps été un pays de grande
production ; vers 1868-72, l’exportation atteignait
90000 tonnes; actuellement, elle est réduite à
45 000 tonnes.
L’Algérie a commencé l’exportation en 1863 ; en
1870, 33 000 tonnes étaient livrées au commerce;
en 1879, le maximum de 110000 tonnes est atteint;
aujourd’hui, 80000 tonnes sont transportées en
Europe.
La Tunisie exportait, en 1879, 33000 tonnes ; a c tuellement,
son exportation est réduite à 14 000 tonnes
; mais une assez grande partie des alfas récoltés
sont mis en oeuvre et utilisés dans le pays. La Tunisie
exporte aussi pour plus de 100000 francs d’alfa
ouvré.
La Tripolitaine a produit, en 1881 et en 1885,
80000 tonnes; son exportation se maintient vers
75000 tonnes.
Le Maroc n ’exporte par Mogador que 3000 à
4 000 tonnes par an.
L’exportation de l’alfa a subi dans ces dernières
années une marche ascendante, en rapport avec une
consommation croissante. De 4860 à 1869, l’exportation
totale s’est élevée d’une quantité insignifiante
à 95000 tonnes; en 1876, ce chiffre a presque doublé
(185000); en 1881, il était de 200000 tonnes et
en 1882, de 225 000 tonnes. Mais si la consommation
a augmenté, les prix ont singulièrement baissé et
sont arrivés aujourd’hui pour les alfas de papeterie
à un minimum.
Les pâtes chimiques de bois sont, de jour en jour,
mieux fabriquées ; leur qualité augmente, tandis que
les prix baissent.
Les trois départements de l’Algérie fournissent une
part très inégale à l’exploitation ; c’est le département
d’Oran, qui a touj ours conservé le monopole des alfas,
dans les premières années parce que les peuplements
étaient voisins de la mer, et aujourd’hui
en raison de ses chemins de fer de pénétration qui
permettent un transport économique.'
En 1885* Oran exportait 89 000 tonnes ; Alger 2 250
et Constantine 1 593.
Alger et Constantine exportent des alfas de vannerie,
sparterie, à un prix bien plus élevé que les
alfas de papeterie, 12 à 15 francs au heu de 7 à
8 francs.
La valeur des alfas exportés annuellement est
d’environ 10 millions.
Depuis vingt ans, on peut estimer à 150 millions le
produit total des ventes.
Aujourd’hui que la main-d’oeuvre indigène se substitue
à la main-d’oeuvre étrangère, on comprend
facilement que les 10 millions d’alfa vendus par
an constituent, pour les pays producteurs, un revenu
très appréciable.
Il est à désirer que le chemin de fer de Laghouat