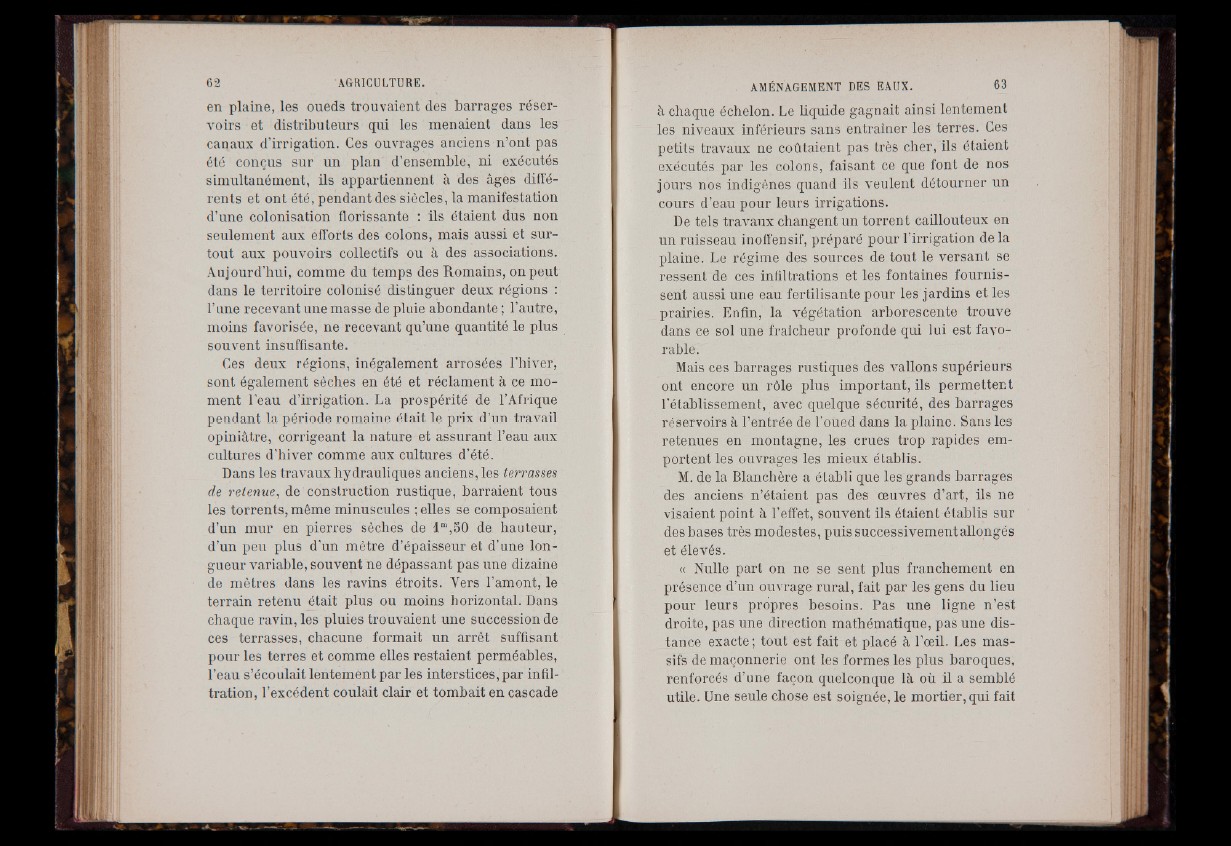
en plaine, les oueds trouvaient des barrages réservoirs
et distributeurs qui les menaient dans les
canaux d’irrigation. Ces ouvrages anciens n ’ont pas
été conçus sur un plan d’ensemble, ni exécutés
simultanément, ils appartiennent à des âges différents
et ont été, pendant des siècles, la manifestation
d’une colonisation florissante : ils étaient dus non
seulement aux efforts des colons, mais aussi et surtout
aux pouvoirs collectifs ou à des associations.
Aujourd’hui, comme du temps des Romains, on peut
dans le territoire colonisé distinguer deux régions :
l’une recevant une masse de pluie abondante ; l’autre,
moins favorisée, ne recevant qu’une quantité le plus
souvent insuffisante.
Ces deux régions, inégalement arrosées l’hiver,
sont également sèches en été et réclament à ce moment
l’eau d’irrigation. La prospérité de l’Afrique
pendant la période romaine était le prix d’un travail
opiniâtre, corrigeant la nature et assurant l’eau aux
cultures d’hiver comme aux cultures d’été.
Dans les travaux hydrauliques anciens, les terrasses
de retenue, de construction rustique, barraient tous
les torrents, même minuscules ; elles se composaient
d’un mur en pierres sèches de 1“ ,50 de hauteur,
d’un peu plus d’un mètre d’épaisseur et d’une longueur
variable, souvent ne dépassant pas une dizaine
de mètres dans les ravins étroits. Yers l’amont, le
terrain retenu était plus ou moins horizontal. Dans
chaque ravin, les pluies trouvaient une succession de
ces terrasses, chacune formait un arrêt suffisant
pour les terres et comme elles restaient perméables,
l’eau s’écoulait lentement par les interstices, par infiltration,
l’excédent coulait clair et tombait en cascade
à chaque échelon. Le liquide gagnait ainsi lentement
les niveaux inférieurs sans entraîner les terres. Ces
petits travaux ne coûtaient pas très cher, ils étaient
exécutés par les colons, faisant ce que font de nos
jours nos indigènes quand ils veulent détourner un
cours d’eau pour leurs irrigations.
De tels travaux changent un torrent caillouteux en
un ruisseau inoffensif, préparé pour l’irrigation de la
plaine. Le régime des sources de tout le versant se
ressent de ces infiltrations et les fontaines fournissent
aussi une eau fertilisante pour les jardins et les
prairies. Enfin, la végétation arborescente trouve
dans ce sol une fraîcheur profonde qui lui est favorable.
Mais ces barrages rustiques des vallons supérieurs
ont encore un rôle plus important, ils permettent
l’établissement, avec quelque sécurité, des barrages
réservoirs à l’entrée de l’oued dans la plaine. Sans les
retenues en montagne, les crues trop rapides emportent
les ouvrages les mieux établis.
M. de la Blanchère a établi que les grands barrages
des anciens n ’étaient pas des oeuvres d’art, ils ne
visaient point à l’effet, souvent ils étaient établis sur
des bases très modestes, puis successivement allongés
et élevés.
« Nulle part on ne se sent plus franchement en
présence d’un ouvrage rural, fait par les gens du lieu
pour leurs propres besoins. Pas une ligne n ’est
droite, pas une direction mathématique, pas une distance
exacte ; tout est fait et placé à l’oeil. Les massifs
de maçonnerie ont les formes les plus baroques,
renforcés d’une façon quelconque là où il a semblé
utile. Une seule chose est soignée, le mortier, qui fait