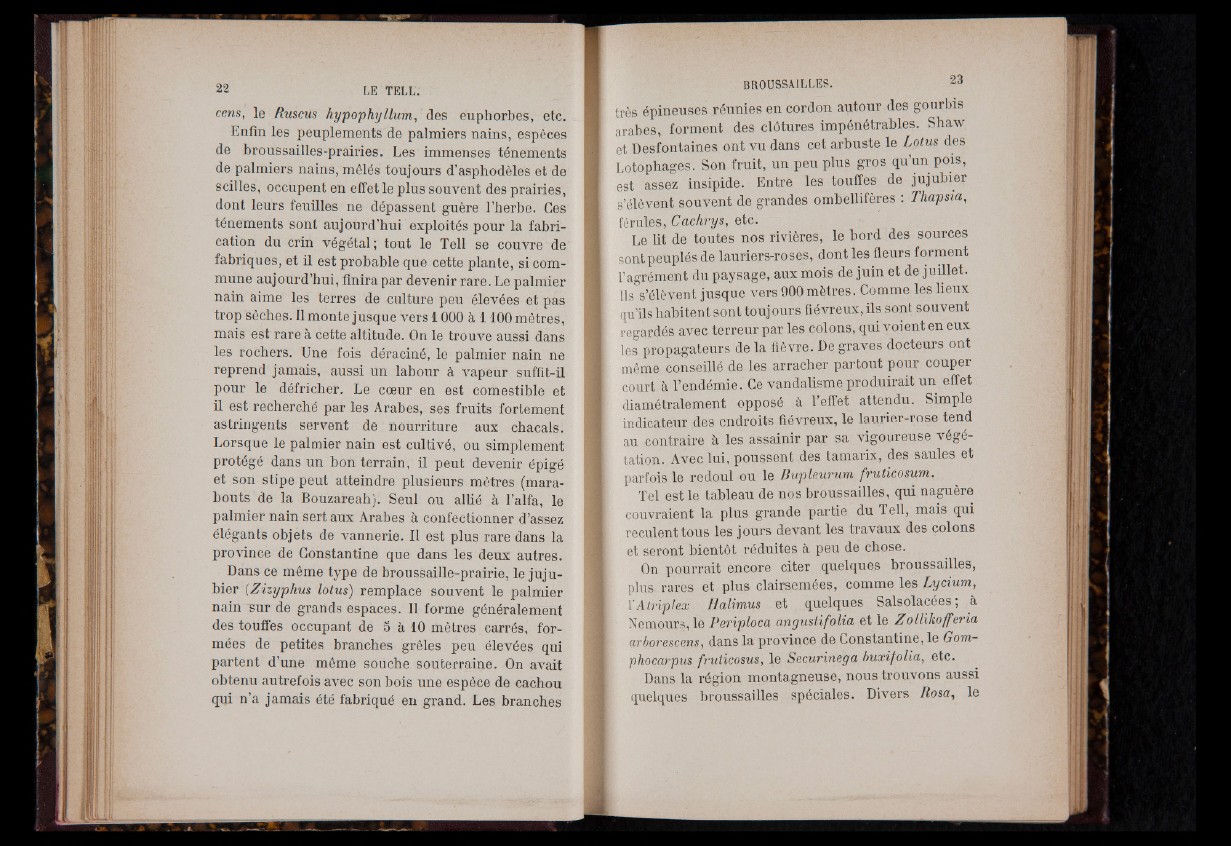
cens, le Ruscus hypophyllum, des euphorbes, etc.
Enfin les peuplements de palmiers nains, espèces
de broussailles-prairies. Les immenses ténements
de palmiers nains, mêlés toujours d’asphodèles et de
scilles, occupent en effet le plus souvent des prairies,
dont leurs feuilles ne dépassent guère l'herbe. Ces
ténements sont aujourd’hui exploités pour la fabrication
du crin végétal; tout le Tell se couvre de
fabriques, et il est probable que cette plante, si commune
aujourd’hui, finira par devenir rare. Le palmier
nain aime les terres de culture peu élevées et pas
trop sèches. Il monte jusque vers 1000 à 1100 mètres,
mais est rare à cette altitude. On le trouve aussi dans
les rochers. Une fois déraciné, le palmier nain ne
reprend jamais, aussi un labour à vapeur suffit-il
pour le défricher. Le coeur en est comestible et
il est recherché par les Arabes, ses fruits fortement
astringents servent de nourriture aux chacals.
Lorsque le palmier nain est cultivé, ou simplement
protégé dans un bon terrain, il peut devenir épigé
et son stipe peut atteindre plusieurs mètres (marabouts
de la Bouzareah). Seul ou allié à l’alfa, le
palmier nain sert aux Arabes à confectionner d’assez
élégants objets de vannerie. Il est plus rare dans la
province de Constantine que dans les deux autres.
Dans ce même type de broussaille-prairie, le ju ju bier
(Zizyphus lotus) remplace souvent le palmier
nain sur de grands espaces. Il forme généralement
des touffes occupant de S à 10 mètres carrés, formées
de petites branches grêles peu élevées qui
partent d’une même souche souterraine. On avait
obtenu autrefois avec son bois une espèce de cachou
qui n’a jamais été fabriqué en grand. Les branches
très épineuses réunies en cordon autour des gourbis
arabes, forment des clôtures impénétrables. Shaw
et Besfontaines ont vu dans cet arbuste le Lotus des
Lotophages. Son fruit, un peu plus gros qu’un pois,
est assez insipide. Entre les touffes de jujubier
s’élèvent souvent de grandes ombellifères : Thapsia,
férules, Cachrys, etc.
Le lit de toutes nos rivières, le bord des sources
sont peuplés de lauriers-roses, dont les fleurs forment
l’agrément du paysage, aux mois de juin et de juillet.
Ils s’élèvent jusque vers 900 mètres. Comme les lieux
qu’ils habitent sont toujours fiévreux, ils sont souvent
regardés avec terreur par les colons, qui voient en eux
les propagateurs de la fièvre. De graves docteurs ont
même conseillé de les arracher partout pour couper
court à l’endémie. Ce vandalisme produirait un effet
diamétralement opposé à 1 effet attendu. Simple
indicateur des endroits fiévreux, le laurier-rose tend
au contraire à les assainir par sa vigoureuse végétation.
Avec lui, poussent des tamarix, des saules et
parfois le redoul ou le Bupleurum fruticosum.
Tel est le tableau de nos broussailles, qui naguère
couvraient la plus grande partie du Tell, mais qui
reculent tous les jours devant les travaux des colons
et seront bientôt réduites à peu de chose.
On pourrait encore citer quelques broussailles,
plus rares et plus clairsemées, comme les Lycium,
YAtriplex Halimus et quelques Salsolacées ; à,
Nemours, le Periploca angusûfolia et le Zollikofferia
arborescens, dans la province de Lonstantine, le Gom-
phocarpus fruticosus, le Securinega buxifolia, etc.
Dans la région montagneuse, nous trouvons aussi
quelques broussailles spéciales. Divers Rosa, le