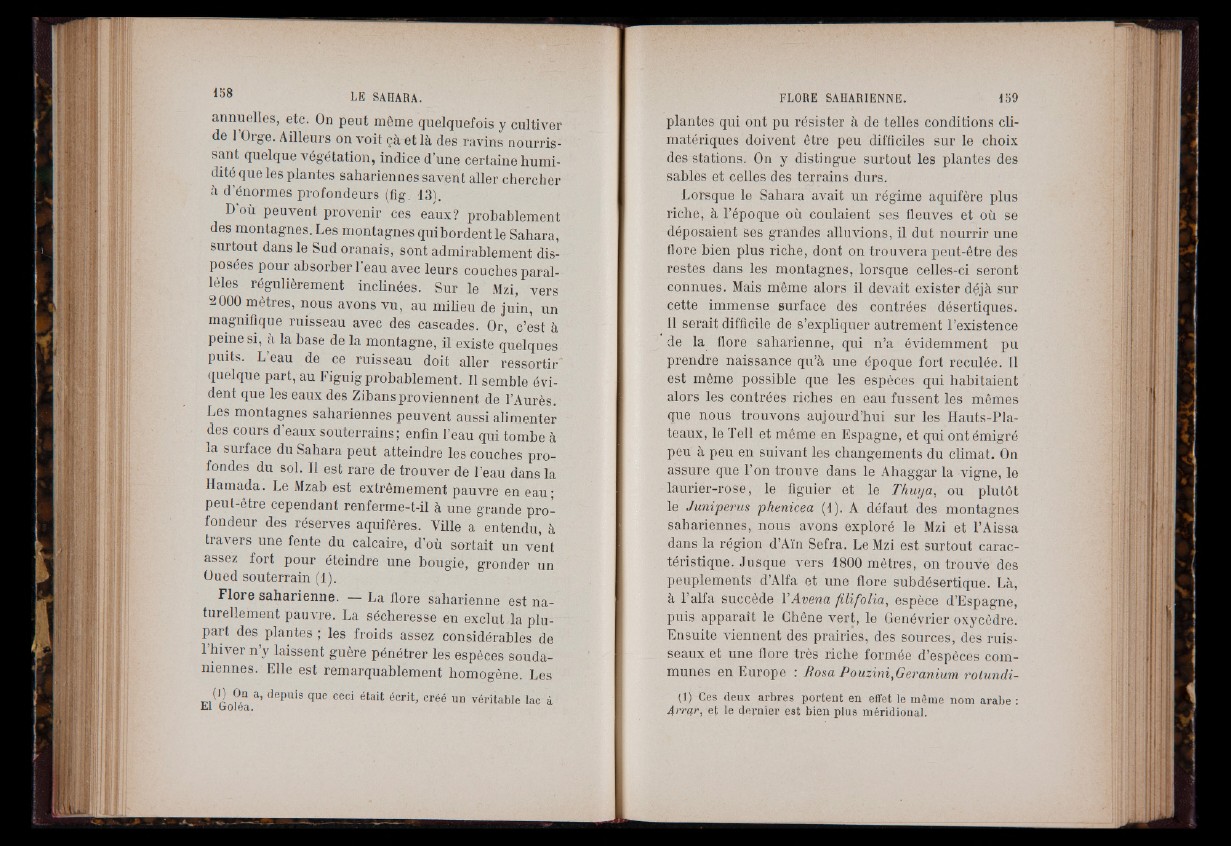
annuelles, etc. On peut môme quelquefois y cultiver
de 1 Orge. Ailleurs on voit çà et là des ravins nourrissant
quelque végétation, indice d une certaine humidité
que les plantes sahariennes savent aller chercher
à d’énormes profondeurs (fig. 13).
D où peuvent provenir ces eaux? probablement
des montagnes. Les montagnes quibordentle Sahara,
surtout dans le Sud oranais, sont admirablement disposées
pour absorber l’eau avec leurs couches parallèles
régulièrement inclinées. Sur le Mzi, vers
2000 mètres, nous avons vu, au milieu de juin, un
magnifique ruisseau avec des cascades. Or, c’est à
peine si, à la base de la montagne, il existe quelques
puits. L’eau de ce ruisseau doit aller ressortir'
quelque part, au Figuig probablement. Il semble évident
que les eaux des Zibans proviennent de l’Aurès.
Les montagnes sahariennes peuvent aussi abmenter
des cours d’eaux souterrains ; enfin l’eau qui tombe à
ia surface du Sahara peut atteindre les couches profondes
du sol. Il est rare de trouver de l’eau dans la
Hamada. Le Mzab est extrêmement pauvre en eau;
peut-être cependant renferme-t-il à une grande profondeur
des réserves aquifères. Ville a entendu, à
travers une fente du calcaire, d’où sortait un vent
assez fort pour éteindre une bougie, gronder un
Oued souterrain (1).
Flore saharienne. — La flore saharienne est naturellement
pauvre. La sécheresse en exclut la plupart
des plantes ; les froids assez considérables de
l ’hiver n ’y laissent guère pénétrer les espèces souda-
niennes. Elle est remarquablement homogène. Les
(I) On a, depuis que.ceci était écrit, créé un véritable lac à
.tl bolea.
plantes qui ont pu résister à de telles conditions cli-
matériques doivent être peu difficiles sur le choix
des stations. On y distingue surtout les plantes des
sablés et celles des terrains durs.
Lorsque le Sahara avait un régime aquifère plus
riche, à l’époque où coulaient ses fleuves et où se
déposaient ses grandes alluvions, il dut nourrir une
flore bien plus riche, dont on trouvera peut-être des
restes dans les montagnes, lorsque celles-ci seront
connues. Mais même alors il devait exister déjà sur
cette immense surface des contrées désertiques.
Il serait difficile de s’expliquer autrement l ’existence
de la flore saharienne, qui n ’a évidemment pu
prendre naissance qu’à une époque fort reculée. Il
est même possible que les espèces qui habitaient
alors les contrées riches en eau fussent les mêmes
que nous trouvons aujourd’hui sur les Hauts-Pla-
teaux, le Tell et même en Espagne, et qui ont émigré
peu à peu en suivant les changements du climat. On
assure que l’on trouve dans le Ahaggar la vigne, le
laurier-rose, le figuier et le Thuya, ou plutôt
le Juniperus phenicea (1). A défaut des montagnes
sahariennes, nous avons exploré le Mzi et l’Aissa
dans la région d’Ain Sefra. Le Mzi est surtout caractéristique.
Jusque vers 1800 mètres, on trouve des
peuplements d’Alfa et une flore subdésertique. Là,
à 1 alfa succède YAvena filifolia, espèce d’Espagne,
puis apparaît le Chêne vert, le Genévrier oxycèdre.
Ensuite viennent des prairies, des sources, des ruisseaux
et une flore très riche formée d’espèces communes
en Europe : Bosa Pouzini,Géranium rotundi-
(1) Ces deux arbres portent en effet le même nom arabe :
4 m?r, et le dernier est bien plus méridional.