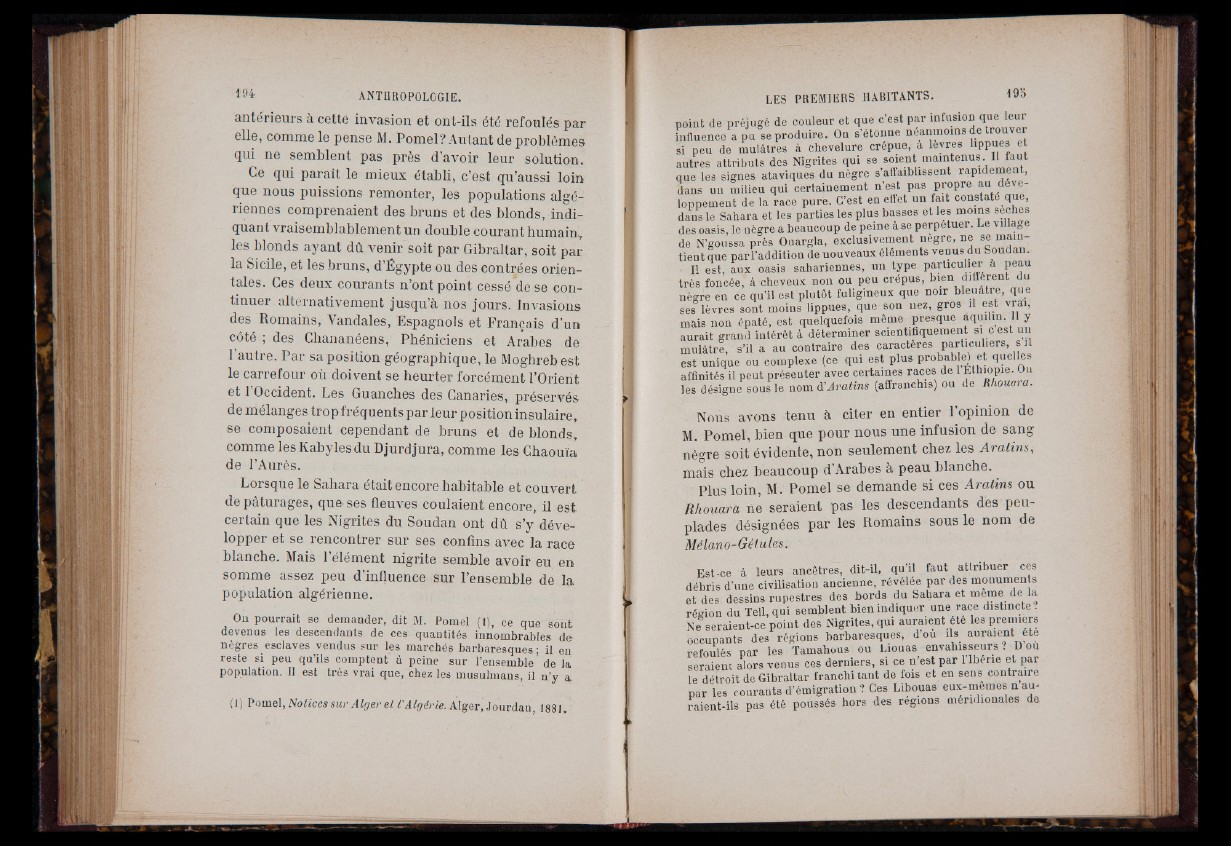
antérieurs à cette invasion et ont-ils été refoulés par
elle, comme le pense M. Pomel? Autant de problèmes
qui ne semblent pas près d’avoir leur solution.
Ce qui paraît le mieux établi, c’est qu’aussi loin
que nous puissions remonter, les populations algériennes
comprenaient des bruns et des blonds, indiquant
vraisemblablement un double courant humain,
les blonds ayant dû venir soit par Gibraltar, soit par
la Sicile, et les bruns, d’Égypte ou des contrées orientales.
Ces deux courants n ’ont point cessé de se continuer
alternativement jusqu’à nos jours. Invasions
des Romains, Vandales, Espagnols et Français d’un
côté ; des Chananéens, Phéniciens et Arabes de
1 autre. Par sa position géographique, le Moghrebest
le carrefour où doivent se heurter forcément l’Orient
et l’Occident. Les Guanches des Canaries, préservés
de mélanges tropfréquents par leur position insulaire,
se composaient cependant de bruns et de blonds,
comme les Kabyles du Djurdjura, comme les Chaouïa
de l’Aurès.
Lorsque le Sahara était encore habitable et couvert
de pâturages, que ses fleuves coulaient encore, il est
certain que les Nigrites du Soudan ont dû s’y développer
et se rencontrer sur ses confins avec la race
blanche. Mais l’élément nigrite semble avoir eu en
somme assez peu d’influence sur l’ensemble de la
population algérienne.
On pourrait se demander, dit M. Pomel (1), ce que sont
devenus les descendants de ces? quantités innombrables de
nègres esclaves vendus sur les marchés barbaresques ; il en
reste si peu qu’ils comptent à peine sur l’ensemble’ de la
population. Il est très vrai que, chez les musulmans, il n’y a
(1) Pomel, Notices suc Alger et t Algérie. Alger, Jourdan, 188 L
point de préjugé de couleur et que c’est par infusion que leur
influence a pu se produire. On s’étonne néanmoins de trouver
si peu de mulâtres à chevelure crépue, a levres lippues et
autres attributs des Nigrites qui se soient maintenus. Il faut
que les signes ataviques du nègre s’affaiblissent rapidement,
dans un milieu qui certainement n’est pas propre au développement
de la race pure. C’est en effet un fait constaté que,
dans le Sahara et les parties les plus basses et les moins sèches
des oasis, le uègre a beaucoup de peine à se perpétuer. Le villaDe
de N’goussa près Ouargla, exclusivement nègre, ne se maintient
que par l’addition de nouveaux éléments venus du Soudan.
Il est, aux oasis sahariennes, un type particulier à peau
très foncée, à cheveux non ou peu crépus, bien différent du
nègre en ce qu’il est plutôt fuligineux que noir bleuâtre, que
ses lèvres sont moins lippues, que son nez, gros il est vrai,
mais non épaté, est quelquefois même presque aquilin 11 y
aurait grand intérêt à déterminer scientifiquement si c est un
mulâtre, s’il a au contraire des caractères particuliers, s il
est unique ou complexe (ce qui est plus probable) et quelles
affinités il peut présenter avec certaines races de 1 Ethiopie. Ou
les désigne sous le nom d'Aratins (affranchis) ou de Rliouara.
Nous avons tenu à citer en entier l’opinion de
M. Pomel, bien que pour nous une infusion de sang
nègre soit évidente, non seulement chez les Aralins,
mais chez beaucoup d’Arabes à peau blanche.
Plus loin, M. Pomel se demande si ces Aratins ou
Rhouara ne seraient pas les descendants des peuplades
désignées par les Romains sous le nom de
Mélano-Gétules.
Est-ce à leurs ancêtres, dit-il, qu’il faut attribuer ces
débris d’une civilisation ancienne, révélée par des monuments
et des dessins rupestres des bords du Sahara et meme de la
région du Tell, qui semblent bien indiquer une race distincte.
N e seraient-ce point des Nigrites, qui auraient été les premiers
occupants des régions barbaresques, d’ou ils auraient été
refoulés par les Tamahous ou Liouas envahisseurs ? D ou reraient I f s venus ces derniers, si ce n’est par l’ibéne et par
le détroit de Gibraltar franchi tant de fois et en sens contraire
par les courants d’émigration? Ces Libouas eux-memes n auraient
ils pas été poussés hors des régions méridionales de