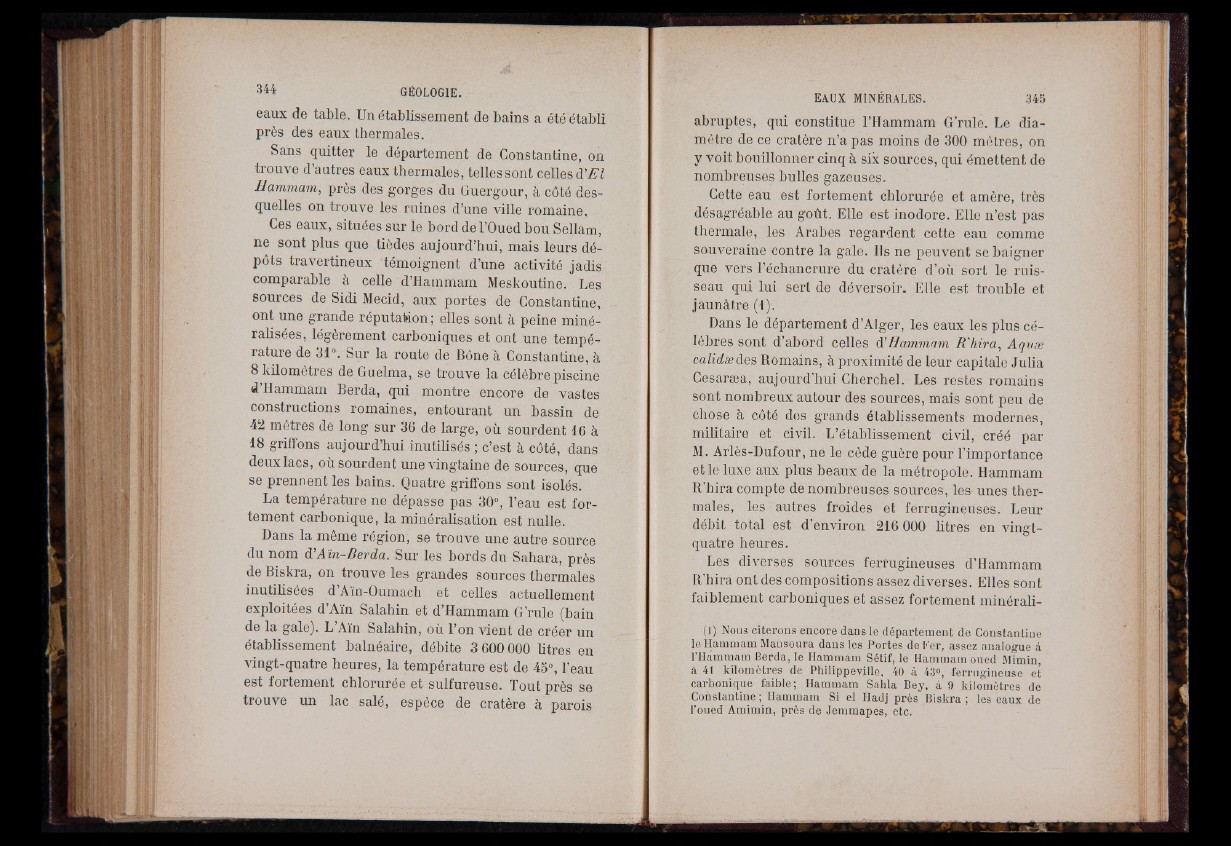
eaux de table. Un établissement de bains a été établi
près des eaux thermales.
Sans quitter le département de Constantine, on
trouve d’autres eaux thermales, telles sont celles à'El
Hammam, près des gorges du Guergour, à côté desquelles
on trouve les ruines d’une ville romaine.
Ces eaux, situées sur le bord de l’Oued bou Sellam,
ne sont plus que tièdes aujourd’hui, mais leurs dépôts
travertineux témoignent d’une activité jadis
comparable à celle d’Hammam Meskoutine. Les
sources de Sidi Mecid, aux portes de Constantine,
ont une grande réputation; elles sont à peine minéralisées,
légèrement carboniques et ont une température
de 31°. Sur la route de Bône à Constantine, à
8 kilomètres de Guelma, se trouve la célèbre piscine
d Hammam Berda, qui montre encore de vastes
constructions romaines, entourant un bassin de
42 mètres de long sur 36 de large, où sourdent 16 à
18 griffons aujourd’hui inutilisés ; c’est à côté, dans
deuxlacs, où sourdent une vingtaine de sources, que
se prennent les bains. Quatre griffons sont isolés.
La température ne dépasse pas 30°, l’eau est fortement
carbonique, la minéralisation est nulle.
Dans la même région, se trouve une autre source
du nom d’Aïn-Berda. Sur les bords du Sahara, près
de Biskra, on trouve les grandes sources thermales
inutilisées d’Aïn-Oumach et celles actuellement
exploitées d’Aïn Salahin et d’Hammam G’rule (bain
de la gale). L Ain Salahin, où l’on vient de créer un
établissement balnéaire, débite 3 600 000 litres en
vingt-quatre heures, la température est de 45°, l’eau
est fortement chlorurée et sulfureuse. Tout près se
trouve un lac salé, espèce de cratère à parois
abruptes, qui constitue l’Hammam G’rule. Le diamètre
de ce cratère n ’a pas moins de 300 mètres, on
y voit bouillonner cinq à six sources, qui émettent de
nombreuses bulles gazeuses.
Cette eau est fortement chlorurée et amère, très
désagréable au goût. Elle est inodore. Elle n ’est pas
thermale, les Arabes regardent cette eau comme
souveraine contre la gale. Ils ne peuvent se baigner
que vers l’échancrure du cratère d’où sort le ruisseau
qui lui sert de déversoir. Elle est trouble et
jaunâtre (1).
Dans le département d’Alger, les eaux les plus célèbres
sont d’abord celles d'Hammam R'hira, Aqvæ
calidæ des Romains, à proximité de leur capitale Julia
Cesaræa, aujourd’hui Cherchel. Les restes romains
sont nombreux autour des sources, mais sont peu de
chose à côté des grands établissements modernes,
militaire et civil. L’établissement civil, créé par
M. Arlès-Dufour, ne le cède guère pour l’importance
et le luxe aux plus beaux de la métropole. Hammam
R’hira compte de nombreuses sources, les unes thermales,
les autres froides et ferrugineuses. Leur
débit total est d’environ 216 000 litres en vingt-
quatre heures.
Les diverses sources ferrugineuses d’Hammam
R’hira ont des compositions assez diverses. Elles sont
faiblement carboniques et assez fortement minérali-
(1) Nous citerons encore dans le département de Constantine
le Hammam Mausoura dans les Portes de Ker, assez analogue à
l’Hammam Berda, le Hammam Sétif, le Hammam oued Mimin,
à 41 kilomètres de Philippeville, 40 à 4 3 °, ferrugineuse et
cai’bonique faible; Hammam Sahla Bey, à 9 kilomètres de
Constantine ; Hammam Si el Hadj près Biskra ; les eaux de
l’oued Amimin, près de Jemmapes, etc.