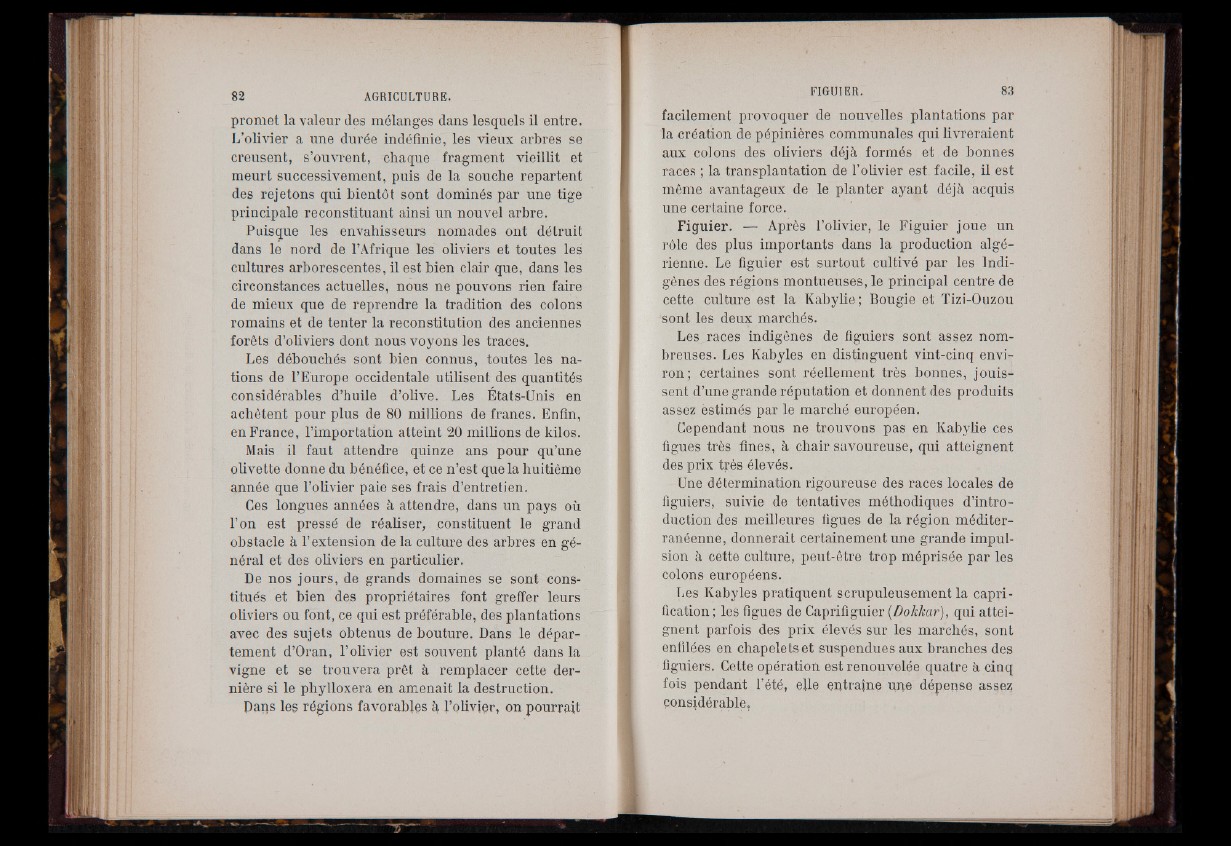
promet la valeur des mélanges dans lesquels il entre.
L’olivier a une durée indéfinie, les vieux arbres se
creusent, s’ouvrent, chaque fragment vieillit et
meurt successivement, puis de la souche repartent
des rejetons qui bientôt sont dominés par une tige
principale reconstituant ainsi un nouvel arbre.
Puisque les envahisseurs nomades ont détruit
dans le nord de l’Afrique les oliviers et toutes les
cultures arborescentes, il est bien clair que, dans les
circonstances actuelles, nous ne pouvons rien faire
de mieux que de reprendre la tradition des colons
romains et de tenter la reconstitution des anciennes
forêts d’oliviers dont nous voyons les traces.
Les débouchés sont bien connus, toutes les nations
de l’Europe occidentale utilisent des quantités
considérables d’huile d’olive. Les États-Unis en
achètent pour plus de 80 millions de francs. Enfin,
en France, l’importation atteint 20 millions de kilos.
Mais il faut attendre quinze ans pour qu’une
olivette donne du bénéfice, et ce n ’est que la huitième
année que l’olivier paie ses frais d’entretien.
Ces longues années à attendre, dans un pays où
l’on est pressé de réaliser, constituent le grand
obstacle à l’extension de la culture des arbres en général
et des oliviers en particulier.
De nos jours, de grands domaines se sont constitués
et bien des propriétaires font greffer leurs
oüviers ou font, ce qui est préférable, des plantations
avec des sujets obtenus de bouture. Dans le département
d’Oran, l’olivier est souvent planté dans la
vigne et se trouvera prêt à remplacer cette dernière
si le phylloxéra en amenait la destruction.
Pans les régions favorables à l’olivier, on pourrait
facilement provoquer de nouvelles plantations par
la création de pépinières communales qui üvreraient
aux colons des oliviers déjà formés et de bonnes
races ; la transplantation de l’oüvier est facile, il est
même avantageux de le planter ayant déjà acquis
une certaine force.
Figuier. — Après l’obvier, le Figuier joue un
rôle des plus importants dans la production algérienne.
Le figuier est surtout cultivé par les Indigènes
des régions montueuses, le principal centre de
cette culture est la Kabybe; Bougie et Tizi-Ouzou
sont les deux marchés.
Les races indigènes de figuiers sont assez nombreuses.
Les Kabyles en distinguent vint-cinq environ;
certaines sont réellement très bonnes, jouissent
d’une grande réputation et donnent des produits
assez estimés par le marché européen.
Cependant nous ne trouvons pas en Kabybe ces
figues très fines, à chair savoureuse, qui atteignent
des prix très élevés.
Une détermination rigoureuse des races locales de
figuiers, suivie de tentatives méthodiques d’introduction
des meilleures figues de la région méditerranéenne,
donnerait certainement une grande impulsion
à cette culture, peut-être trop méprisée par les
colons européens.
Les Kabyles pratiquent scrupuleusement la caprification
; les figues de Caprifiguier (Dokkar), qui atteignent
parfois des prix élevés sur les marchés, sont
enfilées en chapelets et suspendues aux branches des
figuiers. Cette opération est renouvelée quatre à cinq
fois pendant l’été, elle entraîne une dépense asse?
ponsidérable,