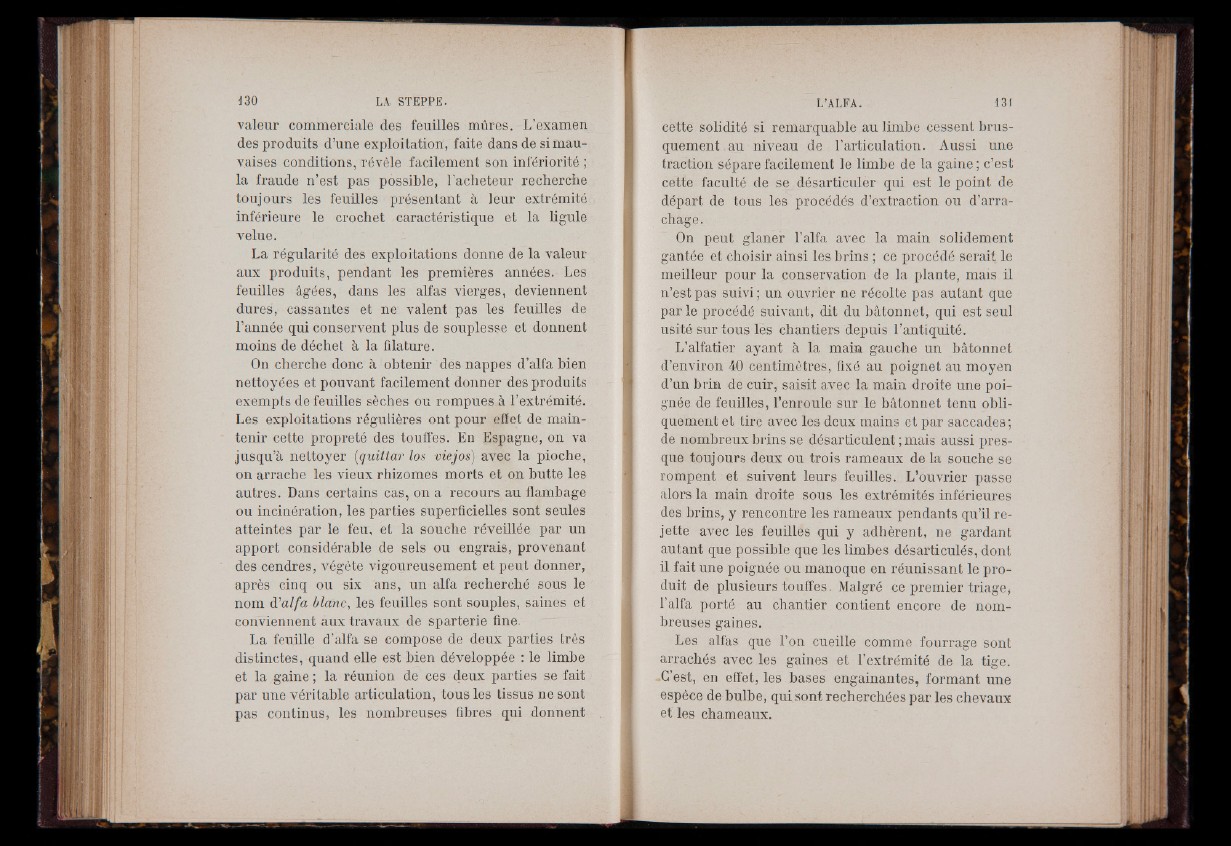
valeur commerciale des feuilles mûres. L’examen
des produits d’une exploitation, faite dans de si mauvaises
conditions, révèle facilement son infériorité ;
la fraude n ’est pas possible, l’acheteur recherche
toujours les feuilles présentant à leur extrémité
inférieure le crochet caractéristique et la ligule
velue.
La régularité des exploitations donne de la valeur
aux produits, pendant les premières années. Les
feuilles âgées, dans les alfas vierges, deviennent
dures, cassantes et ne valent pas les feuilles de
l’année qui conservent plus de souplesse et donnent
moins de déchet à la filature.
On cherche donc à obtenir des nappes d’alfa bien
nettoyées et pouvant facilement donner des produits
exempts de feuilles sèches ou rompues à l’extrémité.
Les exploitations régulières ont pour effet de maintenir
cette propreté des touffes. En Espagne, on va
jusqu’à nettoyer (quittar los viejos) avec la pioche,
on arrache les vieux rhizomes morts et on butte les
autres. Dans certains cas, on a recours au flambage
ou incinération, les parties superficielles sont seules
atteintes par le feu, et la souche réveillée par un
apport considérable de sels ou engrais, provenant
des cendres, végète vigoureusement et peut donner,
après cinq ou six ans, un alfa recherché sous le
nom d'alfa blanc, les feuilles sont souples, saines et
conviennent aux travaux de sparterie fine.
La feuille d’alfa se compose de deux parties très
distinctes, quand elle est bien développée : le limbe
et la gaine; la réunion de ces deux parties se fait
par une véritable articulation, tous les tissus ne sont
pas continus, les nombreuses fibres qui donnent
cette solidité si remarquable au limbe cessent brusquement
au niveau de l’articulation. Aussi une
traction sépare facilement le limbe de la gaine ; c’est
cette faculté de se^ désarticuler qui est le point de
départ de tous les procédés d’extraction ou d’arrachage.
On peut glaner l’alfa avec la main solidement
gantée et choisir ainsi les brins ; ce procédé serait le
meilleur pour la conservation de la plante, mais il
n’est pas suivi; un ouvrier ne récolte pas autant que
par le procédé suivant, dit du bâtonnet, qui est seul
usité sur tous les chantiers depuis l ’antiquité.
L’alfatier ayant à la main gauche un bâtonnet
d’environ 40 centimètres, fixé au poignet au moyen
d’un brin de cuir, saisit avec la main droite une poignée
de feuilles, l’enroule sur le bâtonnet tenu obliquement
et tire avec les deux mains et par saccades ;
de nombreux brins se désarticulent ; mais aussi presque
toujours deux ou trois rameaux de la souche se
rompent et suivent leurs feuilles. L’ouvrier passe
alors la main droite sous les extrémités inférieures
des brins, y rencontre les rameaux pendants qu’il rejette
avec les feuilles qui y adhèrent, ne gardant
autant que possible que les limbes désarticulés, dont
il fait une poignée ou manoque en réunissant le produit
de plusieurs touffes. Malgré ce premier triage,
l’alfa porté au chantier contient encore de nombreuses
gaines.
Les alfas que l’on cueille comme fourrage sont
arrachés avec les gaines et l’extrémité de la tige.
•C’est, en effet, les bases engainantes, formant une
espèce de bulbe, qui sont recherchées par les chevaux
et les chameaux.