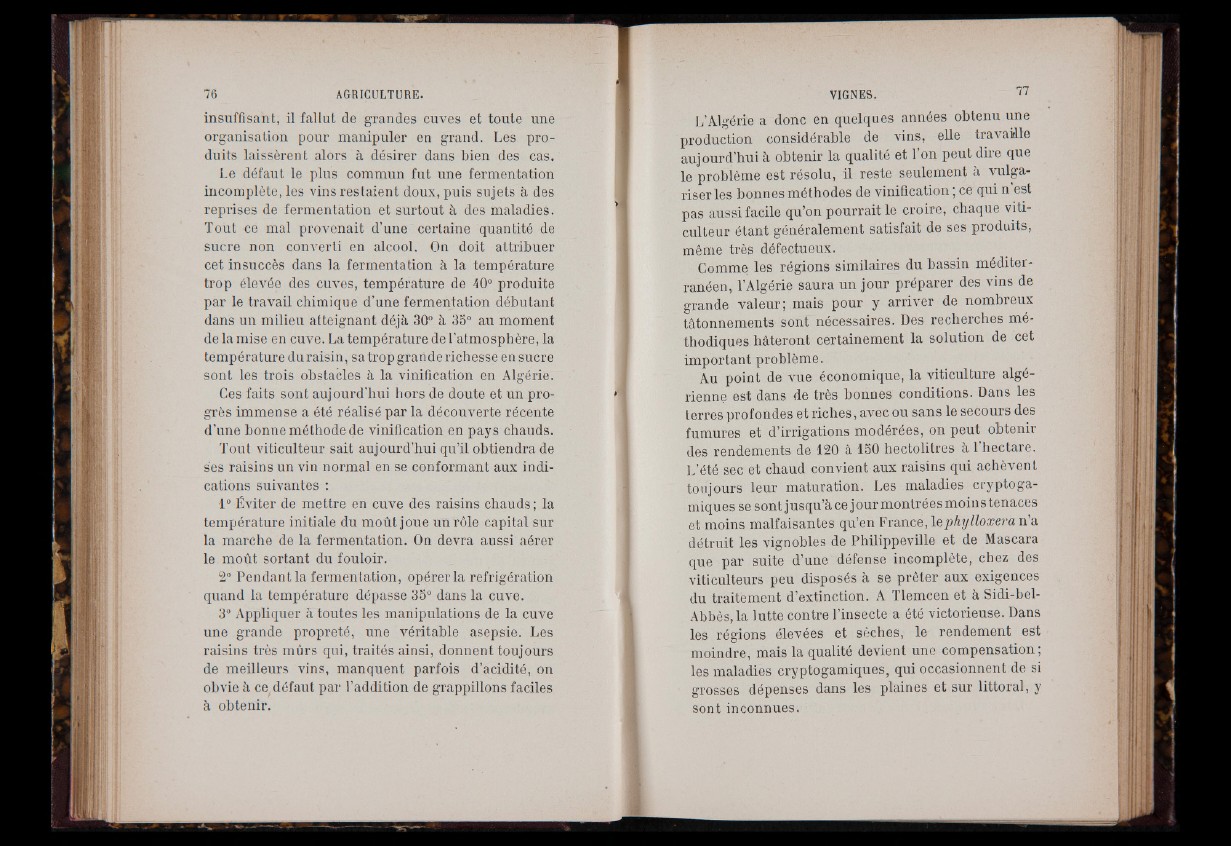
insuffisant, il fallut de grandes cuves et toute une
organisation pour manipuler en grand. Les produits
laissèrent alors à désirer dans bien des cas.
Le défaut le plus commun fut une fermentation
incomplète, les vins restaient doux, puis sujets à des
reprises de fermentation et surtout à des maladies.
Tout ce mal provenait d’une certaine quantité de
sucre non converti en alcool. On doit attribuer
cet insuccès dans la fermentation à la température
trop élevée des cuves, température de 40° produite
par le travail chimique d’une fermentation débutant
dans un milieu atteignant déjà 30° à 33° au moment
de la mise en cuve. La température de l'atmosphère, la
température du raisin, sa trop grande richesse en sucre
sont les trois obstacles à la vinification en Algérie.
Ces faits sont aujourd’hui hors de doute et un progrès
immense a été réalisé par la découverte récente
d’une bonne méthode de vinification en pays chauds.
Tout viticulteur sait aujourd’hui qu’il obtiendra de
ses raisins un vin normal en se conformant aux indications
suivantes :
1° Éviter de mettre en cuve des raisins chauds; la
température initiale du moût joue un rôle capital sur
la marche de la fermentation. On devra aussi aérer
le moût sortant du fouloir.
2° Pendant la fermentation, opérer la réfrigération
quand la température dépasse 35° dans la cuve.
3° Appliquer a toutes les manipulations de la cuve
une grande propreté, une véritable asepsie. Les
raisins très mûrs qui, traités ainsi, donnent toujours
de meilleurs vins, manquent parfois d’acidité, on
obvie à ce défaut par l’addition de grappillons faciles
à obtenir.
L’Algérie a donc en quelques années obtenu une
production considérable de vins, elle travaille
aujourd’hui à obtenir la qualité et Ton peut dire que
le problème est résolu, il reste seulement à vulgariser
les bonnes méthodes de vinification ; ce qui n ’est
pas aussi facile qu’on pourrait le croire, chaque viticulteur
étant généralement satisfait de ses produits,
même très défectueux.
Comme les régions similaires du bassin méditerranéen,
l’Algérie saura un jour préparer des vins de
grande valeur; mais pour y arriver de nombreux
tâtonnements sont nécessaires. Des recherches méthodiques
hâteront certainement la solution de cet
important problème.
Au point de vue économique, la viticulture algérienne
est dans de très bonnes conditions. Dans les
terres profondes et riches, avec ou sans le secours des
fumures et d’irrigations modérées, on peut obtenir
des rendements de 120 à 150 hectolitres à 1 hectare.
L’été sec et chaud convient aux raisins qui achèvent
toujours leur maturation. Les maladies cryptoga-
miques se sont jusqu’àce jourmontréesmoiustenaces
et moins malfaisantes qu’en France, 1 qphylloxéra n a
détruit les vignobles de Philippeville et de Mascara
que par suite d’une défense incomplète, chez des
viticulteurs peu disposés à se prêter aux exigences
du traitement d’extinction. A Tlemcen et à Sidi-bel-
Abbès, la lutte contre l’insecte a été victorieuse. Dans
les régions élevées et sèches, le rendement est
moindre, mais la qualité devient une compensation;
les maladies cryptogamiques, qui occasionnent de si
grosses dépenses dans les plaines et sur littoral, y
sont inconnues.