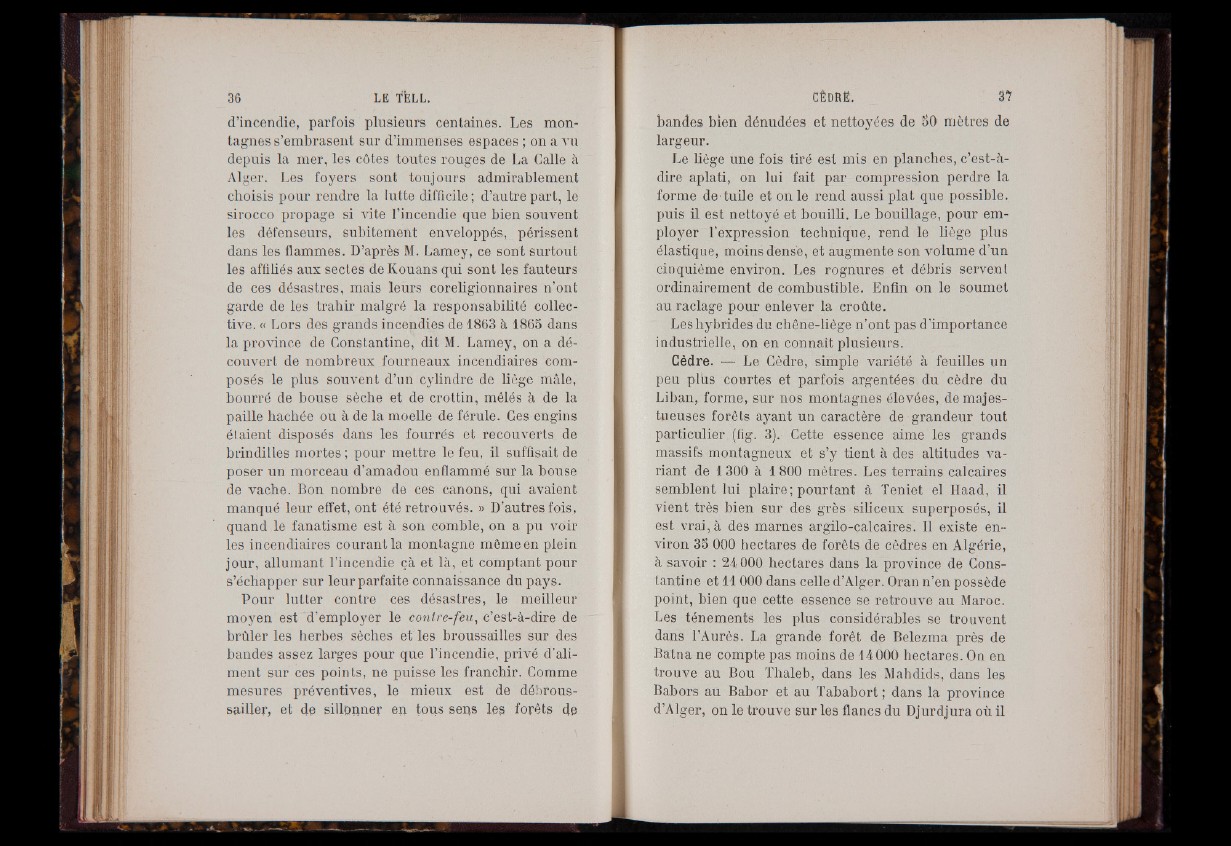
d’incendie, parfois plusieurs centaines. Les montagnes
s’embrasent sur d’immenses espaces ; on a vu
depuis la mer, les côtes toutes rouges de La Calle à
Alger. Les foyers sont toujours admirablement
choisis pour rendre la lutte difficile ; d’autre part, le
sirocco propage si vite l’incendie que bien souvent
les défenseurs, subitement enveloppés, périssent
dans les flammes. D’après M. Lamey, ce sont surtout
les affiliés aux sectes de Kouans qui sont les fauteurs
de ces désastres, mais leurs coreligionnaires n’ont
garde de les trahir malgré la responsabilité collective.
« Lors des grands incendies de 1863 à 1865 dans
la province de Constantine, dit M. Lamey, on a découvert
de nombreux fourneaux incendiaires composés
le plus souvent d’un cylindre de liège mâle,
bourré de bouse sèche et de crottin, mêlés à de la
paille hachée ou à de la moelle de férule. Ces engins
étaient disposés dans les fourrés et recouverts de
brindilles mortes; pour mettre le feu, il suffisait de
poser un morceau d’amadou enflammé sur la bouse
de vache. Bon nombre de ces canons, qui avaient
manqué leur effet, ont été retrouvés. » D’autres fois,
quand le fanatisme est à son comble, on a pu voir
les incendiaires courant la montagne même en plein
jour, allumant l’incendie çà et là, et comptant pour
s’échapper sur leur parfaite connaissance du pays.
Pour lutter contre ces désastres, le meilleur
moyen est d’employer le contre-feu, c’est-à-dire de
brûler les herbes sèches et les broussailles sur des
bandes assez larges pour que l’incendie, privé d’aliment
sur ces points, ne puisse les franchir. Comme
mesures préventives, le mieux est de débroussailler,
et de sillonner en tous sens les forêts de
bandes bien dénudées et nettoyées de 50 mètres de
largeur.
Le liège une fois tiré est mis en planches, c’est-à-
dire aplati, on lui fait par compression perdre la
forme de-tuile et on le rend aussi plat que possible,
puis il est nettoyé et bouilli. Le bouillage, pour employer
l’expression technique, rend le liège plus
élastique, moins dense, et augmente son volume d’un
cinquième environ. Les rognures et débris servent
ordinairement de combustible. Enfin on le soumet
au raclage pour enlever la croûte.
Les hybrides du chêne-liège n ’ont pas d’importance
industrielle, on en connaît plusieurs.
Cèdre. — Le Cèdre, simple variété à feuilles un
peu plus courtes et parfois argentées du cèdre du
Liban, forme, sur nos montagnes élevées, de majestueuses
forêts ayant un caractère de grandeur tout
particulier (fig. 3). Cette essence aime les grands
massifs montagneux et s’y tient à des altitudes variant
de 1300 à 1800 mètres. Les terrains calcaires
semblent lui plaire; pourtant à Teniet el Haad, il
vient très bien sur des grès siliceux superposés, il
est vrai, à des marnes argilo-calcaires. Il existe environ
35 000 hectares de forêts de cèdres en Algérie,
à savoir : 24 000 hectares dans la province de Constantine
et 11000 dans celle d’Alger. Oran n ’en possède
point, bien que cette essence se retrouve au Maroc.
Les ténements les plus considérables se trouvent
dans l’Aurès. La grande forêt de Belezma près de
Batna ne compte pas moins de 14000 hectares. On en
trouve au Bou Thaleb, dans les Mahdids, dans les
Babors au Babor et au Tababort ; dans la province
d’Alger, on le trouve sur les flancs du Djurdjura où il