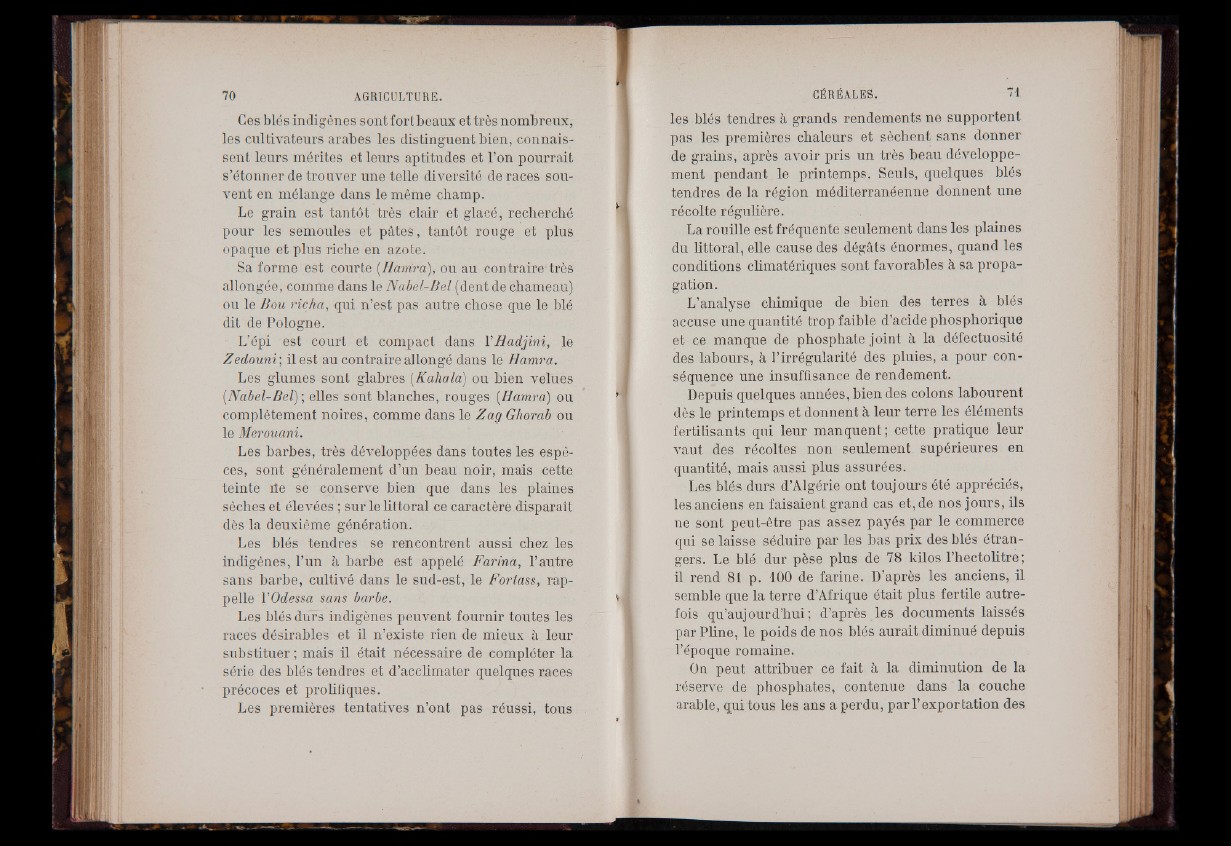
Ces blés indigènes sontfortbeaux et très nombreux,
les cultivateurs arabes les distinguent bien, connaissent
leurs mérites et leurs aptitudes et l’on pourrait
s’étonner de trouver une telle diversité de races souvent
en mélange dans le même champ.
Le grain est tantôt très clair et glacé, recherché
pour les semoules et pâtes, tantôt rouge et plus
opaque et plus riche en azote.
Sa forme est courte (Havrira), ou au contraire'très
allongée, comme dans le Nabel-Bel (dent de chameau)
ou le Bou richa, qui n ’est pas autre chose que le blé
dit de Pologne.
L’épi est court et compact dans YHadjini, le
Zedouni; il est au contraire allongé dans le Hamra.
Les glumes sont glabres (Kahala) ou bien velues
(.Nabel-Bel) ; elles sont blanches, rouges [Hamra) ou
complètement noires, comme dans le Zag Ghorab ou
le Merouani.
Les barbes, très développées dans toutes les espèces,
sont généralement d ’un beau noir, mais cette
teinte île se conserve bien que dans les plaines
sèches et élevées ; sur le littoral ce caractère disparaît
dès la deuxième génération.
Les blés tendres se rencontrent aussi chez les
indigènes, l’un à barbe est appelé Farina, l’autre
sans barbe, cultivé dans le sud-est, le Fortass, rappelle
l’Odessa sans barbe.
Les blés durs indigènes peuvent fournir toutes les
races désirables et il n ’existe rien de mieux à leur
substituer ; mais il était nécessaire de compléter la
série des blés tendres et d’acclimater quelques races
précoces et prolifiques.
Les premières tentatives n ’ont pas réussi, tous
les blés tendres à grands rendements ne supportent
pas les premières chaleurs et sèchent sans donner
de grains, après avoir pris un très beau développement
pendant le printemps. Seuls, quelques blés
tendres de la région méditerranéenne donnent une
récolte régulière.
La rouille est fréquente seulement dans les plaines
du littoral, elle cause des dégâts énormes, quand les
conditions climatériques sont favorables à sa propagation.
L’analyse chimique de bien des terres à blés
accuse une quantité trop faible d’acide phosphorique
et ce manque de phosphate joint à la défectuosité
des labours, à l’irrégularité des pluies, a pour conséquence
une insuffisance de rendement.
Depuis quelques années, bien des colons labourent
dès le printemps et donnent à leur terre les éléments
fertilisants qui leur manquent; cette pratique leur
vaut des récoltes non seulement supérieures en
quantité, mais aussi plus assurées.
Les blés durs d’Algérie ont toujours été appréciés,
les anciens en faisaient grand cas et, de nos jours, ils
ne sont peut-être pas assez payés par le commerce
qui se laisse séduire par les bas prix des blés étrangers.
Le blé dur pèse plus de 78 kilos l’hectolitre;
il rend 81 p. 100 de farine. D’après les anciens, il
semble que la terre d’Afrique était plus fertile autrefois
qu’aujourd’hui; d’après.les documents laissés
par Pline, le poids de nos blés aurait diminué depuis
l’époque romaine.
On peut attribuer ce fait à la diminution de la
réserve de phosphates, contenue dans la couche
arable, qui tous les ans a perdu, par l’exportation des