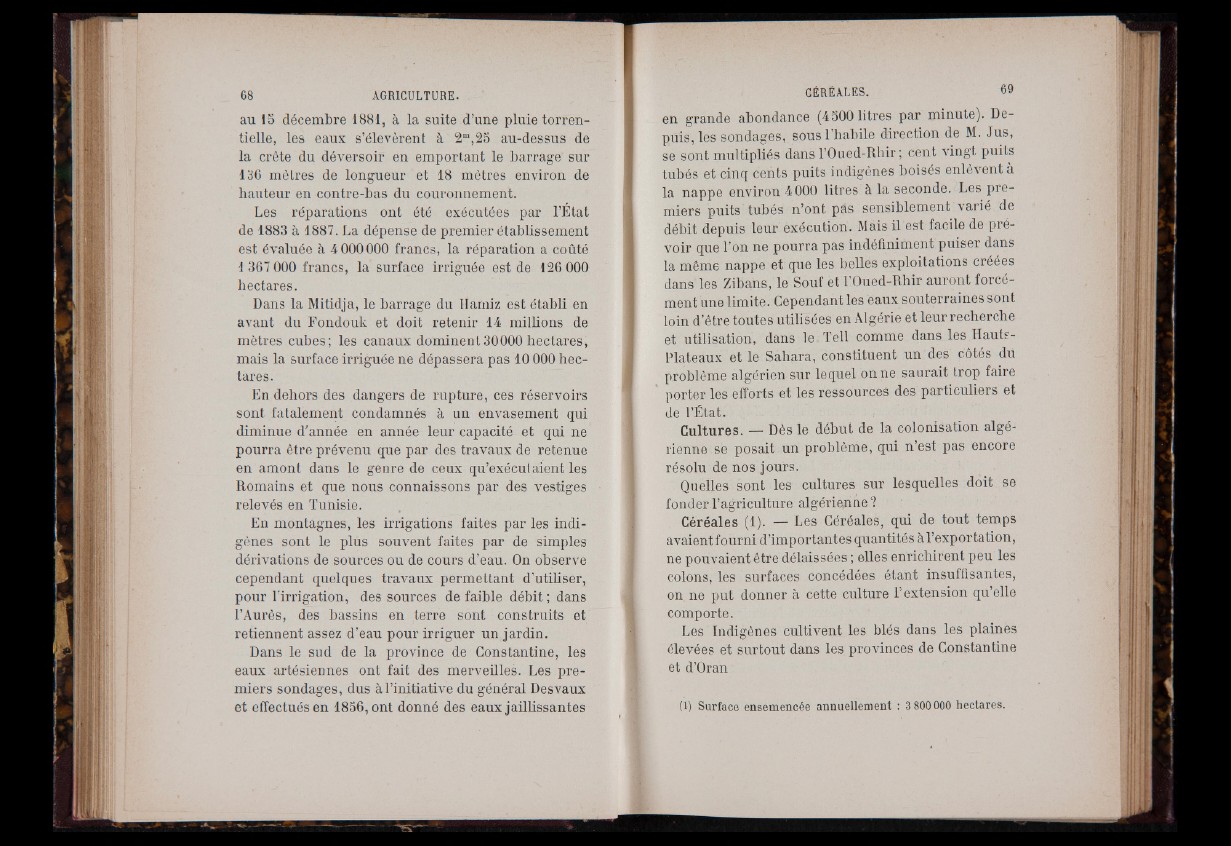
au 15 décembre 1881, à la suite d’une pluie torrentielle,
les eaux s’élevèrent à 2m,25 au-dessus de
la crête du déversoir en emportant le barrage sur
136 mètres de longueur et 18 mètres environ de
hauteur en contre-bas du couronnement.
Les réparations ont été exécutées par l’État
de 1883 à 1887. La dépense de premier établissement
est évaluée à 4000000 francs, la réparation a coûté
1367 000 francs, la surface irriguée est de 126 000
hectares.
Dans la Mitidja, le barrage du Harniz est établi en
avant du Pondouk et doit retenir 14 millions de
mètres cubes; les canaux dominent 30000 hectares,
mais la surface irriguée ne dépassera pas 10 000 hectares.
En dehors des dangers de rupture, ces réservoirs
sont fatalement condamnés à un envasement qui
diminue d’année en année leur capacité et qui ne
pourra être prévenu que par des travaux de retenue
en amont dans le genre de ceux qu’exécutaient les
Romains et que nous connaissons par des vestiges
relevés en Tunisie.
En montagnes, les irrigations faites par les indigènes
sont le plus souvent faites par de simples
dérivations de sources ou de cours d’eau. On observe
cependant quelques travaux permettant d’utiliser,
pour l'irrigation, des sources de faible débit ; dans
l’Aurès, des bassins en terre sont construits et
retiennent assez d’eau pour irriguer un jardin.
Dans le sud de la province de Constantine, les
eaux artésiennes ont fait des merveilles. Les premiers
sondages, dus à l’initiative du général Desvaux
et effectués en 1856, ont donné des eaux jaillissantes
en grande abondance (4500 litres par minute). Depuis,
les sondages, sous l ’habile direction de M. Jus,
se sont multipliés dans l’Oued-Rhir ; cent vingt puits
tubés et cinq cents puits indigènes boisés enlèvent à
la nappe environ 4000 litres à la seconde. Les premiers
puits tubés n ’ont pas sensiblement varié de
débit depuis leur exécution. Mais il est facile de prévoir
que l’on ne pourra pas indéfiniment puiser dans
la même nappe et que les belles exploitations créées
dans les Zibans, le Souf et l’Oued-Rhir auront forcément
une limite. Cependant les eaux souterraines sont
loin d’être toutes utilisées en Algérie et leur recherche
et utilisation, dans le Tell comme dans les Hauts-
Llateaux et le Sahara, constituent un des côtés du
problème algérien sur lequel on ne saurait trop faire
porter les efforts et les ressources des particuliers et
de l’État.
Cultures. — Dès le début de la colonisation algérienne
se posait un problème, qui n ’est pas encore
résolu de nos jours.
Quelles sont les cultures sur lesquelles doit se
fonder l’agriculture algérienne?
Céréales (1). — Les Céréales, qui de tout temps
avaientfourni d’importantes quantités à l’exportation,
ne pouvaient être délaissées ; elles enrichirent peu les
colons, les surfaces concédées étant insuffisantes,
on ne put donner à cette culture l'extension qu’elle
comporte.
Les Indigènes cultivent les blés dans les plaines
élevées et surtout dans les provinces de Constantine
et d’Oran
(1) Surface ensemencée annuellement : 3 800000 hectares.