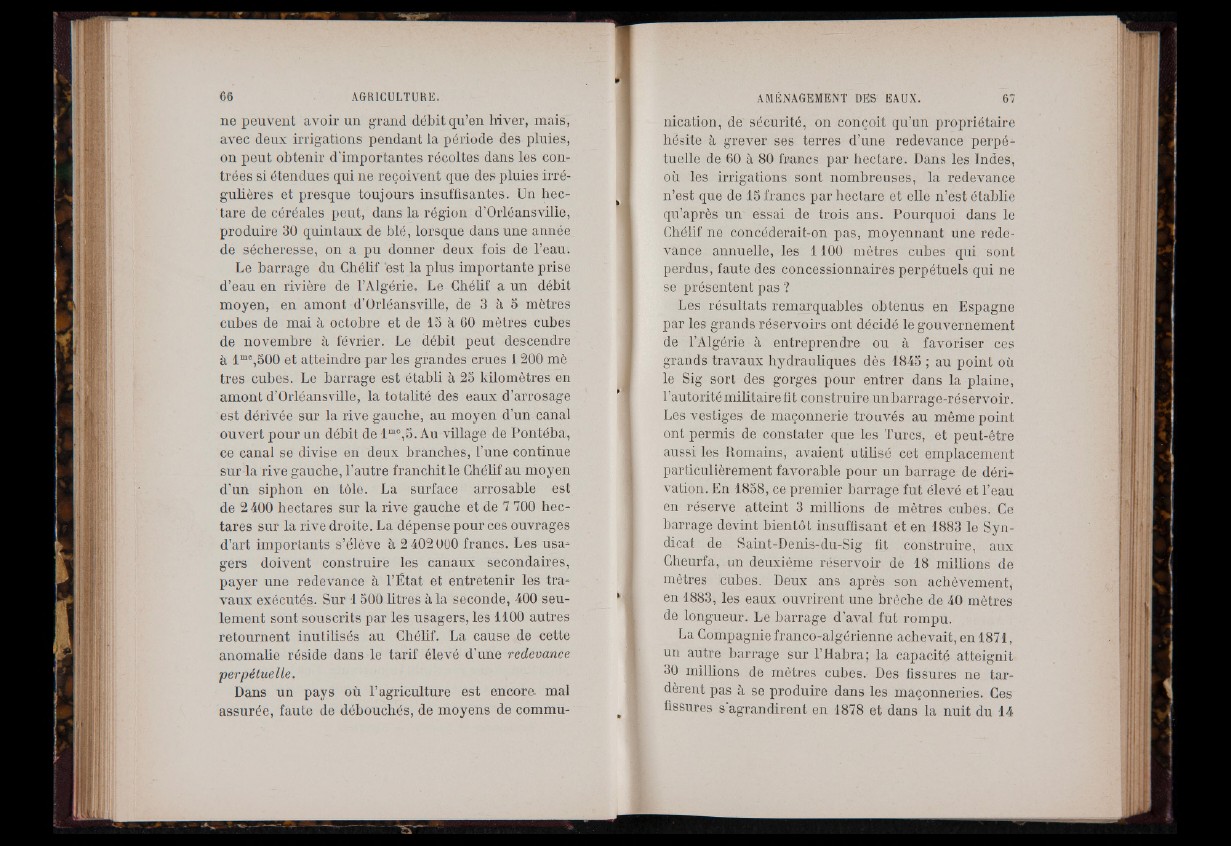
ne peuvent avoir un grand débit qu’en hiver, mais,
avec deux irrigations pendant la période des pluies,
on peut obtenir d’importantes récoltes dans les contrées
si étendues qui ne reçoivent que des pluies irrégulières
et presque toujours insuffisantes. Un hectare
de céréales peut, dans la région d’Orléansville,
produire 30 quintaux de blé, lorsque dans une année
de sécheresse, on a pu donner deux fois de l’eau.
Le barrage du Chélif 'est la plus importante prise
d’eau en rivière de l’Algérie. Le Chélif a un débit
moyen, en amont d’Orléansville, de 3 à 5 mètres
cubes de mai à octobre et de 15 à 60 mètres cubes
de novembre à février. Le débit peut descendre
à l m6,500 et atteindre par les grandes crues 1 200 mè
très cubes. Le barrage est établi à 25 kilomètres en
amont d’Orléansville, la totalité des eaux d’arrosage
est dérivée sur la rive gauche, au moyen d’un canal
ouvert pour un débit de l m0,5. Au village de Pontéba,
ce canal se divise en deux branches, l’une continue
sur la rive gauche, l’autre franchit le Chélif au moyen
d’un siphon en tôle. La surface arrosable est
de 2400 hectares sur la rive gauche et de 7 700 hectares
sur la rive droite. La dépense pour ces ouvrages
d’art importants s’élève à 2402000 francs. Les usagers
doivent construire les canaux secondaires,
payer une redevance à l’État et entretenir les travaux
exécutés. Sur 1500 litres à la seconde, 400 seulement
sont souscrits par les usagers, les 1100 autres
retournent inutilisés au Chélif. La cause de cette
anomalie réside dans le tarif élevé d’une redevance
perpétuelle.
Dans un pays où l ’agriculture est encore, mal
assurée, faute de débouchés, de moyens de communication,
de' sécurité, on conçoit qu’un propriétaire
hésite à grever ses terres d’une redevance perpétuelle
de 60 à 80 francs par hectare. Dans les Indes,
où les irrigations sont nombreuses, la redevance
n’est que de 15 francs par hectare et elle n ’est établie
qu’après un essai de trois ans. Pourquoi dans le
Chélif ne concéderait-on pas, moyennant une redevance
annuelle, les 1100 mètres cubes qui sont
perdus, faute des concessionnaires perpétuels qui ne
se présentent pas ?
Les résultats remarquables obtenus en Espagne
par les grands réservoirs ont décidé le gouvernement
de l’Algérie à entreprendre ou à favoriser ces
grands travaux hydrauliques dès 1845 ; au point où
le Sig sort des gorges pour entrer dans la plaine,
l’autorité militaire fit construire un barrage-réservoir.
Les vestiges de maçonnerie trouvés au même point
ont permis de constater que les Turcs, et peut-être
aussi les Romains, avaient utilisé cet emplacement
particulièrement favorable pour un barrage de dérivation.
En 1858, ce premier barrage fut élevé et l’eau
en réserve atteint 3 millions de mètres cubes. Ce
barrage devint bientôt insuffisant et en 1883 le Syndicat
de Saint-Denis-du-Sig fit construire, aux
Cheurfa, un deuxième réservoir de 18 millions de
mètres cubes. Deux ans après son achèvement,
en 1883, les eaux ouvrirent une brèche de 40 mètres
de longueur. Le barrage d ’aval fut rompu.
La Compagnie franco-algérienne achevait, en 1871,
un autre barrage sur l’Habra; la capacité atteignit
30 millions de mètres cubes. Des fissures ne tardèrent
pas à se produire dans les maçonneries. Ces
fissures s'agrandirent en 1878 et dans la nuit du 14