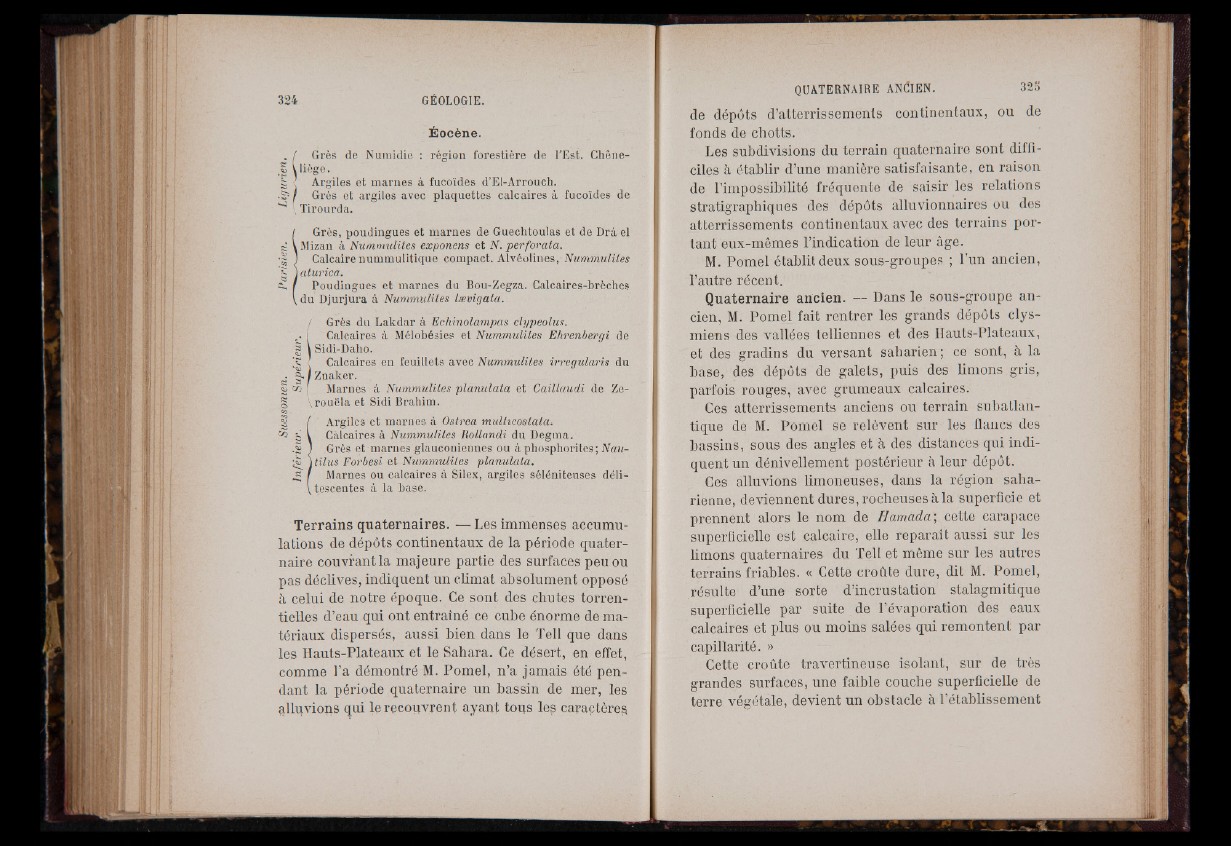
Éocène.
. / Grès de Numidio : région forestière de l’Est. Chêne-
S V liège.
§ ; Argiles et marnes à fucoïdes d’El-Arrouch.
•2 = I Grès et argiles avec plaquettes calcaires à fucoïdes de
^ i I Tirourda. Grès, poudingues et marnes de Guechtoulas et de Drà el
Mizan à Nummulites exponens et N. perforata.
Calcaire nummulitique compact. Alvêolines, Nummulites
aturica.
Poudingues et marnes du Bou-Zegza. Calcaires-brèches
du Djurjura à Nummulites lævigata.
/ Grès du Lakdar à Echinolampas clypeolus.
( Calcaires à Mélobésies et Nummulites Ehrenbergi de
g V Sidi-Daho.
Calcaires en feuillets avec Nummulites irregularis du
- g. I Znaker.
« co f Marnes à Nummulites planulata et Caillaudi de Ze-
§ Vrouëla et Sidi Brahim.
Co
Argiles et marnes à Ostrea multicoslata.
Calcaires à Nummulites Rollandi du Degma.
Grès et marnes glauconiennes ou à phosphorites; Nautilus
Forbesi et Nummulites planulata.
Marnes ou calcaires à Silex, argiles séléniteuses déli—
tescentes à la base.
Terrains quaternaires. — Les immenses accumulations
de dépôts continentaux de la période quaternaire
couvrant la majeure partie des surfaces peu ou
pas déclives, indiquent un climat absolument opposé
à celui de notre époque. Ce sont des chutes torrentielles
d’eau qui ont entraîné ce cube énorme de matériaux
dispersés, aussi bien dans le Tell que dans
les Hauts-Plateaux et le Sahara. Ce désert, en effet,
comme l’a démontré M. Pomel, n ’a jamais été pendant
la période quaternaire un bassin de mer, les
alluvions qui le recouvrent ayant tous leg caractère^
de dépôts d’atterrissements continentaux, ou de
fonds de chotts.
Les subdivisions du terrain quaternaire sont difficiles
à établir d’une manière satisfaisante, en raison
de l’impossibilité fréquente de saisir les relations
stratigraphiques des dépôts alluvionnaires ou des
atterrissements continentaux avec des terrains portant
eux-mêmes l’indication de leur âge.
M. Pomel établit deux sous-groupes ; l’un ancien,
l’autre récent.
Quaternaire ancien. — Dans le sous-groupe ancien,
M. Pomel fait rentrer les grands dépôts clys-
miens des vallées telliennes et des Hauts-Plateaux,
et des gradins du versant saharien; ce sont, à la
base, des dépôts de galets, puis des limons gris,
parfois rouges, avec grumeaux calcaires.
Ces atterrissements anciens ou terrain subatlantique
de M. Pomel se relèvent sur les flancs des
bassins, sous des angles et à des distances qui indiquent
un dénivellement postérieur à leur dépôt.
Ces alluvions limoneuses, dans la région saharienne,
deviennent dures, rocheuses à la superficie et
prennent alors le nom de Hamada\ cette carapace
superficielle est calcaire, elle reparaît aussi sur les
limons quaternaires du Tell et même sur les autres
terrains friables. « Cette croûte dure, dit M. Pomel,
résulte d’une sorte d’incrustation stalagmitique
superficielle par suite de l’évaporation des eaux
calcaires et plus ou moins salées qui remontent par
capillarité. »
Cette croûte travertineuse isolant, sur de très
grandes surfaces, une faible couche superficielle de
terre végétale, devient un obstacle à l’établissement