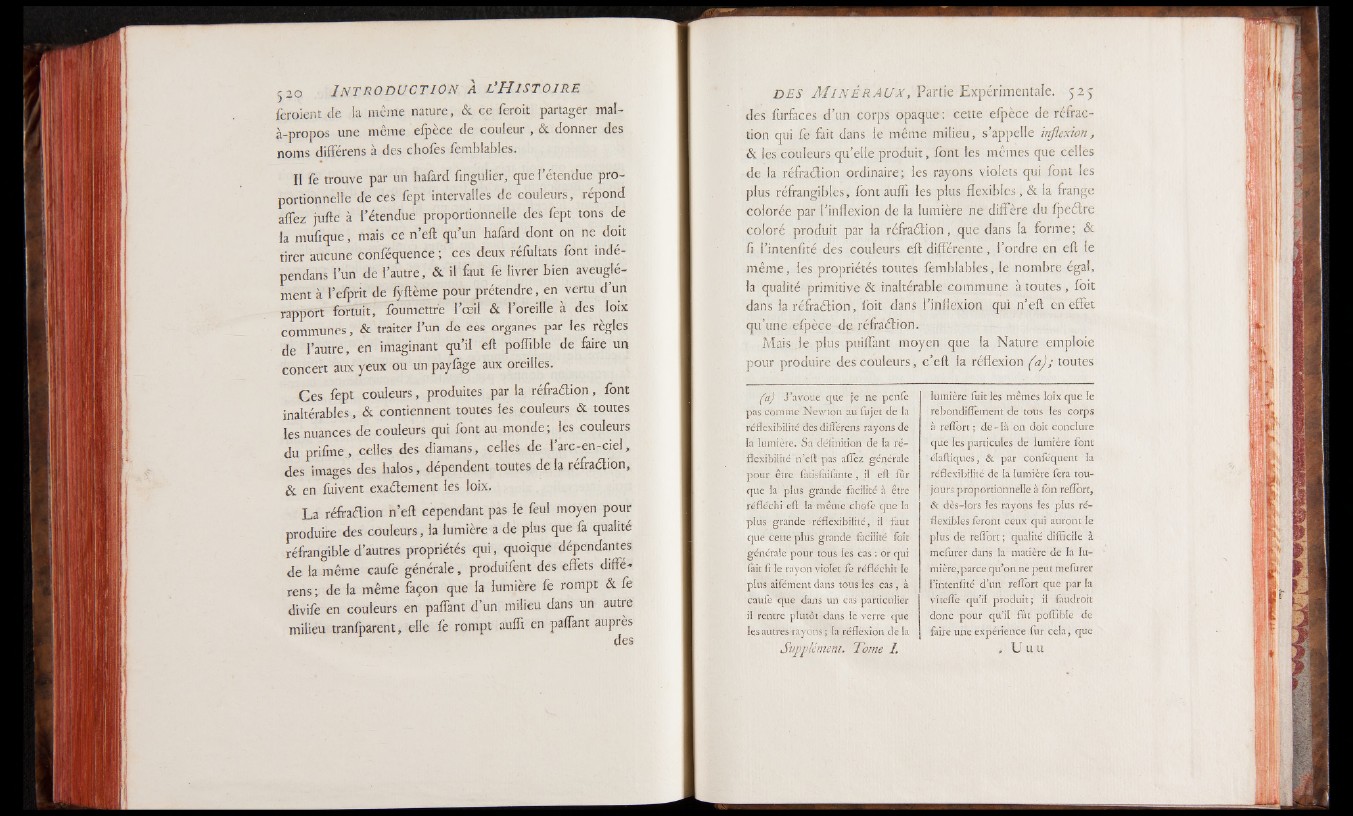
5 2Q I n t r o d u c t i o n à l ' H i s t o i r e
feroient de la même nature, & ce feroit partager malà
propos une même efpèce de couleur , & donner des
noms différens à des chofes femblables.
Il fe trouve par un hafard fingulier, que l’étendue proportionnelle
de ces fept intervalles de couleurs, répond
allez jufte à l’étendue proportionnelle des fept tons de
la mufique, mais ce n’elt qu’un hafard dont on ne doit
tirer aucune conféquence ; ces deux réfultats font indé-
pendans l’un de l’autre, & il faut fe livrer bien aveuglément
à l’efprit de fyftème pour prétendre, en vertu d’un
rapport fortuit, foumettre l’oeil & l’oreille à des loix
communes, & traiter l’un de c e s o r g a n e s p a r les règles
de l’autre, en imaginant qu’il eft polfible de faire un
concert aux yeux ou un payfage aux oreilles.
Ces fept couleurs, produites par la réfraction, font
inaltérables, & contiennent toutes les couleurs & toutes
les nuances de couleurs qui font au monde; les couleurs
du prifme., celles desdiamans, celles de l’arc-en-ciel,
des images des halos, dépendent toutes de la réfraétion,
& en fuivent exactement les loix.
La réfraétion n’efl cependant pas le feul moyen pour
produire des couleurs, la lumière a de plus que fa qualité
réfrangible d’autres propriétés qui, quoique dépendantes
de la même caufe générale, produifent des effets différens
; de la même façon que la lumière fe rompt & fe
divife en couleurs en paffant d’un milieu dans un autre
milieu tranfparent, elle fe rompt auffi en paffant auprès
des
d e s M i n é r a u x , Partie Expérimentale. 525
des furfaces d’un corps opaque: cette efpèce de réfraction
qui fe fait dans le même milieu, s’appelle inflexion,
& les couleurs qu’elle produit, font les mêmes que celles
de la réfraétion ordinaire; les rayons violets qui font les
plus réfrangibles, font auffi les plus flexibles, & la frange
colorée par l’inflexion de la lumière ne diffère du fpeétre
coloré produit par la réfraétion, que dans la forme; &
fi l’intenfité des couleurs eft différente, l’ordre en eft le
même, les propriétés toutes femblables, le nombre égal,
la qualité primitive & inaltérable commune à toutes, foit
dans la réfraétion, foit dans l’inflexion qui n’eft en effet
qu’une efpèce de réfraétion.
Mais Je plus puiffant moyen que la Nature emploie
pour produire des couleurs, c ’eft la réflexion (a); toutes
(a ) J ’avoue que je ne penfe
pas comme N ew to n a u fu je t de la
réflexibilité dès différens rayons de
la lumière. Sa définition de la ré -
flexibiiité ’ n ’eft pas allez générale
p ou r être fatisfaifante, il eft fur
q u e la plus grande facilité à être
réfléchi eft la même chofe-que la
plus grande réflexibilité, il faut
que cette plus grande facilité foit
générale p our tous les cas : or qui
fait fi le rayon violet fe réfléchit le
plus aifément dans tous les c a s , à
caufe que dans un cas particulier
il rentre plutôt dans le verre que
les autres rayons ; la réflexion de la
Supplément. Tome 1.
lumière fuit ies mêmes loix que le
rebondiflèment de tous ïes corp s
à reflort ; de - ià on doit conc lure
que ies particules de lumière font
é lalfiqu es, & par conféquent la
réflexibilité de la lumière fera toujours
proportionnelle à Ion reflort,
& dès-lors les rayons les plus réflexibles
feront ce u x qui auront le
plus de reflort ; qualité difficile à
mefurer dans la matière de la lu mière,
parce q u ’on ne p eut m efurer
l ’intenfité d ’un reflort que par la
v îte fle qu ’il p rod u it; il faudroit
d onc p our q u ’il fû t p offib le de
faire une expérience fur c e la , que
, U u u