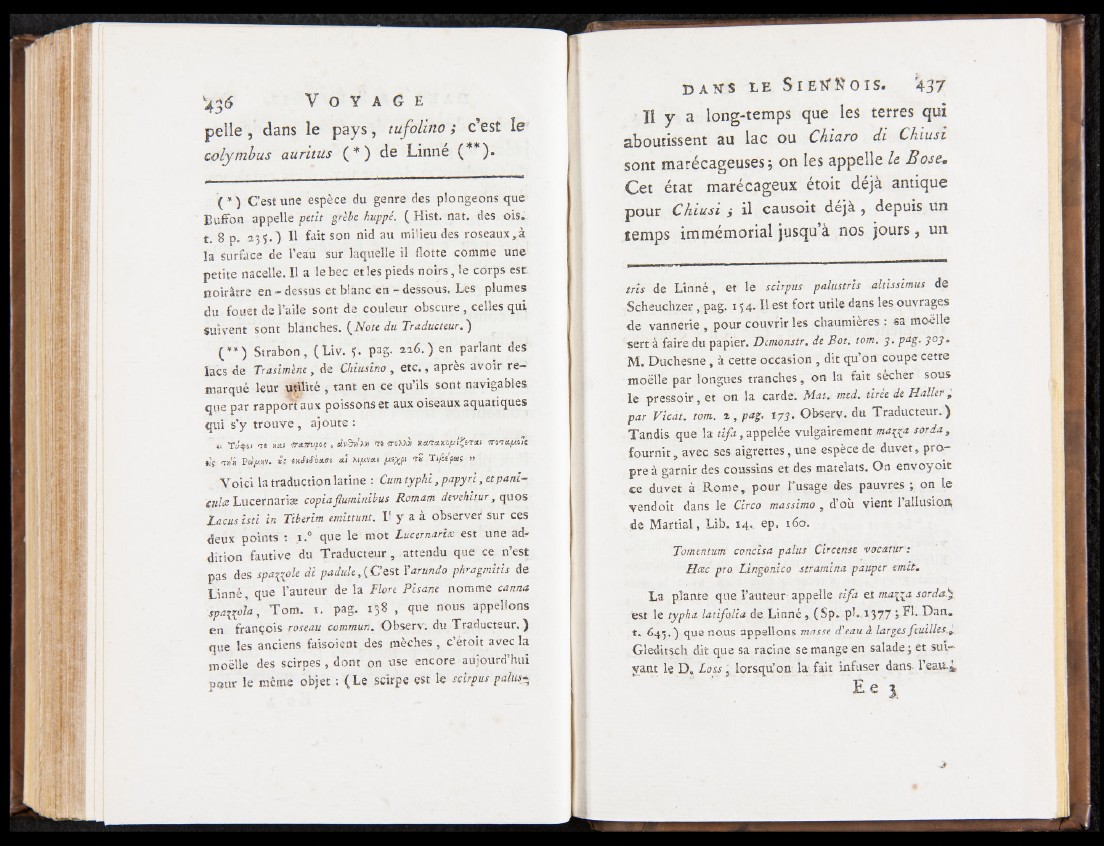
"4 3 6 V o y a g e
pelle , dans le p a ys , tufolino ; c’est le
colymbus auritüs ( * ) de Linné (**)•
(* ) C’est une espèce du genre des plongeons que
Buffon appelle petit grèbe huppé. ( Hist. nat. des ois.
t. 8 p. 2,35. ) Il fait son nid au milieu des roseaux,à
la surface de l’eau sur laquelle il flotte comme une
petite nacelle. Il a le bec et les pieds noirs, le corps est
noirâtre en - dessus et blanc en - dessous. Les plumes
du fouet de l’aile sont de couleur obscure, celles qui
suivent sont blanches. (Note du Traducteur. )
(**) Strabon, (Liv. 5. pag. 2.26.) en parlant des
lacs de Trasimène, de Chiusino , etc., apres avoir remarqué
leur utilité , tant en ce qu’ils sont navigables
que par rapport aux poissons et aux oiseaux aquatiques
qui s’y trouvé, ajoute:
« Tt!<pe» »«f w*ifv(oç j « vSd'm tri, a-oM.» s.arra.my.lÇi'nti nmct/Aoît
il; t «’« Pci^usv. *£ ex.J'iJ'oxo’i ctt f^Xf1 ™ Ti/ ispais »
Voici la traduction latine : Cum ty p h i , p a p y r i , et p u n i-
culce Lucernariæ copia flum im b u s R om a n d eveh itur , quos
L a cu s i s t i in Tiberim emittunt. I! y a à observer* sur ces
deux points : i.° que le mot Lucernarice est une addition
fautive du Traducteur , attendu que ce n’est
pas des sp a ^ o le d i p a d u l e , { C &St Yarundo p hragmitis de
Linné, que l’auteur de la Flore P isa n e nomme canna,
spaftola, Tom. i . pag. 138 , que nous appelions
en françois roseau commun. Observ: du Traducteur.)
que les anciens faisoient des mèches , c’étoit avec la
ynoëlle des scirpes , dont on use encore aujourd hui
pour le même objet : (Le scirpe est le sc irp u s p a lu s -
b a n s l e S i e NNo i s . 4 3 7
H y a long-temps que les terres qui
aboutissent au lac ou Chiaro di Ckiusi
sont marécageuses j on les appelle le B ose.
Cet état marécageux étoit déjà antique
pour Chiusi 3 il causoit déjà , depuis un
temps immémorial jusqu’à nos jours, un
tris de Linné, et le scirpus palustris altissimus de
Scheuchzer, pag. 15 4* H est f°rt uüle dans les ouvrages
de vannerie , pour couvrir les chaumières : sa moelle
sert à faire du papier. Dcmonstr. de Bot. tom. 3. pag. 303.
M. Duchesne, à cette occasion , dit qu’on coupe cette
moëlle par longues tranches, on la fait sécher sous
le pressoir, et on la carde'. Mat. med. tirée de Haller,
par vicat. tom. 2, pag. 173. Observ. du Traducteur.)
Tandis que la tifa, appelée vulgairement ma^a sorda,
fournit, avec ses aigrettes, une espèce de duvet, propre
à garnir des coussins et des matelats. On envoyoit
ce duvet à Rome, pour 1 usage des pauvres ; on le
vend oit dans le Circo massimo , d’où vient l’allusiou,
de Martial, Lib. 14. ep. 160.
Tomentum concîsa palus Circense vocatur :
Hczc pro Lingonico stramina pauper émit.
La plante que l’auteur appelle tifa et ma^a sorda
est le typha latifojia de Linné,(Sp. pi..1377; Fl. Dan.
t . 645.) que nous appelions masse d'eau à larges feuilles. 9
Gleditseh. dit que sa racine se mange en salade; et suivant
le D» Loss y lorsqu’on la fait infuser dans, l’eau.i