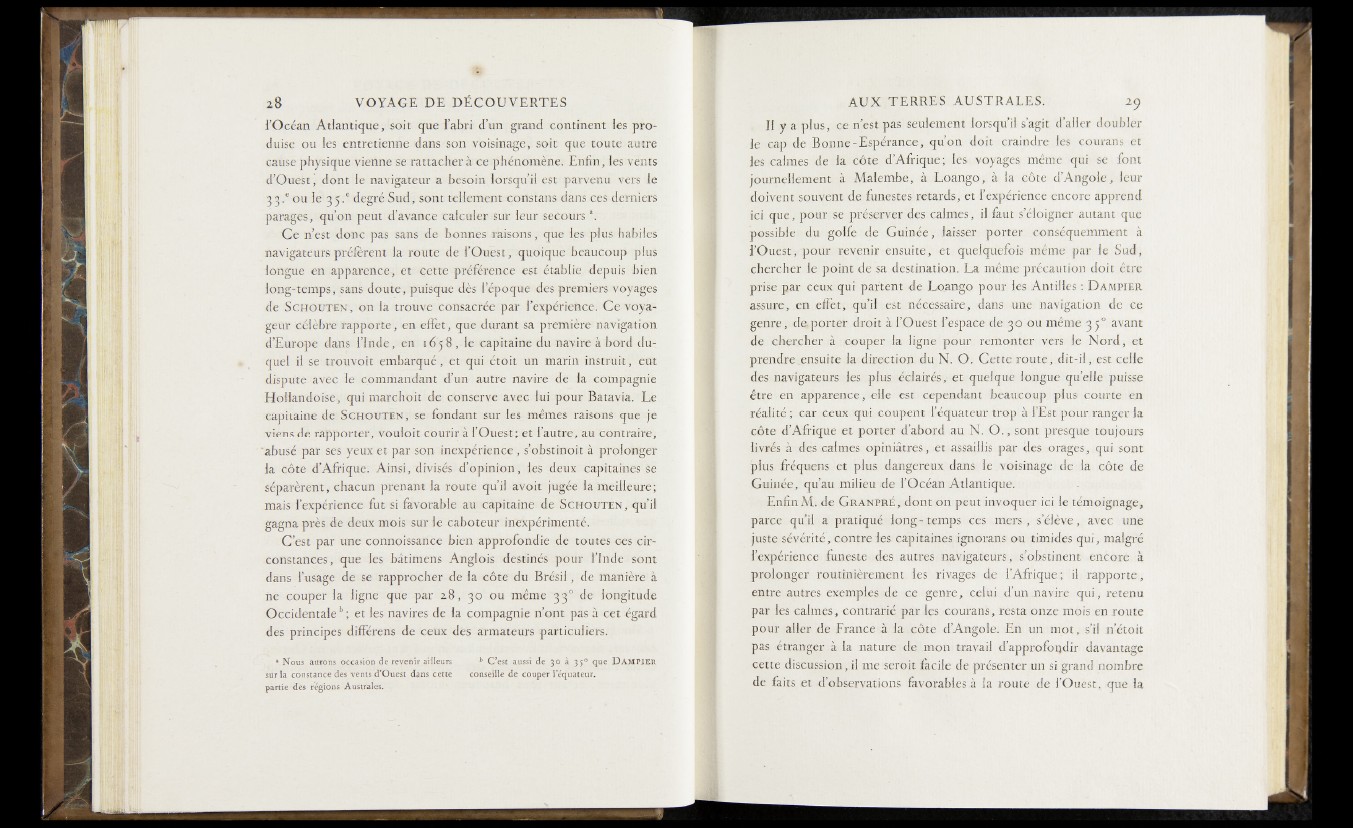
28
l’Océan Atlantique yis-oit- que l’abri d’un grand continent les produise
ou les entretienne dans son voisinage,, soit que toute;autre
cause physique vienne as rattadhter freeqâhénomène:
d’O u e k ; dont le navigateur a besoin lorsqu'il est parvenu vers ic
33.® ou le 3x f degré Sud, sont tellement-coiïstans dans ces derniers
parages ^ qu’on peut d’avance ^ie tlen isur leuraseèodrs'-*: :
. C e nfèst doae pats sansde bonnes raisons, que les -plus» habiles
navigateurs préfèrent la route-de l’Ouest y quoique .‘‘beaucoup piuâ
longue en fapparencep et-:uçettæ préférence est établie «dep-lis'bien
long-temps, sans doute jpuîsque dés IVpoqùteïdes premiersïVôyages
de ’ScnoirrEN:, on là trouve- consacrée par l’expérieùce. C e voyageur
Célèbre rapporte, en efièt, que dura-nt-sa première^navig#ti01i
d’Europe dans l’Inde, en ib^&jdfe’^capitaiiug du navirfe à.bord duquel
il se^tropvèit embarqué’v è t-qu i'é toit un marin instruit," ëift
^spilié avftb feicpmMîandant d’un- autre navire^'oîia^cômjMgni'e
Hfdfendoisei* rqui marchoit de conserve avec lui pour Batavia.
^capitaine de1 Sghou<ten fondant sur-les memes -raisons^q-uêiqê
ViièÉsdè rapporier, vouloit courir^l’Ouest; U l’autre, aû*bbter.iâ®|
"abusé par. yeifits©! par son inexpérience -, sfobstân'oiit à prolo:E^ef
la Côte d’Afrique. Ainsi, divisés^ d’opinion-, des deux-: capitëifaëgîii
séparèrent, chacun jnienant la féüSÉu qu’il avojtnjugé'e la meidègure-';
mais: l’expérience frit si favorable au capitainêavfelSd^oütÈn , ifû’id-
gagna -près-de deüx mois surde caboteur'-inexpérimenté. H
Gdst par une connoissancé bien-approfondie -de toutes c-es circonstances,
que les bâtimens Anglais destinés pour i’Indêpfeitik
dans l’usage de se 'rapprocher d o la-cote' du Brésil, de marëffèîStâ
ne couper la ligne que p&t-28, qô-Ou même de longitude
Occidentaleb ; et les navires de la compagnie n’ont pas à cet égard
des principes’ différens de éeïix dé$ armateurs particuliers.':
»Nous ajHons^àtâjmôndt revenir ailleurs b C’est aussi (Je 39 à 350 que D ampjer
sur la coni’tartc'e des jrents d’ouest. Sais cette conseille déijÿàupèr reijuatéur.
partie'des riion s Australes.
- Il y a plu^f& cernes tq>asi seulement iorsquvàs’agit d’aller doubler
le .catpde Bonne ^Espérance, qu’on doit-'craindre* Jes courans et
les calmes-de la ôârè/ d’Afrhjwe y ièskW^yjageq même - - font
journellement à Malembe, (àÆoàngo^'à la-^ète d’A ngoie, leur
doiventisoiivent dé, frmestesi-retards, et l’expérience-encore apprend
ici que, pour-se pré.^|ÿvqr||es:calmes, i f fautsiçloigner.autant que
possible dwtgolfè de Guinée y.ifeser' -porter: conséquemment à
quelquefois' meme par le Sud,
^herche^ip' ppinti diÈ-a^esrinatiom La mêrqe'’précàiitron doit être
prise par cerné qui partent dq)To.ango pouri fes-Antilles : D ampier
assure, .C-nudFejÉVquil ^tîmeè^afre.* -dan^.-une- navigation de ce
genre remporter .droit àricQues t*bespafcpdje%|4 'ou^êÉpld<|^javant
de, ^bercheji®ttp®-mpM ^--I?gifblp^;ùr4rrertioii'iiêrî{V'ers.'''fo ;Nîôrd, et
prencbe^ensiuite-ila'd-irection du;Ni Og Cette,route, ditrdvesi celle
desmavigatreurs iles.’jplus ecJairésv-et quelque - fon^ue 'qu die .puisse
être ebï-appaisoejeia/ eHe^fejb^pmdant IbeaM^î^p■ piûSffcoBrie en
réaIrtétàk©a|ï3^uxqqsuiii!eQU,pent7iiéqiüateiar lmplà4*Est§ps>nr. ranger- la
cotte d’Afrique <et porternfabord 'aqjJhl., O . ^taonn presque toujours
Irviés à:dés,ffialopiniâtresi,yetiersajl 1 ijsÿipaprj-çjes • »orages, ,qui sont
plufÿ^'iqïàfigns leé* ipln5bsiVcknge'pe|ix; dans- fo^rM'ismagejsrfè;-ia, note de
<3n$ijnf|g$ qu’au .mihéu ide i’Oeéan-Atianti.q;ueÿî?t;xi „svA . i#*
de G®1 aïc^îeé^ dofrj-idmpeut invoquerviei le témoignage',
parce,, qu’il ,a’ prajiqué^long.-.nempsK^èl^-H^Bsà^^iè'W,; avec "3une
|.uste,^ëÿité^t^i^te.'fos'c^itames|^ms>Eans'ou rinnièips qui,
l’expérience. frme&te, des ,auifee$ navi^Me’ut-k/âdoibfrinêriLt^ -encore. 'â
prolonger rouùinfèmîn'entySélsài^a^fïl^s«l’Afrique ; ilf rapporte ;
enitre5ia3nMr.es exemp-lesjde iOfi^pnrie* tcelîui d’unmavipe qui retenu
par- les-calmes-, contrarié par IçsâerHÆrans, restatonze méislenjro.ute
pour aller de Erance-à Jaéi|ela.fe:-diAngoleriEiîi‘un,5motv-s’il métoit
pas «étranger .à la nature ldblmjàf£ttraMaH:d’appr.ofopdinvdavantage
cette disriatssion, il me seroifeüPacile de prçï'enier -un si grand jnombre
dé faits. e ^ d ’ri^eryatiQns- -làvoiabfèsiaà-: la route «.de f Ombsi,. q u e la