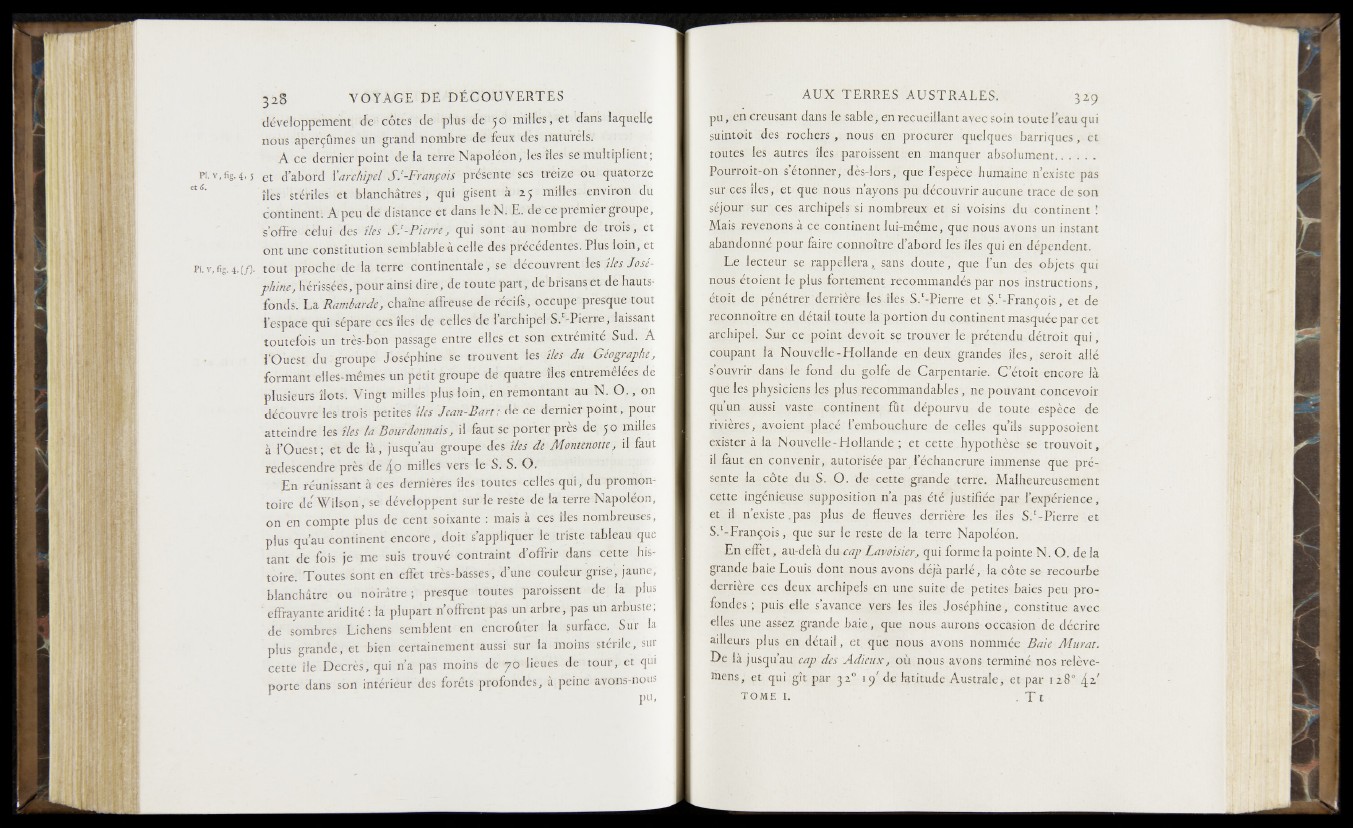
développementinie*5 dans'îaqstasslîc
nous -àpef^ûràie^ un graM nombrêfdfeWèuk'^ $
A ce dernier j>oint 'de là terré Napoléon, Ies>MeshsO multiplient;
pi. v, fig. 4,5 et d’abord Y archipel S .*-François présente! ses treizé'-Ou quatorze
îteséstériles ‘-‘et blanchâtres-; qui g isen t‘àMi 5 mrlIfesv-en^ïEOnHSti
continent’ A'peu de distance'W dansIe.NüE. de cepremief#©upe,
's’offre -céiuf'des îte^&^Fierné'; qui som du-nombre d e 2 tA | | é t
Cuit une c<^tîtntio^semblal)l^^ife dfeÈ'pèdié’édentes. PI#sdoih, et
Pi.v,fig.4,(/). tout ‘pÿO&hê®de la terre dontinentalëy'^toéc'ouvrentsles^^s. Joséphine,
héfé^>îPour ainsi dire,d e toute part, die'bri^nqétûdéiia'uts-
foüds: La,- S ^ a ^ i - c t o î t ie ^ f t e u s e de récifs ^HW^preSque Mut
l’espacé quisépare oeSdfesdé ©elles"de iar(3hipe4"S.t-Pieri|e.';dKissant
toutefois un très-bon pâfeâgë entËd'eI^èy4trSQn^exteéna^i^éISifa,; A
l’Ouest' du :groupe Joséphine Se trouvent les jjg|| du 'léÿéeÿt&fhe,
formant elles-mèmés un pétît groupe dé qnatre^iéS'.êntr.erneJ'ées. de
plusieurs îlotsl Vingt milles pi us loin,, émrémontant -amM. O ./ o n
découvre les trois petites \ks Jtan-Ban: dè’de dernier pojnfc,* jbur
^atteindre les 'îles la Bôurdonndis^\\ ffutîfë-port-er près dé'pfo milles
à l’Ouest; e t de là , jusqu’au groupe'dfesdfe dé Monfenotlé} défaut
redescendre- près d e 4© m illes - vèrS'dé' rî
| |En réunissant à ces dernlèrdslfànoüte^cefleS qüiv dü^rorÉôn-
toke de Wilson, se^ développent sur le reste d e k-tferre-tNapnèlon,
on en compte plus de cent soixante ; mais à cesrles nombro#es,
plus qu’au continent encore, doitt s’appliquer ïë triste: tableau que
tant de fois je me suis trouvé contraint d'offrir dans Jcltte Rfi-
toke:'Toutes Sont en Æ t très-basses; d’une- cOûieur-^is'eyj&tmè,
blanchâtre ou nondcre; presque toutes paro-issem>de; la folus
; effrayante aridité : la plupart ne>ffrent*pas un arbre, pas un arbuste;
de sombres Lichens semblent'en encroûter la surface. Sur fa
plus grande, et bien certainement'aussi'.sur' la ■ moins: stérile;«sur
cette île Decrès, qui n’a pas moins dé 70 lieues. de tour,, et q©
porte dans son intérieur des forets profondes, à peine avons-nous
pu
pu pén.creusant dans 'te.sable-, entrr^uqH'lant avec soin toute l’eau qui
sûfnt'QÜt de^sroch^ip«,; n o^ ^ 'p ifo ^ ù r e r quelques barriques-,'-et
touüesjdè§ ; autres1 ,rlesHparoissf^t een manquer absolument. ; . . . .
P^roitrion jÿe^ner,;|ÿèsr,14rs^f que' f espèce huiriaine n’existe pas
sundesiîliés.îjdlëtî‘ trace de son
nombre ur|qtpsà|y©isins*' du continent !
Mai§ .reyeno^%à;^p;pntinent;dù^^(ç4;,quempus avops. un instant
abaüdonp^pour fadé|do^p9Î%ej d’àbqrm^^e^lèsyi en dépendent.
Le ^Jçicteur setpapfpellerax sans «^foma/que l’un des,-objets qui
nous ^©^^JiejpluSlfortement rloemmandçd,par ,nos instructions ,
/dé. S^VErançoisjg et d e
r^oirmoltrq^p^dçjail. tq^tg-^a^poiti^rî du,continent; masquée par-cet
a|gHpeLSn-ra^point de.vOfdseftroiiyàr le-puétendu détroit qui,
coupant là ^ipyëHffj^pMande en- deux; grandes?jles, ;seroit allé
» ^ i^dans^le^fend d u g^ff^-de G^pentarie^^C’étoitfencore là
qmàle^pLvsl^Bg^^i^^recommamdab^rne pouvant concevoir
qu’un^a^ssi^as-f-edco!nt inent ‘fût jd^pourvu' dp toute ^espèpe^de
rivlk q s c^y^iéijt ;placé l’embojjp'hiy^ de;Æelle,s^qu’%jisupposoient
ed jte rd la Hollande,; et cette.hypothèse*se trouvoit*
il faut ten conve^ùo- autorisée ipar^l-ecbancruEe immense que prés
sqj$fte laM^te du||; O. de. cette:.gr^de^erçe.. Malheureusement
c0t,e-ingénieuse -supposition n’a pas é té u$tifjéeopar l’expérience ,
eiC il n’existé'xpas-; plus -d e fleuves derrière-les dles- S*L Pierre ; et
S.’nPranç-qi^ que sur le reste de-la* terre Napoléon-. .
- Enjeffet., aydelà dutcap-Lavoisier, qui forme la pointe N. G. dé la
grande baie^Louis dont nous avons déjà parlé, laysôte se recourbe
derrière ,çefs ^eux archipels en u,ne suite de petites.baies peu profondes;
puis,elle, s’avance vers les îles Joséphine-;, constitue avec
elles une assez grande baie^ que nous aurons- ocbàsion de décrire
ailleurs plus en détail, et que nous avons nommée Baie Murat.
De là jusqu’au cap.des Adieux, où I nous avons terminé nos relève-
biens, çt qui gît par 3 %?-19’ de latitude Australe i et par 128° 42.'
- tome 1. . T t