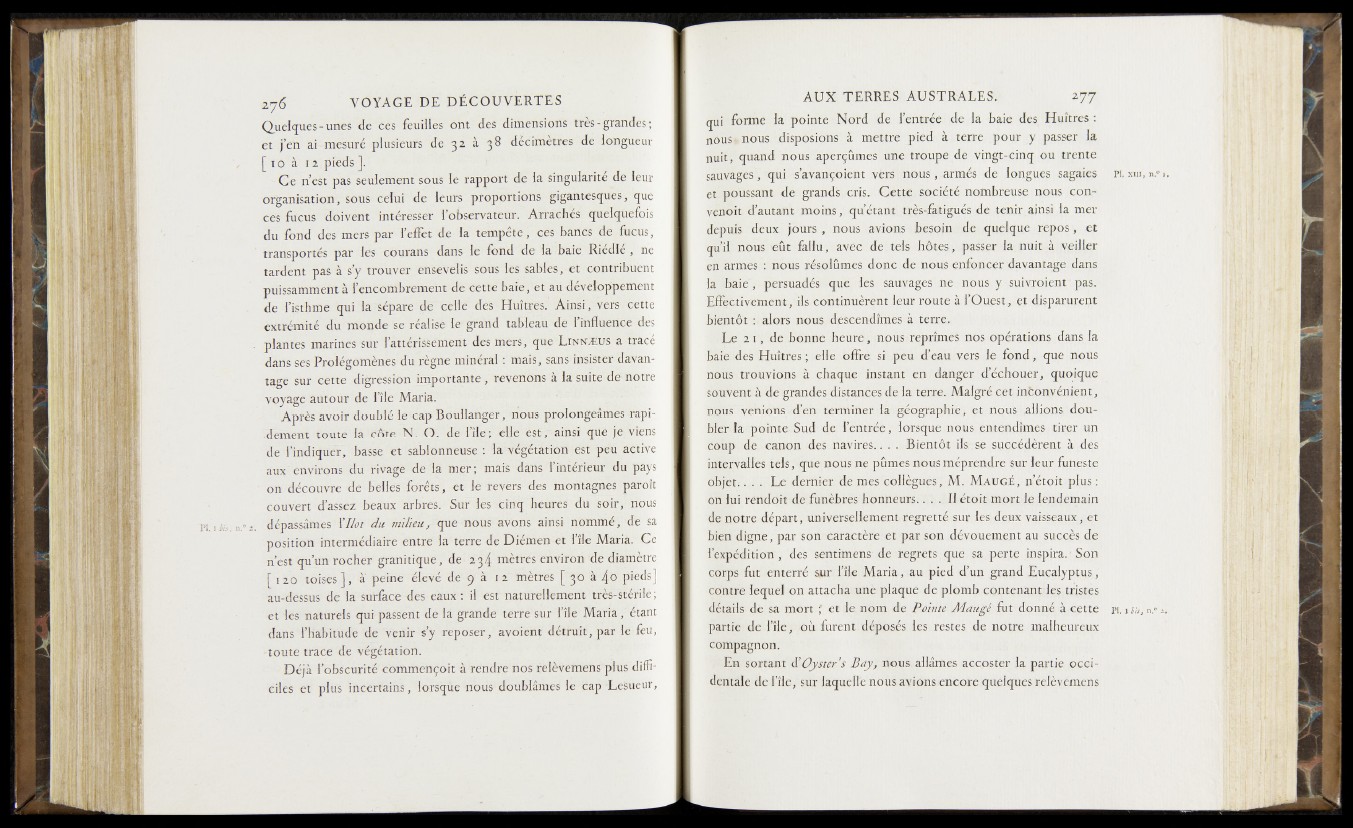
Quelques-unes fe u il^ o n t* d è f ;
et if eh aî~mésifré splusïeurs "de 32 à 38 déeiïdètres' dfe4 oi|gUeur
{ i ô ’ à 12 piè<fè_]d
C e nest pas seulementsôîÉHe rapport de la singularité jde li&r
organisation^ sous cefui de leurs proportions-> gigâfttésques-, que
6is fucus doivent i^ ^ ^ ^ r^ o ts e rv à tèû r . Àérâ&tfsf qüét^tefôis
du fond des'mers par'TefFet de la tempête, ‘,'^ ¥ an c s de fùcj^s,
transportes par le‘s côurans dans le fond de -la baie Riedie , ne
tafdènt^pats à s?y trouver eriseVeli#^^s^fe safelé%-et>‘fe"©^tlib^nt
puissamment à l’encombrement ;def«|§t‘té bàîepét au développement
de -1’istl.ime qui lâ'sépare dê^Yellé* d^H u ît^ fe l Ainsi p-Vers#e^tté
extrémité du monde se réalisé le grand tableau ÿ l l’inflâf'tfêl>d£S
plantes mârinïilur l’attYrissé-ment! Ifes mefsN%tre ‘L i^N^us-'^kcé
dans sê§ Prolégomènes du règne minéral fm-raîs, SâÛs5fefi^tàlef davantage
sur- cette digression imp ortanteV%evenbns à là-suite d#|f|;tre
vpyageoautour de l’île Maria, v
Après avoir doublé le*cap Boullanger, nous prolongëâmes -ràpi-
.dement tome la Côte N. O. de l’île; êlfe^estf- ainsi ‘'que j ÿ $ h i
de findiquer^^bâsse et sablonneuse : lâ^ ^ è ta t lb ^ |ë § P ^ ^ ^ â « |
aux'envirbÊs du rivage'de la mér; mais ^ ^ s wys
-bti découvre -tfê be!fés'foéê% le 'revers des monYagngs^âïoît
1 couvert d’aSséz ^béaux arbres. Sur iM^cinq héûrès du s©5r, npus
dépassâmes Yllordu m ilie tique nous av'ons ainsi momméV'Tl-' sa
position intermédiaire ' Ofitré-laHérre de DtéméWet i’Me Maria. Æe
nest qu’un rochèn granitique', de* 2-34 mètres0nvirbri J3ê Ütokiètre
-£’120 toisés ] , à* peine élevé de 9?'à -i^metrë ê ’ f 30 % ’^^OTffls]
au-dessus de la surface des eaux : il est naturellement' ’treS-stérile ;
et *lés naturels qui passent de la grande terre sur l’île MariaPétant
dans T habitude de venir s’y reposer, ayoient détruit, par le feu,
-toute tràée de végétation.
Déjà l’obscurité commençoit àkëndre nos félèvemens'plus diffi-
eiles et plus incertains, lorsque-nous doublâmes le cap'Lesùeur,
qui forme là poihïè#Iîëjtd de l’entréefe)de ; la baie des Huîtres :
n^ùs^noüs^;d‘ispoSfcpis' jà mèfffere piçd à^terre _pour^y passer la
nU®|fquand Wilts;lapçn|i4m^^-|lne troupe d^^yiiigt-itiipqdÔ11 ■ p'ente
sausüÉges , qui balançaient
eUfoSussahtTde-, grands|B|||
vCnoit doutant moins ,;;qpet^nt^^^a^g^és<do^|f|?i.ajn^tla mer
depuis d:eux. jîëiirs ,hn;©ü$ fævio#'’iÀ>éso7n <d.eoqpejqy,e repps Vï >et
q f il nousWht fallu Vf a^lb ? d è t f è l 'ih ^ lypilier
enê^tnes : bfvias^W ^ lim es -donc de ri|||s^fnfoftc’er daya^tagplgans
la ïbaieV-persuûiflfli q ^ i^'■ ;sa'lnngc-S!^fl^■ ^np^jl^«llU^®^e^yt', pas.
Dl&cti\ e m e n-t,Sid'S^I)htinùèrènt leur roumi^ ^ ^ k t i^ ^ p j^ u r e n t
bientôt ■ : ^ al»s-iW^n&;.Wékeén^-màès * à terre,.s
Le 2 1 , de bénn^léllplimpmsbreprlmilf^Ô^Opérati^sj^da^lp.
bâîe.:desS T u k r o * oifrê sfbpeu d’ea&^W§ÿgW0'nd, qypjppks
nous trouVïO^à chaque? instant en edàng l& djechouer, quoique
s^¥e®tiàdétgrandeâ4lfîs4Sicè^ de la»ter|ebMaîgf^'cetinî;c)ip^i|nt,
nOUs ^rnîêbs '/d’en. ’Woniner la^ge'g^paphie.) çt- n^ùs,ljalMo3l%^dpu-
bfèr la po initè^Sudi ^eîflénBÉ^eÿdorsque tirer up
coup 'de canon #è|pmàvireS.. . . Bient.ôtjil^Sfe^sU^G'édîlf^fî à ;des
intervallesjüeis, -que nopSme.pûmesmOuvpWprenglre sur leur funqste'
cÉjet:'. dernier d,e me^@If^gU|^,-. M. MAn&É(f?-n’éto11 p l^
ôlrdù f r Iridoit-dé funèbués honnéuBS.W . Tl étok mortjlqijê^emain
de,n0treVdépàrt^iuni-versellementi®egrettp’^u|!f4èsbdenx 'Vaîsseaiîxt, qt
bien digne, par îsMjcarapfcèfe^ét par s®é idévoiuemmt auWMi&ils d|è|
l’exp^dk-iOn, dsèS"sèntimens..d;e regrets,q.uOî|a^f)%t|\^^ir^.|^p|i
cotp's fut enterré s*ir Oie.Maria, au pied d’un .grand^uCaWntjjiS,,
coWre lequel -on attacha unè plaque <de plomb contçnaiatfl^Sjtrjstçs
-détàils de sa mort ' et de, nom de Pointe iMaugé, fut doniîé^àiÇette
partie* de l’île j OÙ< furent^'déposés des^jéstes'de notre malheureux:
compagnon.
En sortant & Oyster’s Bay'; nousvaüâmes a ëè^ter la partie* .occidentals
de l’île, sür laquelle nous.avions encore quelques relèyémens
PI. XIII,
Pi. 1 lia