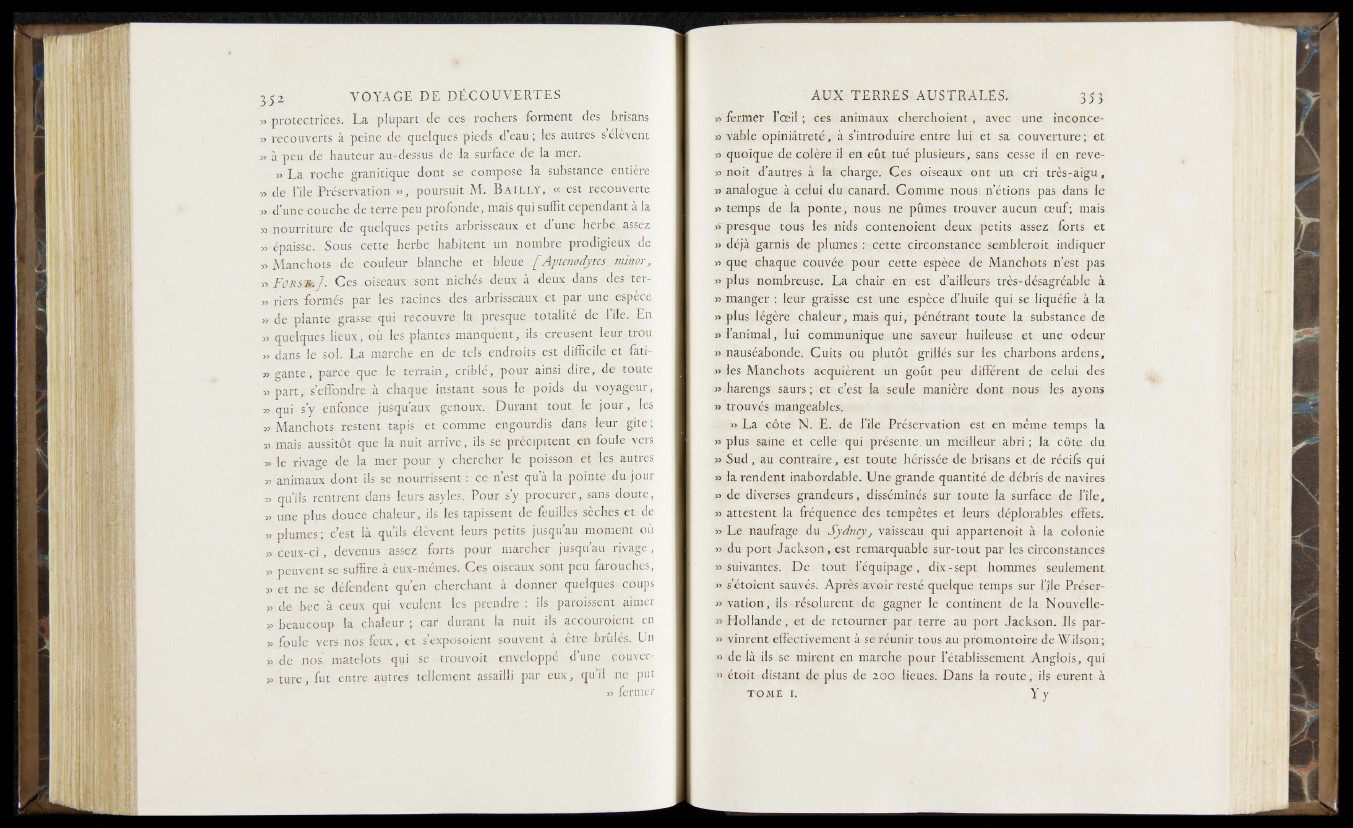
« protectrices. La plupart de.- ces-, rochers. forment des.;ffi$sah5
« recouverts à peine de quelques pieds - d’eau ;des autres s’élèvent
» à peu de hauteur, au-dessus .de la surface de la mer,
« L a roche granitique dont -.se compose* la-substance entière
« de l’île Préservation » , poursuit M.. B a i l l y , ^ e s t recouverte
»• d’une,.couche ,de terre peu profonde -, mais qui suffit cependant a la
« nourriture de quelques petits;,arbrisseaux et dune herhe^p^sez
«épaisse. Sous-cette-herbe habitent un nombre- pr'odigieùx |jp
« Manchots de couleur blanche -et -bleue - [Aytençdytis^nn-qr,
\»<FoRsm]-ïQe&~oiseaux -sont nichés deux à.dêuxrdaus, de^.ter-
« riers formés par les racines,; des-., arbrisseaux x t par .une espèce
».de plante grasse qui recouvre, la, presque.-, totalité de. l’île- En
» quelques. Heux, où. tes plantesijnanquent ^ffipereusent leur .tr.au
« dans le sol. La marche eh de te l s - e n d r q i l^ t^ ^ f ^ ^ ^ ^ati~
«-gante-, parce,que le terrain, criblé, pour, ainsi dire, de,to|.te
» part, s’effondre à chaque insjtant -$ops, le poids.- du voyageur,
» qui; s’y. Enfonce > jusqu’aux genoux. Durant rput le .jo u r, |e s
« Manchots restent tapis, -et. comme ^ogom^^^a^^leurjF^te ;
r«osais-aussitôt que la nuit arrive jùk- se„ précipitent ,,ep foul^ws.
» le rivage de la mer pour, 5y chercher le îpi^ss<in^et les aulnes
»^animaux dont ils fe >nourrfesehîBr çérnest qu-a laMp.ointe,idjt-jpur
•I* qu’ils rentrent dans leurs asyfesL’Pour procurgc^sans. do^te,
une plus doucè ghaleur, ils les' tapissent de feuili§|f|dôb^^tBe
» plumes ; c’est là qu’ils élèvent, leurs petits, jusqu’au mojnçniBi
« xeux-ej, devenus assez forts pour marcher jusqu’au rivage ,
« peuvent se suffire à eux-mêmes. Ces oiseaux sont peu fprÔf elfes,
? et ne &e. défendent qu’en cherchant à donner quelqüès,^|p^p^
»; de .bec à.ceux qui veulent . les prendre : ils paroissent' aimer
»".beaucoup la chaleur ; car .durant la nuit ils accouioieiit en
« foule vers nos feux, et s’exposoient souvent à être brûlés. Un
« de nosb matelots qui . se -trouvoit enveloppé d’une: çouver-
« ture, fut. entre autres tellement assailli par eux, qu’il ne put
1111 .fermer
»' fermer dPeéil ; xes - animaux cherchoient ; Avec ? une inconce-
éjyable opiffiffiis^pè# à. ^introduire! entre ..lui; et sa' couverture g et
» quoique de colère?il en eut- tué plusieurs; sans cesse il en reve-
«moit d’autres1 à la^chargea Ces »oiseaux -ont un cri. trèsfaigu,
»•analogue» à celui duacanard..-Comme nous, n’étions pas dans le
« temps de la ponte, nous me pûmes/.trouver aucun, oeuf; mais
»-presque tous les nids contenoient deux,petits assez forts et
» déjà garnis, de plumes : cette çrrcônstançe. semblerait indiquer
«quç chaque’ couvée, pour* cette-espèce de' Manchots n’eètîpas
» plus nombreuse. La chair en: es;t| d’ailfeurs très-désagréable à
-»gmanger : leur g ra is s en t unep,§spè,ce d’huile qui se liquéfie ; à la
.»•plus’ légè-fsêfchaleur, mais qui; pénév^htvipu*V la substance» de
» l’animal, lui commührquep,une■ ;saveur huileuse, eC une odpur
»-nauséabonde. Cuits, ou pffitôp (-.grillés sur les charbons ardens-,
»des Manchots acquièrent ùn goûr pekr .ffifferenp ,de celui des
».harengs’ saurs ;, et^ejest la .seule manière, dont nous» les -ayons
» trouvéàsmangeabJesÿ - j
» La côte- N;: Ev de laie Préservation! est- en même temps la
« piUS ' Saine et xellequipprésente. unt meilleur, abri $ ; la côte du
» Sud, au contraire,, est;t-oute .hérisséplde-brlsans et.de récifs qui
» la rendent inabordable. Une grande quantité ;d.e,débrfs tde navires
.» de diverses grandeurs » disséminés' sur toute la surface- de .l’île,
» attestent 4a fréquence des .tempêtes et leurs déplorablès effets.
» Le naufrage du Sydney, vaisseau qui appartenoit à la colonie
» du port Jackspn^-est remarquabiefsur-tjqut pardes circonstances
» -suivantes; De .toutsdléqffipage, dix-sept hommes seulement
»;s’éto:ient saufés. Après .avoir resté quelque temps sur l’jle Préser-
» Vation, il.s-vtésolurent * de gagner le continent de la Nouveile-
» Hollande, et cfe retournèr par terre au port Jackson. Ils par-
» vinrent effectivement à sejréunir |qsùs au promontoire de Wilson
» de là ils se mirent en marche pour l’établissement Anglois, qui
» étoit distant de plus de zQÔaiiçues. Dans la route, ils eurent à
TOMÉ f l - " .? Ÿy