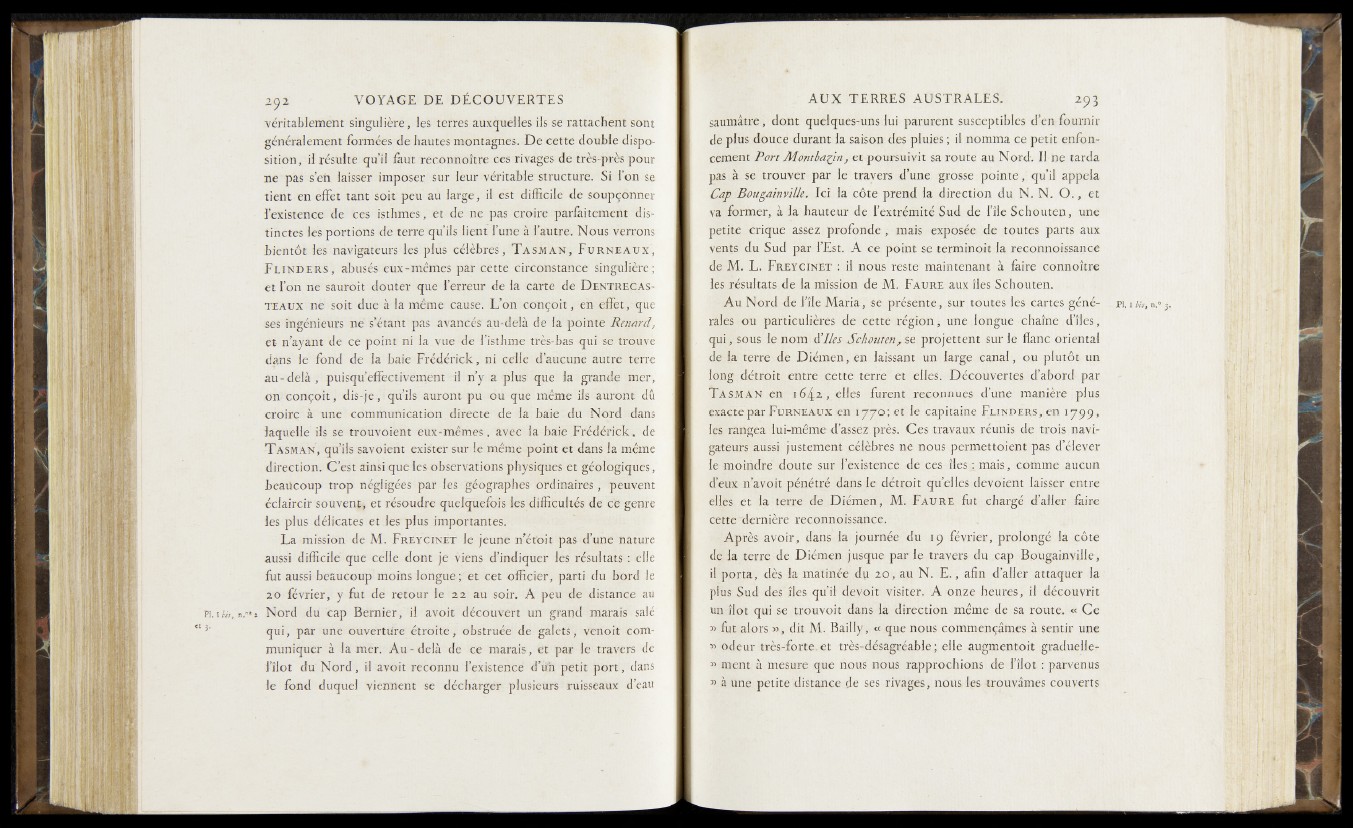
véritablement singulière, le&'teïres auxquelles-ils, se ta tta c h e n tlö n t
général eraent formées de hautes montagnes. -De cette double déposition,
ilré s è lte q u ’il fauît Teconnoître‘oessrivages-de très-priès ipo urne
pas s’eii laisser imposer'sur leur véritaMè*structure. fSMfoh s&
tient-en effet tant so it peu au large j/il est difficile de soupçonner
J’eXistence dé^eisrfsiàmes-,'ét'de me pas croire parfaitement Hp-
tinctes lesipbftfôns d e 't^ ê '^ u ils lient l’une àdfautre. Mous-verrons
bientôt les navigateurs‘les plus, célèbres ; ‘T a sm a*n , Ftjrneajüx ,
F l in d e r s , abusés eux-mêmes p a r o t t e circonstance* singulière;
et l’on ne sauroit douter que l’erreur de la carte de D entre^as-
teaux ndiSôit'due à la même cause. L'on co n ço it, e n ^ fe t^ tjü e
ses ingénieurs ne' s’étant pas avancée-âu-delà de la pointe Renard,
e t n’aÿarit de cë ’point ni la vue-de l’isthme très^Bas squi se trouve
dans le fond de là baie Frederick, ni celle d’aucune autrêMferre
au-delà , puisqmeffectiÿementdl lïyna plusuque la grande-/per,
o n ’ c o n ço it, dis-je, ‘ qu’ils auront pu d u que même ils au ro n t dû
eéôiPé à une communication directe de la baie du ‘Nordîsians
laquelle ils se troüvoient eux-mêmes, àvéesUa baie'Fre'dérick|^de
T asman, qiTils savoient exister sur le même-point et dans la même
direction. C ’est ainsi queles observations physiques fet géoibgiq&es,
beatfcôüp tro p û%lfgéèspar les géographes ’ordinaïrds', p é d a n t
éclaircir so u v en t et résoudre quelquefois les difficultés de C^gepre
les plus délicates et les* plus importantes'/:??
La -misstonde M'. FreycÏnêt le jeune n’éfoit pas;d’une nature
aussi difficié qùë celle dont je viens d’indiquer lès" /esultats^ôelle
fut aussi beaucoup moins lo n g u e e t- c e t officier, parti du bord le
io rfé v tie ri ÿ bit de re to u r le "22 au soir. A peu tfe distance au
a Nord d u cap fiemier, il avoit"découvert un grand'marais pâlé
qui, par une ouverture é tro ite , obstruée* de gaieté/ vënoit communiquer
à la mer. A u -d e là de ce marais, et par le travers dé
« lo t d u N o rd , 1 avôit reconnu l’existërtcê d’tSi petit p b r t, ' | 0b$
le fond duquel viennent se décharger plusieurs ruisseaux d’eau
saumâtre , dont quelqûes’iuns lui parurent susjseptibles d’en-fournir
de.plus douce durant la saison d.e§ pluies ; ilsnomma ce petit enfon.-
cement Port Montba<dn, etpourspivit sa roule au Nord. Il ne tarda
pas à '•$& trouver-par le1 travers' d ’une'.grosse p o in te /q u il appela
Cap Bougmnviüe. Ici la côté, prend la direction du N. N. O . , et
vâ* former, à :fa hauteur de l’extrémité."Sud ,de fîle*§chouten, une
petite „ crique assez.- profonde Rimais exposée. /fojfcou&es parts aux
vençs du Sud par- l’Est,. A, 'dès pdinfVsë rerminotitla. reconnoissance
<jpM. L. Freycinet : il riou£rfj|^£e' maintenant nüfoirç^éonnoître
1 espj3sultats.de la nrfffion de M. Fâ#J^sated|es>®j^^dten. - -
de 1-île,Maria, se p té p ^ fe , ,f|tâdl^3|esdés$ëajrtes)gdn©j
râlés/on particulières dé ’Getté'iré^bpSfîune longue chaîne d’îfesjjj.
quMssjOusdejnûna d’/Z^s» Schdufeti^^^bq\è^^viti^3: ie flanc Oriental
<|f ja terre de D iém e n ,é n laissant/pn la r g e d c a h a lp lu to ty u m
long, détroit entretÉetae terfs?*et”' ê i i ® u v e r t ef- par
T-AS.MA;N#:eèi.f- -elles furent/recoiifttu^vd’unei manièréfspl.us
e^actë^parEuRNtAwX-en i ^ à B e t lé ^ ip ftb ifeF ^ iN B Ê ^ /è n ï^g’ÿc,
lès/rangea lui-même rf'assêz. .travaux ,réuni§de|»)% navigateurs
aussii justement céipbrés nëm<&ji|. pepméttoiept;|Fàs d’^ever
le-moindre" doute sur l’ê-xistence de’ces^desi^majs ,-'comme ..aucun
d’eux n’avQft-pénétré dans le *det£pit quelles deyojent laisser entre
eUM. eM a ’terre de* Dienapn', M. Faure fut;chargé d’aller -foire
ceîtfe'dernièré rëconnoissance.
Âp ris/av o ir, dans-,1a jôurnée/flu déyr|er, ;prpl|o,ng|/la -côte
défia .terre-de Diém^n jusque par le-,traversu<4iu..>cap Bougainville,
ilp p rta , dès la matinée dy 2uoj au N. E . , afin d’aller’attaquer la
|îlps?Sud' dfes*ji,es qu’il ‘ devoir visiter. A ^nz,effieurés^il découvrit
un îlot qui seïtrouvort dajfoda direction finême de sa route/'« .Qe-
53 fut alors,», dit M. B ailly ^ t que nous^commençâinesfo.sentir un«
3’ odeur .t'rèsfîforte. et très-désàgréab 1 e,/„elle augmentoit igraduelle-
33.ment à.mesure que nous nous rapprochions de l’Mot': parvenus
33 à une petite distance de ses rivages, ndusrfp-s -trouvâmes couvert^
n.itói