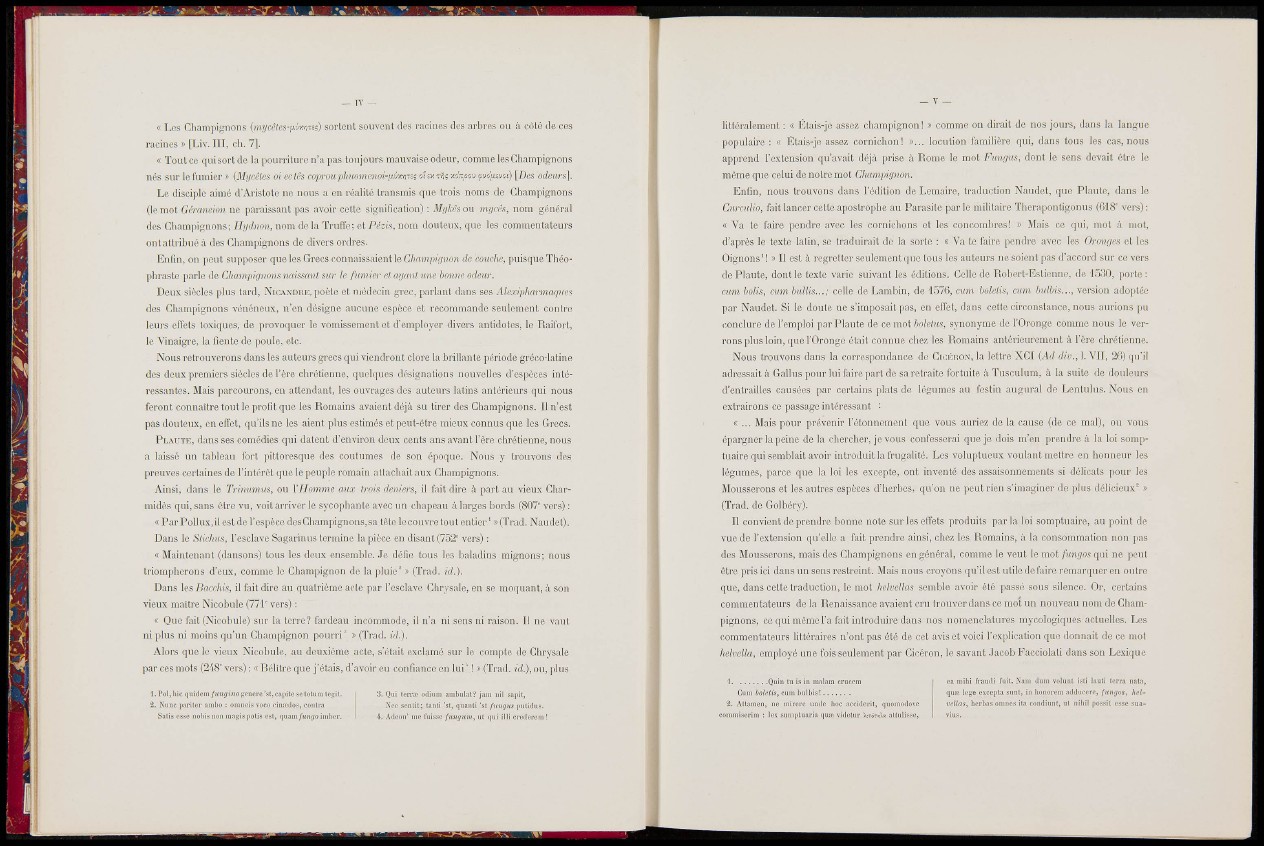
« Les Champignons {mycêias-ii-v-m-ii} sortent souvent des racines des arbres ou à cùLé de ces
racines » |Uv. ï l l , ch. 71.
« Toiilce quisortde Ja pourrilure n'a pas toujours mauvaise odeur, comme les Champignons
nés sur le fumier » {Mijcêtes oi ec tês coprou phuomenoi-!J-vy.ri"i oUv. ri? 'fvo'(j.£vci) [Des odeurs\
Le disciple aimé d'Arislole ne nous a en réalité transmis que trois noms de Champignons
(h? mot GémnPÀav ne paraissant pas avoir cette signification) : Mijhês ou mycês, nom général
des Ciiampignons; Jludnon, nom delà ïruile; et Pézi.% nom douteux, que les commentateurs
ontatti'ibuéà des Champignons de divers ordres.
Enlîn, on peut sup])oser que les Grecs connaissaient le Champignon de coiiche, puisque Théophraste
parle de Champignons naissant sur le fumier et ayant une bonne odeur.
Deux siècles plus tard, Nicandre, poêle et médecin grec, parlant dans ses Alexipharmacpips
des Champignons vénéneux, n'en désigne aucune espèce et recommande seulement contre
leurs effets toxiques, de provoquer le vomissement et d'employer divers antidotes, le Raifort,
le Vinaigre, la fiente de poule, etc.
Nous retrouverons dans les auteurs grecs qui viendront clore la brillante période gréco-latine
des deux premiers siècles de l'ère chrétienne, quelques désignations nouvelles d'espèces intéressantes.
Mais parcourons, en attendant, les ouvrages des auteurs latins antérieurs qui nous
feront connaître tout le prollt que les Romains avaient déjà su tirer des Champignons. Il n'est
pas douteux, en eiTet, qu'ils ne les aient plus estimés et peut-être mieux connus que les Grecs.
Plaute, dims ses comédies qui datent d'environ deux cents ans avant l'ère chrétienne, nous
a laissé un tableau fort pittoresque des coutumes de son époque. Nous y trouvons des.
preuves certaines de l'intcrôt que le peuple romain attachait aux Champignons.
Ainsi, dans le Trimmms, ou XHomme aux trois deniers, il fait dire à part au vieux Charmidès
qui, sans être vu, voit arriver le sycophante avec un chapeau à larges bords (807' vers) :
« Par Pollux, il est de l'espèce des Champignons, sa tête le couvre tout entier ^ » (Trad. Naudel).
Dans le Slichus, l'esclave Sagarinus termine la pièce en disant (752' vers) :
« Maintenant (dansons) tous les deux ensemble. Je défie tous les baladins mignons; nous
triompherons d'eux, comme le Champignon de la ]iluie'» (Trad. id.).
Dans les Bacchis, il fait dire au quatrième acte par l'esclave Chrysale, en se moquant, à son
vieux maître Nicobule (771" vers) :
« Que fait (Nicobule) sur la terre? fardeau incommode, il n'a ni sens ni raison. Il ne vaut
ni plus ni moins qu'un Champignon pourri' » (Trad. id.).
Alors que le vieux Nicobule, au deuxième acte, s'était exclamé sur le compte de Chrysale
par ces mots (218'vers) : «Rélltre que j'étais, d'avoir eu confiance en lui' ! » (Trad. ?'(i.),ou, plus
1. Pol,liic qtlidem fungi no i^cncre 'st, capite se lotuin teji
2. Nunc ¡ìarilei- ambo : onineisroco cinoitlos, centra
Salis esse nohis non magis polis est, qiiam fiaKjo imbe:
3. Qui Icrraì odium ambiiiat? jam nil sapit,
iicc sentii; Unii 'st, quanti 'si fungus pnlidus.
•i. Adeon' me fuisse fuiujum, ut ipii illi credercm !
littéralement : « Étais-je assez champignoni » comme on dirait de nos jours, dans la langue
poptilaire : « Étais-je assez cornichonl »... lociition familière qui, dans tous les cas, nous
apprend l'extension qu'avait déjà prise à Rome le mot Fungus, dont le sens devait être le
même que celui de notremot Champignon.
Enfin, nous trouvons dans l'édition de Lemaire, traduction Naudet, que Platite, dans le
Curculio, fait lancer celte apostrophe au Parasite par le militaire Therapontigonus ((>18° vers) :
« Va te faire pendre avec les cornichons et les concombres! » Mais ce qui, mol à mot,
d'après le texte latin, se traduirait de la sorte : « Va te faire pendre avec les Oronges et les
Oignons' ! » Il est à regretter seulement r|uc tous les auteurs ne soient pas d'accord sur ce vers
de Plante, dont le texte varie suivant les éditions. Celle de Robert-Estienne, de 1530, porte :
cum bolis, cum hullis...; celle de Lambin, de 1576, mm boletis, cum bulbis..., version adoptée
par Naudet. Si le doute ne s'imposait pas, en eilet, dans cette circonstance, nous aurions pu
conclure de l'emploi parPlaute de ce mot hoJeliis, synonyme de l'Oronge comme nous le verrons
plus loin, que l'Oronge était connue chez les Romains antérieurement à l'ère chrétienne.
Nous trouvons dans la correspondance de CioÉnoN, la lettre XCI {Ad div., 1. VII, 20) qu'il
adressait à Gallus pour lui faire part de saretraite fortuite à Tusculum, à la suite de douleurs
d'entrailles causées par certains plats de légumes au festin augurai de Lentulus. Nous en
extrairons ce passage intéressant ^
« ... Mais pour prévenir l'étonnement que vous auriez de la cause (de ce mal), ou vous
épargner la peine de la chercher, je vous confesserai que je dois m'en prendre à la loi sompluaire
qui semblait avoir introduit la frugalité. Les voluptueux voulant mettre en honneur les
légumes, parce que la loi les excepte, ont inventé des assaisonnements si délicats pour les
Mousserons et les autres espèces d'herbes, qu'on ne peut rien s'imaginer de plus délicieux" »
(Trad, de Golbéry).
Il convient de prendre bonne note sur les effets produits par la loi somptuaire, au point de
vue de l'extension qu'elle a fait prendre ainsi, chez les Romains, à la consommation non pas
des Mousserons, mais des Champignons en général, comme le veut le mot /¿m,(70s qui ne peut
être pris ici dans un sens restreint. Mais nous croyons qu'il est utile defaire remarquer en outre
que, dans cette traduction, le mot helveUas semble avoir été passé sous silence. Or, certains
commentateurs delà Renaissance avaient cru trouver dans ce mot un nouveau nom de Champignons,
ce cpii même l'a fait introduire dans nos nomenclatures mycologiques actuelles. Les
commentateurs littéraires n'ont pas été de cet avis et voici l'explication que donnait de ce mol
helvella, employé une fois seulement par Cicéron, le savant .lacob Facciolati dans son Lexique
1 Quin lu is in malam crucem
Cum boletis, cum bulbis!
2. Allamen, ne mirere nude hoc accident, quomedovc
. lex surapluaria quio videtiir ^aöml« altulisse.
ea mihi fraudi fuit. Nani dum volunt isti lauli lerra nata,
qufB lege excepta sunl, in lionorem adducere, funrjos, belvellas,
lierbasomnes ila condiunt, ut nibii possit osse sua