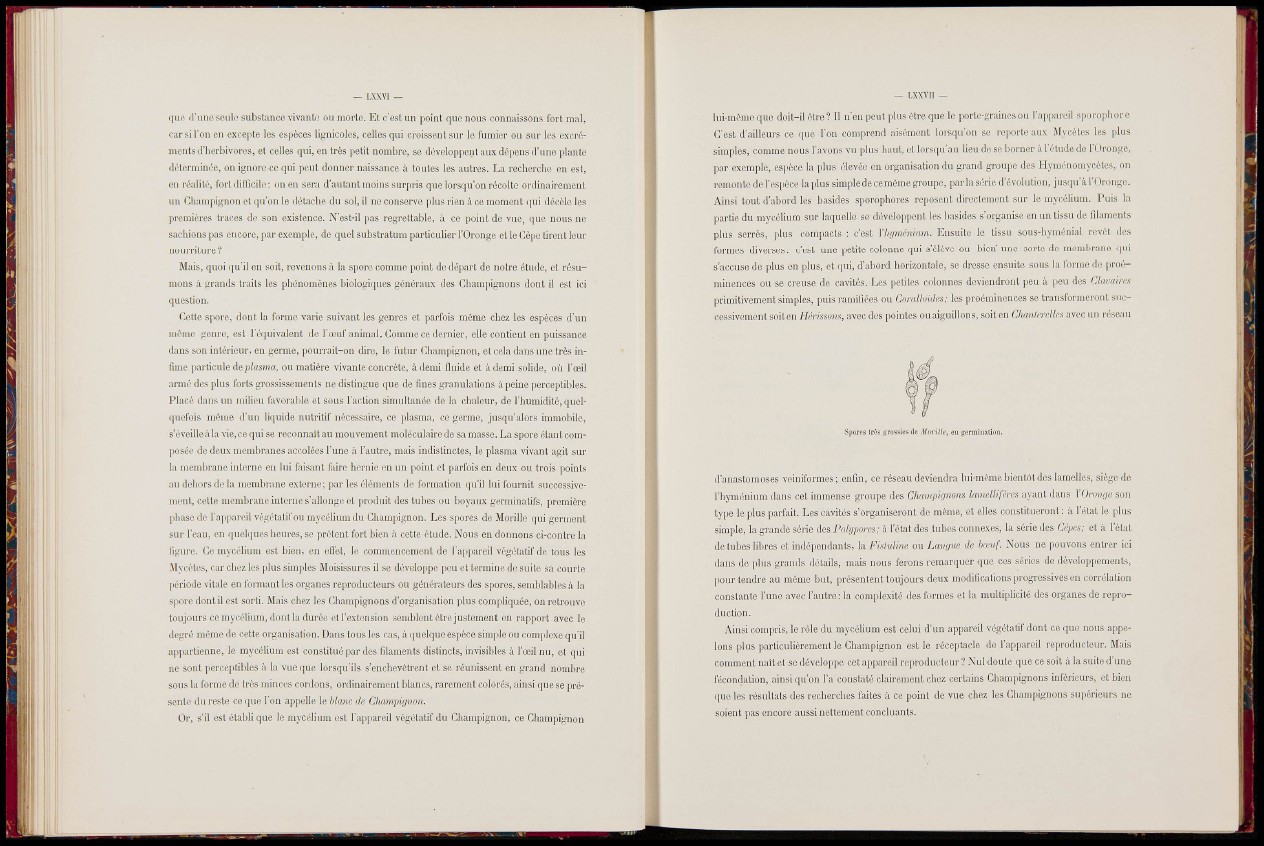
(]iio (l'une seulo subsUince vivante ou morie. Et. c'est, un point que. nous connaissons fort mal,
car si l'on en excepte les espèces lignicoles, celles qui croissent sur le fumier ou sur les excréments
d'herbivores, et celles qui, en très petit nombre, se développent aux dépens d'une plante
déterminée, on ignore ce qui peut donner naissance à toutes les autres. La recherche en est,
en réalité, fort difUcile: on en sera d'autant moins surpris que lorsqu'on récolte ordinairement
un Champignon et qu'on le détache du sol, il ne consers'e plus rien à ce moment qui décèle les
premières tracées de son existence. N'est-il pas regrettable, à ce point de vue, que nous ne
sachions pas encore, par exenn>le, de quel substratum particulier l'Oronge et le Cèpe tirent leur
nourriture?
Mais, quoi ciu'il en soit, revenons à la spore comme point de départ de notre étude, et résumons
à grands traits les phénomènes biologiques généraux des Champignons dont il est ici
question.
(^ette spore, dont la forme varie suivant les genres et parfois même chez les espèces d'un
même genre, est l'équivalent de l'oeuf animal. Comme ce dernier, elle contient en puissance
dans son intérieur, en germe, pourrait-on dire, le futur Champignon, et cela dans une très inlime
particule deplasma, ou matière vivante concrète, à demi fluide et à demi soUde, où l'oeil
armé des plus forts grossissements ne distingue t|ue de fines granulations à peine perceptibles.
Placé dans un milieu favorable et sous l'action simultanée de la chaleur, de l'humidité, quelquefois
même d'un liquide nutritif nécessaire, ce plasma, ce germe, jusqu'alors immobile,
s'éveilloàla vie,cequise reconnaît au mouvement moléculaire de samasse. La spore étant composée
de deux membranes accolées l'une à l'autre, mais indistinctes, le plasma vivant agit sur
la membrane interne en Uii faisant faire hernie en un point et parfois en deux ou trois points
au dehors de la membrane externe; par les éléments de formation qu'il lui fournit successivement,
celte membrane interne s'allonge et produit des tubes ou boyaux germinatifs, première
|)hase de l'a]>|iareii végétatil'ou mycélium du Champignon. Les spores de Morille qui germent
sur l'eau, en (juelques heures, se prêtent forlbieii à cette étude. Nous en donnons ci-contre la
ligure. Ce mycélium est bien, en effet, le commencement de l'appareil végétatif de tous les
.Mycètes, car chez les plus sim]>les Moisissures il se développe peu et termine de suite sa courte
période vitale en formant les organes reproducteurs ou générateurs des spores, semblables à la
Sjiore dont il est sorti. Mais chez les Champignons d'organisation plus compliquée, on retrouve
toujours ce mycéhum, dont la durée elTextension semblent être justement en rapport avec le
degré même de cette organisation. Dans tousles cas, à (juelque espèce simple ou complexe qu'il
appartienne, le mycélium est constitué par des filaments distincts, invisibles k l'oeil nu, et qui
ne sont perceptibles ù la vue que lorsqu'ils s'enchevêtrent et se réunissent en grand nombre
sous la forme de très minces cordons, ordinairement blancs, rarement colorés, ainsi que se présente
du reste ce que l'on appelle le blanc de Champignon.
Or, s'il est établi que le mycélium est l'appareil végétatif du Ciiampignon, ce Champignon
lui-même que doit-il être? Il n'en peut plus être que le porte-graines ou l'appareil sporophore
C'est d'ailleurs ce que l'on conijirend aisément lorsqu'on se reporte aux Mycètes les |)lus
simples, comme nous l'avons vu plus haut, et lorsqu'au lieu dose borner à l'étude de l"(.)ronge,
par exemple, espèce la plus élevée en organisation du grand groupe des Ilymt'nomycèles, on
remonte de l'espèce lapins simpledecemcme groupe, par la série d'évolution, jusqu'à l'Oronge.
Ainsi tout d'abord les basides sporophores reposent directement sur le mycélium. Puis la
partie du mycélium sur laquelle se développent les basides s'organise en un tissu de filaments
plus serrés, plus compacts : c'est Miyménitmi. Ensuite le tissu sous-byménial revêt des
formes diverses: c'est une petite colonne qui s'élève ou bien une sorte de meml.)rane <pii
s'accuse de plus en plus, et ipii, d'abord horizontale, se dresse ensuite sous la forme de proéminences
ou se creuse de cavités. Les petites colonnes deviendront peu à [)eu des Clavaires
primitivement simples, puis ramifiées ou Car ail aides ; les proéminences se transformeront successivement
soit en Uérissom, avec des pointes ou aiguillons, soit en ChaïUerrlles avec un réseau
Spores Iri's groissiosue Monue, en germination.
d'anastomoses veiniformes ; enfin, ce réseau deviendra lui-même bientôt des lamelles, siège de
l'hyménium dans cet immense groupe des Champignons lamellifères ayant dans YOraiige son
type le plus parfait. Les cavités s'organiseront de même, et elles constitueront : à l'état le [)lus
simple, la grande série des Palypores; à l'état des tubes connexes, la série des Cèpes; et à l'état
de tubes libres et indépendants, la Fisluline ou Langue de boeuf. Nous ne pouvons entrer ici
dans de plus grands détails, mais nous ferons remarquer que ces séries de développements,
pour tendre au même but, présentent toujours deux modifications progressives en corrélation
constante l'une avec l'autre: la complexité des formes et la muUiplicité des organes de reproduction.
Ainsi compris, le rôle du mycélium est celui d'un appareil végétatif dont ce que nous appelons
plus particulièrement le Champignon est le réceptacle de l'appareil reproducteur. Mais
comment naît et se développe cet appareil reproducteur? Nul doute que ce soit à la suite d'une
fécondation, ainsi qu'on l'a constaté clairement chez certains Champignons inférieurs, et bien
que les résultats des recherches faites à ce point de vue chez les Champignons supérieurs ne
soient pas encore aussi nettement concluants.