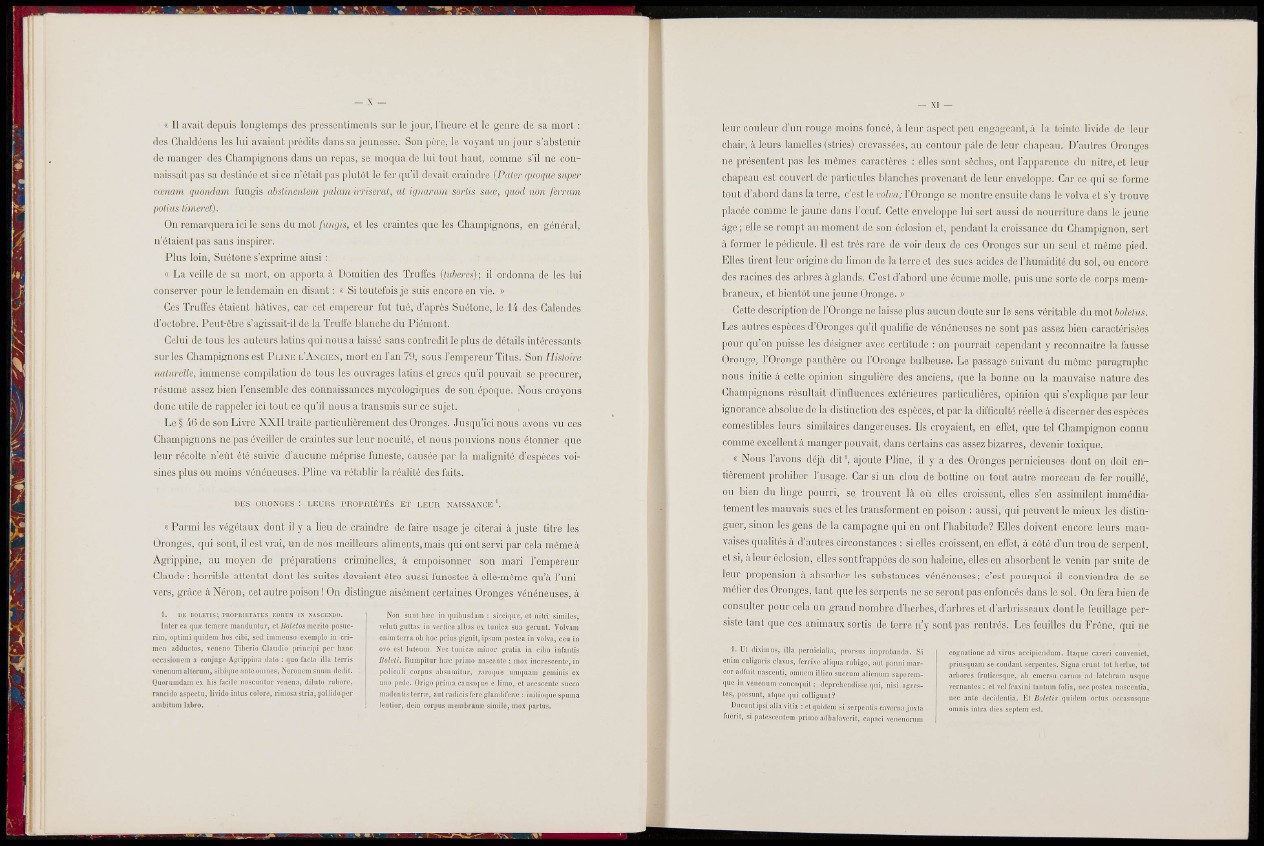
<- Il avail dc[)uis loiigLeraps des pressûiiliraeiUs sur le jour, l'heure et le genre de sa mort :
des (ilialdéeiis les lui avaient [irédils dans sa jeunesse. Son [)ère, le voyant un jour s'abstenir
de manger des Cliam[)ignons dans un l'epas, se moqua de lui tout liant, comme s'il ne connaissait
pas sa destinée et si ce n'était pas plutôt le l'er ([u'il devait craindre {Pater qnoque super
(wnani quondam fungis abslinenlem palam irrismil, ul igiiaram sortis siioe, (jiiod non ferrum
poiius limeret).
On remarquera ici le sens du mot fungis, et les craintes que les Champignons, en général,
n'étaient pas sans inspirer.
Pins loin, Suétone s'exprime ainsi :
s La veille de sa mort, on apporta à Domitien des Truffes {lubereii)-, il ordonna de les lui
conserver pour le lendemain en disant : « Si toutefois je suis encore en vie. »
Ces Truffes étaient hâtives, car cet empereur fut tué, d'après Suétone, le 14 des Calendes
d'octobre. Peut-être s'agissait-il de la Truffe blanche du Piémont.
Celui de tous les auteurs latins qui nousa laissé sans contredit le plus de détails intéressants
sur les Champignons est PLINE L'A^•CLEX, mort en l'an 79, sous l'empereur Titus. Son Ifisloire
nalnrcUe, immense com])ilalion de tous les ouvrages latins et grecs qu'il pouvait se procurer,
résume assez bien l'ensemble des connaissances mycologiques de son époque. Nous croyons
donc utile de rappeler ici tout ce qu'il nous a transmis sur ce sujet.
Le I if) de son Livre XXII traite particuhèrement des Oronges. Jusqu'ici nous avons vu ces
Champignons ne pas éveiller de craintes sur leur nocuité, et nous pouvions nous étonner que
leur récolte n'eût été suivie d'aucune méprise funeste, causée par la malignité d'espèces voisines
plus ou moins vénéneuses. Pline va rétablir la réalité des faits.
DES ORONGES: LEURS PRORFILÉTÉS ET LEUR NAISSANCE \
«Parmi les végétaux dont il y a lieu de craindre de faire usage je citerai à juste titre les
Oronges, qui sont, il est vrai, un de nos meilleurs aliments, mais qui ont servi par cela môme à
Agrippine, au moyen de préj)arations criminelles, à empoisonner son mari l'empereur
Claude : horrible attentat dont les suites devaient être aussi funestes à elle-même qu'à l'univers,
grâce à Néron, cet autre poison ! On distingue aisément certaines Oronges vénéneuses, à
1. DE B01.ET1S; PIlOI'lllETA
hiler ea qujc leinci'c muiidun
rim, optimi qiiidem hos cibi, si
nien adduclos, veneno Tiberit
occasioiiein a conjugo Agrippiii
venenum alleruni, sibiquc anle i
Quoi'unidam ev bis facile nosci
rancido aspeclu, livido inlus co
ambitum litbro.
ur, cl7io?eiosinerilo posucd
immenso esemplo in cri-
Claudio principi per liane
i dalo : quo facto illa terris
miics.Neronem suum dedil,
ntur venena, dilulo rubore,
ore, l imosa sUia, pallido per
NOI Hit biDc in quibusdam :
veluli gtilliis in vorlice albi
enini terra ob hoc prius giguil, ipsura posli
ovo est luteum. Nec tnniccc minor gcatii
BolelL liunipiUir liKt (irimo nasceate ; m
podiculi corpus absnmitiir, raroque um
uiio pode. Origo prima caiisaque e limo, i
madentis territs aut radicis fere glandiferic
leiilior, dein corpus membrana; siiiiile, mi
int. Volvam
olva, Cüu in
leur couleur d'un rouge moins foncé, à leur aspect peu engageant, à la teinte livide de leur
cliair, à leurs lamelles (stries) crevassées, au contour p;ile de leur chapeau. D'autres Oronges
ne présentent ]3as les mêmes caractères : elles sont sèches, ont l'apparence du nitre, et leur
chapeau est couvert de particules blanches provenant de leur enveloppe. Car ce qui se forme
tout d'abord dans la terre, c'est le voira; l'Oronge se montre ensuite dans le volva et s'y trouve
placée comme le jaune dans l'oeuf. Cette enveloppe lui sert aussi de nourriture dans le jeune
âge; elle se rompt au moment de son éclosion et, pendant la croissance du Champignon, sert
à former le pédicule. Il est très rare de voir deux de ces Oronges sur un seul et même ¡lied.
Elles tirent leur origine du limon de la terre et des sucs acides de l'humidité du sol, ou encore
des racines des arbres à glands. C'est d'abord une écume molle, puis une sorte de corj)S membraneux,
et bientôt une jeune Oronge. »
Cette description de l'Oronge ne laisse plus aucun doute sur le sens véritable du mot boJelus.
Les autres espèces d'Oronges qu'il qualille de vénéneuses ne sont pas assez bien caractérisées
pour qu'on puisse les désigner avec certitude : on pourrait cependant y reconnaître la fausse
Oronge, l'Oronge panthère ou l'Oronge bulbeuse. Le passage suivant du môme paragraphe
nous initie à cette opinion singulière des anciens, que la bonne ou la mauvaise nature des
(champignons résultait d'influences extérieures particulières, opinion qui s'explique par leur
ignorance absolue de la distinction des espèces, et par la difliculté réelle à discerner des espèces
comestibles leurs similaires dangereuses. Ils croyaient, en effet, que tel Champignon connu
comme excellent à manger pouvait, dans certains cas assez bizarres, devenir toxique.
« Nous l'avons déjà dit\ ajoute Pline, il y a des Oronges pernicieuses dont on doit entièrement
prohiber l'usage. Car si un clou de bottine ou tout autre morceau de fer rouillé,
ou bien du linge pourri, se trouvent là où elles croissent, elles s'en assimilent immédiatement
les mauvais sucs et les transforment en poison : aussi, qui peuvent le mieux les distinguer,
sinon les gens de la campagne qui en ont l'habitude? Elles doivent encore leurs mauvaises
qualités à d'autres circonstances : si elles croissent, en effet, à côté d'im trou de serpent,
et si, à leur éclosion, cl les sont frappées de son haleine, elles en absorbent le venin par suite de
leur propension à absorber les substances vénéneuses; c'est pourquoi il conviendra de se
méfier des Oronges, tant que les serpents ne se seront pas enfoncés dans le sol. On fera bien de
consulter pour cela un grand nombre d'herl^es, d'arbres et d'arbrisseaux dont le feuillage persiste
tant que ces an i in aux sortis de terre n'y sont pas rentrés. Les feuilles du Frêne, qui ne
1. Ul (lisiraus,
enini caligaris eli
coradfuitnasceni
que in venenum <
íes, possuni, alqii
üucnntipsiAli.1
riiorit, si palfiseci
laha, prorsns
aliqna rubigo,
ai s, ferr
, omnnii
oncoquit :
î qui collignnt?
vilia : olqnidem si
lem primo adbala^
nproba.
aut pam
(Icp relie
cognalione ad virus acci]:
priusquam sû coudant ser
arbores frnlicosque, ab f
5. Signa en:
vernanles : vc\ fea
nec inle decid
Bri convenid,
toi herbfe, tot
ad lalebram usque
c postea nascentia,
I ortus occasusque