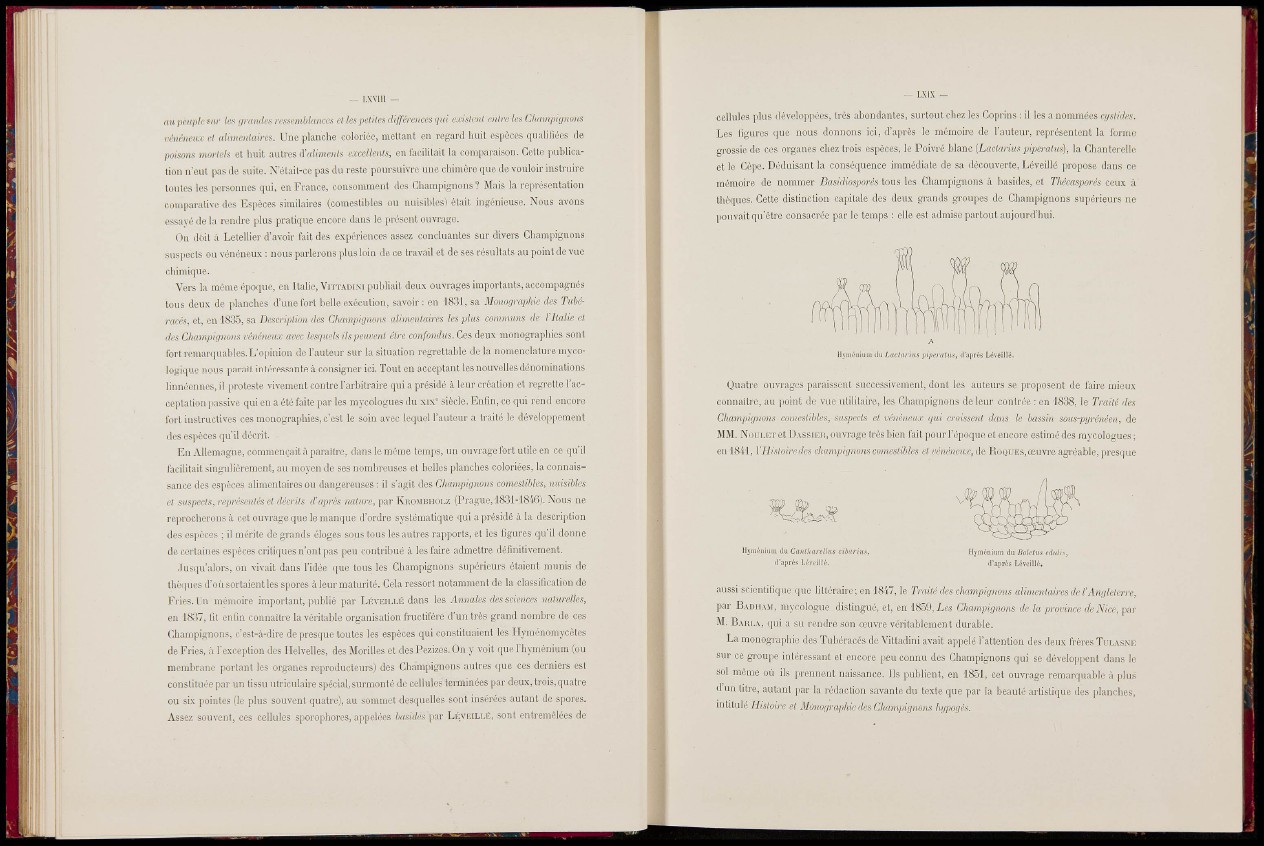
(Ill pmplesiii- les f/iriiiiles ressemblances el lespeliles différenas qui exislenl enire les Champianons
vénéneux el tiUmenlaires. One planche coloriée, meUanl en regard huit espèces qualiliées de
poisons morlels et huit autres d'u/imni/s excellenls, en facilitait la comparaison. Cette publication
n'eut pas de suite. N'était-ce pas du reste poursuivre une chimère que de vouloir instruire
toutes les personnes qui, en France, consomment des Champignons? Mais la représentation
comparative des Espèces similaires (comestibles ou nuisibles) était ingénieuse. Nous avons
essayé de la rendre plus pratique encore dans le présent ouvrage.
(hi doit ¿1 Letellier d'avoir fait des expériences assez concluantes sur divers Champignons
suspects ou vénéneux : nous parlerons plus loin de ce travail et de ses résultats au point de vue
chimique.
Vers la même époque, en Italie, VrrT.iDiNi publiait deux ouvrages importants, accompagnés
tons deux de planches d'unefort belle exécution, savoir : en 1831, sa Monographie des Tubéracés,
et, en 1835, sa Descriplion des Champignons alimenlaires les plus comnmns de l'Ilalie el
lies Champignons eénèneux avec lesquels ilspennent Sire confondus. Ces deux monographies sont
fort remarquables. L'opinion de l'auteur sur la situation regrettable de la nomenclature mycologique
nous parait intéressante à consigner ici. Tout en acceptant les nouvelles dénominations
linnéennes, il proteste vivement contre l'arbitraire qui a présidé à leur création et regrette l'acceptation
passive qui en a été faite par les mycologues du xix* siècle. Enfin, ce qui rend encore
fort instructives ces monographies, c'est le soin avec lequel l'auteur a traité le développement
des espèces qu'il décrit.
En Allemagne, commençait à paraître, dans le même temps, un ouvrage fort utile en ce qu'il
facilitait singulièrement, au moyen de ses nombreuses et belles planches coloriées, la connaissance
des espèces alimentaires ou dangereuses : il s'agit des Champignons comestibles, nuisibles
el suspeels.représenlêsetdécrils d'après naiiu-e, par KUOMBHOLZ (Prague, 1831-18'I6). NOUS ne
reprocherons à cet ouvrage que le ma n q ue d'ordre systématique qui a présidé à la description
des espèces ; il mérite de grands éloges sous tous les autres rapports, et les figures qu'il donne
de certaines espèces critiques n'ont pas peu conti ibué à les faire admettre définitivement.
•jusqu'alors, on vivait dans l'idée (pie tous les Champignons supérieurs étaient munis de
théques d'oii sortaient les spores à leur maturité. Cela ressort notamment do la classification de
Fries. I;n mémoire important, ])ublié par LÉVEUXÉ dans les Annales des sciences naturelles,
en 18:)7, fit enfin connaître la véritable organisation fructifère d u n très grand nombre de ces
Champignons, c'est-à-tlire de presque toutes les espèces qui constituaient les Ilyménomycètes
de Frics, à l'exception des Ilelvelles, des Morilles et des Pezizes. On y voit que Ihyménium (ou
membrane portant les organes reproducteurs) des Champignons autres (|ue ces derniers est
constituée par un tissu utriculaire spécial, surmont é de cellules terminées par deux, trois, quatre
ou six pointes (le pins souvent quatre), au sommet desquelles sont insérées autant de spores.
Assez souvent, ces cellules sporophores, a[ipelées basides par LÉVF.IU.É, sont entremêlées de
cellules plus développées, très abondantes, surtout chez les Coprins : il les a nommées cyslides.
Les figures (juc nous donnons ici, d'après le mémoire de l'auteur, représentent la forme
grossie de ces organes chez trois espèces, le Poivré blanc {Laclarius piperalus), la Chanterelle
et le Cèpe. Déduisant la conséquence immédiate de sa découverte, Léveillé propose dans ce
mémoire de nommer Basidiosporés tous les Champignons à basides, et Théeasporés ceux à
théques. Cette distinction capitale des deux grands groupes de Champignons supérieurs ne
¡lonvait qu'être consacrée par le temps : elle est admise partout aujourd'hui.
Ilïmiiiihfm du Laclarius piperatus, d après L(iveillé.
Quatre ouvrages paraissent successivement, dont les auteurs se proposent de faire mieux
connattre, au point de vue utilitaire, les Cbampignous de leur contrée : en 1838, le Traité des
Champignons comestibles, suspecls el vénéneux qui croissent dans la bassin sous-pyrénéen, de
MM. NouLETet D.VSSIEU, ouvrage très bien fait pour l'époque et encore estimé des mycologues;
en 18i l , Xliisloiredes champignons comestibles el rénéneux, de ROQUES,oeuvre agréable, jiresque
Hyméniiim du Canlharelhis cibarim,
d'aprè? Lcvcillé.
Ilyménium du Boletus edidi.s,
d'après Léveillé.
aussi scienliikjiie que littéraire; en 1817, le Traité des champignons alinienlaires de l'Angleterre,
par BADIIAM, mycologue distingué, et, en 1859, LT-S Champignons de la province de Nice, pai-
M, BAUI.A, qui a su rendre son oeuvre véritablement durable.
La monogi-aphie des Tubéracés de Viltadini avait appelé l'attention des deux frères TIXASNIC
sur ce groujie intéressant et encore peu connu des Champignons ([ui se développent dans le
sol môme où ils prennent naissance. Ils publient, en 1851, cet ouvrage remarquable à plus
d'un titre, autant par la rédaction savante du texte que par la beauté artistique des planches,
mtitulé l-fisloire et Monographie des Chamingnons hypogés.