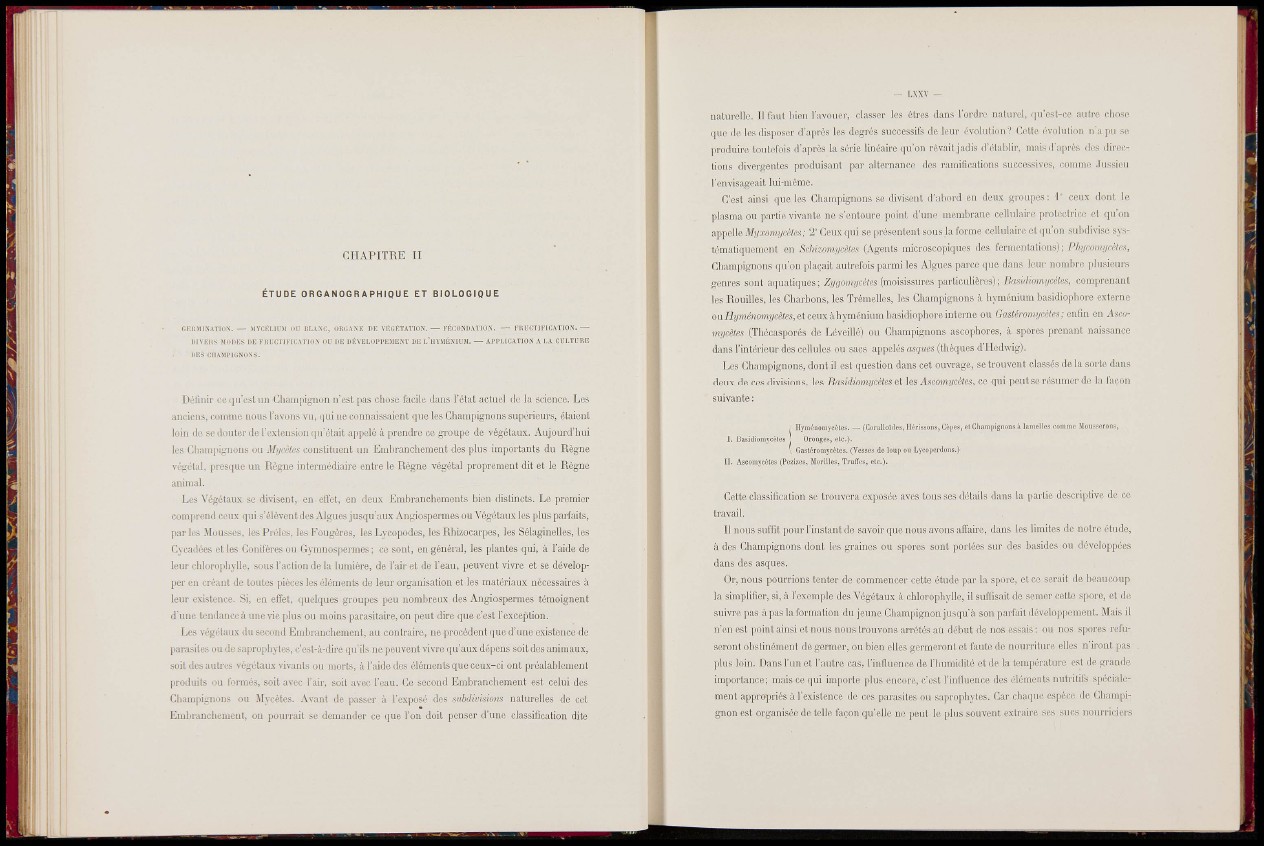
CHAPITRE II
É T U D E O R G A NOG R A PHIQU E ET BIOLOGIQUE
(lEUMINATION. — MYCÉLIUM UÜ ULA.NC, UlUIANli DE VÉüKTATlON. — rÉCONHATION. — rRÛCÎlFICA.ÏlO>'. —
UIVEliS >[IIIJES LIE VJIUCTIKICATION OU HE DÉVELOITEMENT DE l'hYMÉMUM. — Ai'PLiCA.T10N A LA CULTURE
MES CHAMPIGNONS.
DcLillir ce (jn'est un Chaïupiguon n'est pas chose facile LÎaus l'état actuel de la science. Les
anciens, comme nous l'avons vu, i|ui ne connaissaient que les Champignons supérieurs, étaient
loin de se douter de l'extension qu'était appelé à prendre ce groupe de végétaux. Aujourd'hui
les Champignons ou Mtjcètes constituent lui Embranchement des plus importants du Règne
végétal, presque un Règne intermédiaire entre le Règne végétal proprement dit et le Régne
animal.
Les Végétaux se divisent, en elîet, en deux Embranchements bien distincts. Le premier
comjirendceux qui s'élèvent des Algues jusqu'aux Angiospermes ou Végétaux les j)lus parfaits,
par les Mousses, les Prèles, les Fougères, les Lycopodes, les Rhixocarpes, les Sélaginelles, les
Cycadées et les Conifères ou Gymnospermes; ce sont, en général, les plantes qui, à l'aide de
leur chlorophylle, sous l'action de la lumière, de l'ah' et de l'eau, peuvent vivre et se développer
en créant de toutes pièces les éléments de leur organisation et les matériaux nécessaires à
leur existence. Si, en effet, quelques groupes peu nombreux des Angiospermes témoignent
d Line tendanceà une\de plus ou moins parasitaire, on peut dire (¡ue c'est l'exception.
Les végétaux du second Embranchement, au contraire, ne procèdent (jue d'une existence de
parasites ou de saprophytes, c'est-à-dii'e qu'ils ne peuvent vivre ipi'aux dépens soit des animaux,
soit des autres végétaux vivants ou morts, à l'aide des cléments que ceux-ci ont pj'éalablement
produits on formés, soit avec l'air, soit avec l'eau. Ce second Embranchement est celui des
Champignons ou Mycètes. Avant de passer à l'exposé des .•iiihdivisions naturelles de cet
Embranchement, on pourrait se demander ce ijue l'on doit penser d'une classification dite
- LXXY -
natm-elle. Il faut bien l'avouer, classer les êtres dans l'ordre naturel, (pi'est-ce aulre chose
(|ue lie les disposer d'après les degrés successifs de leur évolution? Cette évolution n'a pu se
produire toutefois d'après la série linéaire qu'on rêvait jadis d'établir, maisd'ajirès des directions
divergentes produisant par alternance des ramifications successives, comme .lussiou
l'envisageait lui-même.
C'est ainsi (|ueles Champignons se divisent d'abord en deux groupes: 'l" ceux dont le
plasma ou partie vivante ne s'entoure point d'une membrane ceUulaire protectrice et qu'on
appelle Myxomycètes; 2" Ceux qui se présentent sous la forme cellulaire et qu'on subdivise systématiquement
en Schizomycèles (Agents microscopiques des fermentations);
Champignons qu'on plaçait autrefois parmi les Algues parce que dans leur nombre plusieurs
genres sont aquatiques; Zygoinycétfis (moisissures particulières); Bmidiomycèie.% comprenant
les Rouilles, les Charbons, les Trémelles, les Champignons à hyménium basidiophore externe
ou7iyménow^cèies,etceuxàhyméniumbasidiophoreinterne ou Ga^téromycétes; enfin en Asoomycètes
(Thécasporés de Léveillé) ou Champignons ascophores, à spores prenant naissance
dans l'intérieur des cellules ou sacs appelés asques (thèques d'Hedwig).
Les Champignons, dont il est question dans cet ouvrage, se trouvent classés de la sorte dans
deux de ces divisions, les Baùdiomycètes oX As.comycètp,n, ce qui peut se résumer de la façon
suivante :
Hyménomycèles. — (Coi-alloîties, Hérissons, Cèpes, elCliampignonsà lamelles commc Mousserons,
]. Basidiomycñles Oronges, etc.).
( Gastéromyciites. (Vesses de loup ou Lycoperdons.)
IL Ascomycctes (Pezizes, Morilles, Trulïes, elc.).
Cette classification se trouvera exposée aves tous ses détails dans la partie descriiitive de ce
travail.
Il nous suffit pour l'instant de savoir que nous avons affaire, dans les limites de notre étude,
à des Champignons dont les graines ou spores sont portées sur des basides ou développées
dans des asques.
Or, nous pourrions tenter de commencer cette étude par la spore, et ce serait de beaucoup
la simplifier, si, à l'exemple des Végétaux à chlorophylle, il suffisait de semer cette spore, et do
suivre pas à pas la formation du jeune Chamjiignon jusqu'à son parfait développement. Mais il
n'en est point ainsi et nous nous trouvons arrêtés aii di'but de nos essais : ou nos spores refuseront
obstinément de germer, ou bien elles germeront et faute de nourriture elles n'iront pas
])lus loin. Dans l'un et l'autre cas, l'influence de l'humidité et de la température est de grande
importance; mais ce qui importe plus encore, c'est l'inlluence des éléments nutritil's sjiécialement
appropriés à l'existence de ces parasites ou saprophytes. Car chaque espèce de Champignon
est organisée de telle façon qu'elle ne ¡¡eut le i)hjs souvent extraire ses sucs nourriciers