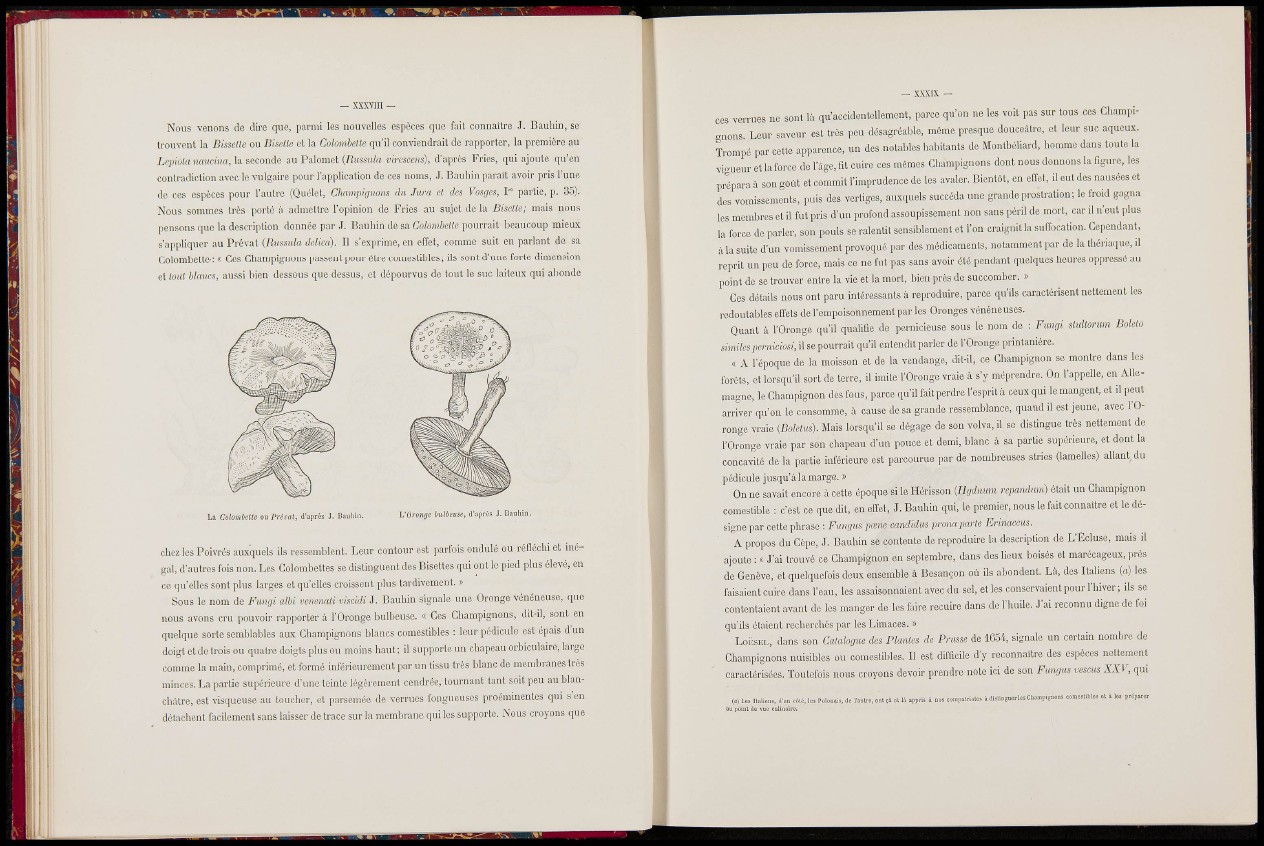
Nous venons de dire que, parmi les nouvelles espèces que fait connaître J. Bauliin, se
trouvent la BisscUe ou Biselle et la Colombette qu'il conviendrait de rapporter, la première au
Lepiota naucina, la seconde au Palomet (Riissïtla virescens), d'après Fries, qui ajoute qu'en
contradiction avec le vulgaire pour l'application de ces noms, J. Bauhin parait avoir pris l'une
de ces espèces pour l'autre (Quelet, Champignons du Jura cl des Vosges, I" partie, p. 35).
Nous sommes très porté à admettre l'opinion de Fries au sujet de la Biselle; mais nous
pensons que la description donnée par J. Bauhin de sa Colombella pourrait beaucoup mieux
s'appliquer au Prévat {liussula delica). Il s'exprime, en effet, comme suit en parlant de sa
Colombette-: « Ces Champignons passent pour être comestibles; ils soÈit d'une forte dimension
et tout blaiKS, aussi bien dessous que dessus, et dépourvus de tout le suc laiteux qui abonde
La Cobmbelle on Primi, d'après J. Bauliin. L'OrollJ« itilltase, d'après J. Bauliin.
chez les Poivrés auxquels ils ressemblent. Leur contour est parfois ondulé ou réfléchi et inégal,
d'autres fois non. Les Colombettes se distinguent des Bisettes qui ont le pied plus élevé, en
ce qu'elles sont plus larges et qu'elles croissent plus tardivement. Ï
Sous le nom de Fungi albi venenati viscidi .L Bauhin signale une Oronge vénéneuse, que
nous avons cru pouvoir rapporter à l'Oronge bulbeuse. « Ces Champignons, dit-il, sont en
quelque sorte semblables aux Champignons blancs comestibles : leur pédicule est épais d'un
doigt et de trois ou quatre doigts plus ou moins haut ; il supporte un chapeau orbiculaire, large
comme la main, comprimé, et formé inférieurement par un tissu très blanc de membranes très
minces. La partie supérieure d'une teinte légèrement cendrée, tournant tant soit peu au blanchiitre,
est visqueuse au toucher, et parsemée de verrues fongueuses proéminentes qui s'en
détachent facilement sans laisser de trace sur la membrane qui les supporte. Xous croyons que
ces verrues ne sont là qu'accidentellement, parce qu'on ne les voit pas sur tous ces Champignons
Leur saveur est très peu désagréable, même presque douceâtre, et leur suc aqueux.
Trompé par cette apparence, un des notables habitants de Montbéliard, homme dans toute la
vio-ueur et la force de l'âge, fit cuire ces mêmes Champignons dont nous donnons la figure, les
prépara à son goût et commit l'imprudence de les avaler. Bientôt, en effet, il eut des nausées et
des vomissements, puis des vertiges, auxquels succéda une grande prostration; le froid gagna
les membres et il fut pris d'un profond assoupissement non sans péril de mort, car il n'eut plus
la force de parler, son pouls se ralentit sensiblement et l'on craignit la suffocation. Cependant,
à la suite d'un vomissement provoqué par des médicaments, notamment jiar de la thériaque, il
reprit un peu de force, mais ce ne fut pas sans avoir été pendant quelques heures oppressé au
point de se trouver entre la vie et la mort, bien près de succomber. »
Ces détails nous ont paru intéressants à reproduire, parce qu'ils caractérisent nettement les
redoutables effets de l'empoisonnement par les Oronges vénéneuses.
Quant à l'Oronge qu'il qualifie de pernicieuse sous le nom de : Fungi slultorwn Bolelo
similesperniciosi, il se pourrait qu'il entendit parler de l'Oronge printanière.
s; A l'époque de la moisson et de la vendange, dit-il, ce Champignon se montre dans les
forêts, et lorsqu'il sort de terre, il imite l'Oronge vraie à s'y méprendre. On l'appelle, en Allemagne,
le Champignon des fous, parce qu'il fait perdre l'esprit à ceux qui le mangent, et il peut
arriver'qu'on le consomme, à cause de sa grande ressemblance, quand il est jeune, avec l'Oronge
vraie (Boletus). Mais lorsqu'il se dégage de son volva, il se distingue très nettement de
l'Oronge vraie par son chapeau d'un pouce et demi, blanc à sa partie supérieure, et dont la
concavité de la partie intérieure est parcourue par de nombreuses stries (lameUes) allant du
pédicule jusqu'à la marge. »
On ne savait encore à cette époque si le Hérisson {Hi/dnum repandum) était un Champignon
comestible : c'est ce que dit, en effet, J. Bauhin qui, le premier, nous le fait connaître et le désigne
par cette phrase : Fungas poene candidas prona parte Erinaceus.
A propos du Cèpe, J. Bauhin se contente de reproduire la description de L'Écluse, mais il
ajoute ; c< J'ai trouvé ce Champignon en septembre, dans des lieux boisés et marécageux, prés
de Genève, et quelquefois deux ensemble à Besançon où ils abondent. Là, des Italiens (a) les
faisaient cuire dans l'eau, les assaisonnaient avec du sel, et les conservaient pour l'hiver ; ils se
contentaient avant do les manger de les faire recuire dans de I huile. J'ai reconnu digne de foi
qu'ils étaient recherchés par les Limaces. »
LoiiSEL, dans son Catalogue des Plantes de Prusse de 1654, signale un certain nombre de
Champignons nuisibles ou comestibles. Il est difficile d'y reconnaître des espèces nettement
caractérisées. Toutefois nous croyons devoir prendre note ici de son Fungus vescus X I T , qui
(.) 11.11.™, ,V«„ =Sli, les Polon.1.. ac l'.ulri, oui !» ot U .pp.1. ù no. oompoi™« i d¡.llns«l.. Cliamplgiion. o.no.Iilfa .1 S fa prip.rer
au point de vue culinaire.