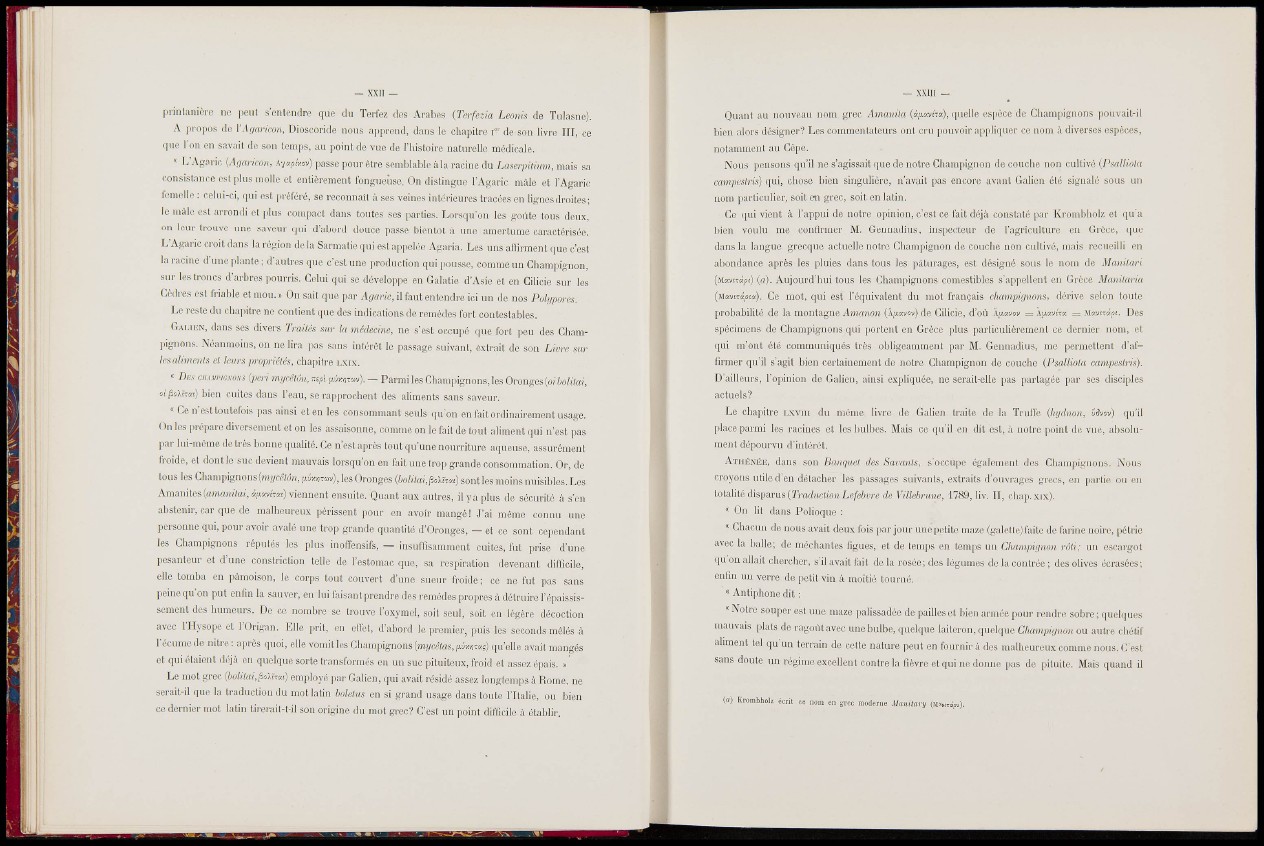
priiilanièro ne peiil s'enlenilrc que du Torlez des Ai-ahos (Terfezm Lean-is de Tulasne).
A propos (le l'Ànaricon, Dioscoride nous apprend, dans le chapitre i " de son livre III, ce
I|iie I on en savail do son lemps, au point de vue de l'histoire naturelle médicale.
" L'Agai'ic {Afiaricoii, A-/i!,oioe») passe pour être semblable à la racine du iMxrpitimn, mais sa
consistance est plus molle et entièrement Ibngueùse. On distingue l'Agaric mâle et l'Agaric
l'cnielle : celui-ci, qui est prél'éré, se reconnaît à ses veines intr-rieures tracées en lignes droites;
le niàle est arrondi et ].lus compact dans toutes ses parties. Lorsqu'on les goilte tous deux,
on leur h'Ouvc une saveur ipii d'abord douce passe bientùt à nue amertume caractérisée.
L'Agaric croit dans larégion delà Sarmal iequi esta]ipelée Agai-ia. Les uns affirment (|ue c'est
la i-acnie d'une piaule ; d'autres que c'est une jiroduction qui pousse, commenn Champignon,
sur les troncs d'arbres pourris. Celui qui se développe en Galatie d'Asie et en Cilicie sur les
Cèilres est friable et mou. . On sait que par Agaric, il faut entendre ici nn de nos Poh/pores.
L e reste du cha]nlre ne contient quo des Indications de remèdes fort contestables.
G.M.IEN, dans ses ilivers Trailés sw In médecine, ne s'est occupé que fort |ieu des Chamingnons.
Néanmoins, on ne lira pas sans intérêt le passage suivant, extrait de son Livre sur
lesalimenls el leurs propriélés, chapitre LXI.X.
« Zt e cimmavxs ijwri mycmn, rap! aJ^ot-jv). - Parmi les Chami i ignons, les Oronges (o, bnlilai,
cifi^K-yj) bien cuites dans l'eau, se rapprochent des aliments sans saveur.
« Ce n'est toutefois pas ainsi et en les consommant seuls (|u"on en fait ordinairement usage.
On les prépare diversement et on les assaisonne, comme on le fait de tout aliment i|ui n'est pas
par lui-même de très bonne qualité. Ce n'est après tout qu'une nourri ture aqueuse, assurément
froide, et dont le suc devient mauvais lorsqu'on en fait une trop grande consommation. Or, de
tous les Ci)ampignons(m!/a;iiîi!,n™,v»»), les Oronges (6i)ir'la,',i3<.lr,«,)sontlesmoinsnuisibles.Les
Amanites (iiinam'ioe, vi ennent ensuite. Quant aux autres, il y a plus de sécurité à s'en
abstenir, car que de malheureux périssent pour en avoir mangél J'ai même connu une
pei-sonne qui, pour avoir avalé une trop grande quantité d'Oronges, - et ce sont cependant
les Champignons réputés les plus inoCfensifs, — insuffisamment cuites, fut prise d'une
pesanteur et d'une constriction telle de l'estomac que, sa respiration devenant difficile,
elle tomba en pâmoison, le corps tout couvert d'une sueur froide; ce ne fut pas sans
peine qu'on put enfin la sauver, eu lui faisant prendre des remèdes propres à détruire l'épaississement
des humeurs. De ce nombre se trouve l'oxymel, soit seul, soit eu légère décoction
avec l'Hysope et l'Ori.ïan. Elle ]irit, on ell'ct, d'abord le premier, puis les seconds mêlés à
l'écume de nitre : après quoi, elle vomitles Champignons (ini/cétos, ,aizv,tt!ç) qu'elle avait mangés
et qui étaient déjà en quelque sorte transformés en un suc pituiteux, froid et assez épais, x
L e mot grec (bolilai,polî-c«) employé par Galien, qui avait résidé assez longtemps à R ome , ne
serait-il que la traduction du mot latin boletm en si grand usage dans toute l'Italie, ou bien
ce dernier mot latin tirerait-t-il son origine du mot grec? C'est un point difficile à établir.
Ouani au nouveau nom grec Amanita (i;fj.5;v!Ta), quel le espèce de Champignons pouvait-il
bien alors désigner? Les commentateurs ont cru pouvoir appliquer ce nom à diverses espèces,
notamment au Cèpe.
Nous pensons qu'il ne s'agissait (|ue de notre Chanipignon découché non cultivé
ccmipeslris) qui, chose bien singulière, n'avait pas encore avant Galien été signalé sous un
nom parficulier, soit tyn grec, soit en latin.
Ce (|ui vient à l'appui de notre opinion, c'est ce fait déjà constaté par Kronilibolz et r|u'a
bien voulu me confirmer M. Gennadius, iiis|)ecteur de l'agriculture en Grèce, que
dans la langue grecque actuelle notre Chanq)ignon de couche non cultivé, mais recueilli en
abondance après les ¡ilnies dans tous les pâturages, est désigné sous le nom de Manilari
(tï). Aujourd'hui tous les Champignons comestibles s'appellent en Grèce Manilaria
(Mavirdf^ia). Ce mot, qui est l'équivalent du mot français champifinons, dérive selon toute
probabilité de la m o n t i i g n e ( A f w v o u ) de Cilicie, d'où Â^a^vov = Mc.'M-âpt. Des
spécimens de Champignons c[ui portent en Grèce plus particulièrement ce dernier nom, et
qui m'ont été communiqués très obhgeamment par M. Gennadius, me permettent d'affirmer
qu'il s'agit bien certainement de notre Champignon de couche (Psalliola campeslris).
D'ailleurs, l'opinion de Gahen, ainsi expliquée, ne serait-elle pas partagée par ses disciples
actuels?
L e chapitre Lxvni du même livre de Galien traite de la TrulVe {hijdmii, ii^h^-j) qu'il
place parmi les racines et les liulbes. Mais ce qu'il en dit est, à notre ¡loint de vue, absolument
dépourvu d'intérêt.
ATHÉNÉE, dans son Banquet des Savants, s'occupe également des Cjiampigiioiis. Nous
croyons uUled'en détacher les passages suivants, extraits d'ouvrages grecs, en partie ou en
totalité disparus ( rmdi iCi ionLe/atTe de ViUebrune, 1789, liv. II, cbap.xix).
« On lit dans Polioque :
" Chacuii de nous avait deux fois par jour unepetite maze (galetlo)faite de farine noire, pétrie
avec la balle; de méchantes figues, et de temps en temps un Ckunpinmn rôti: un escargot
iiu'on allait chercher, s'il avait fait de la rosée; des légumes de la contrée ; des olives écrasées;
enfin un verre de petit vin à moitié tourné.
« Ant ipbone dit :
« Not r e souper est une maze palissadée de pailles et bien armée pour rendre sobre ; quelques
mauvais plats de ragoùtavec unebulbc, i|uelque laiteron, quelque Ckampiiinou ou autre cbétil
aliment tel qu'un terrain de cette nature peut en fournir à des malheureux comme nous. C'est
sans doute un régime excellent contre la fièvre et qui ne donne pas de pituite. Mais quand il
Manitary (Mavir^pu).