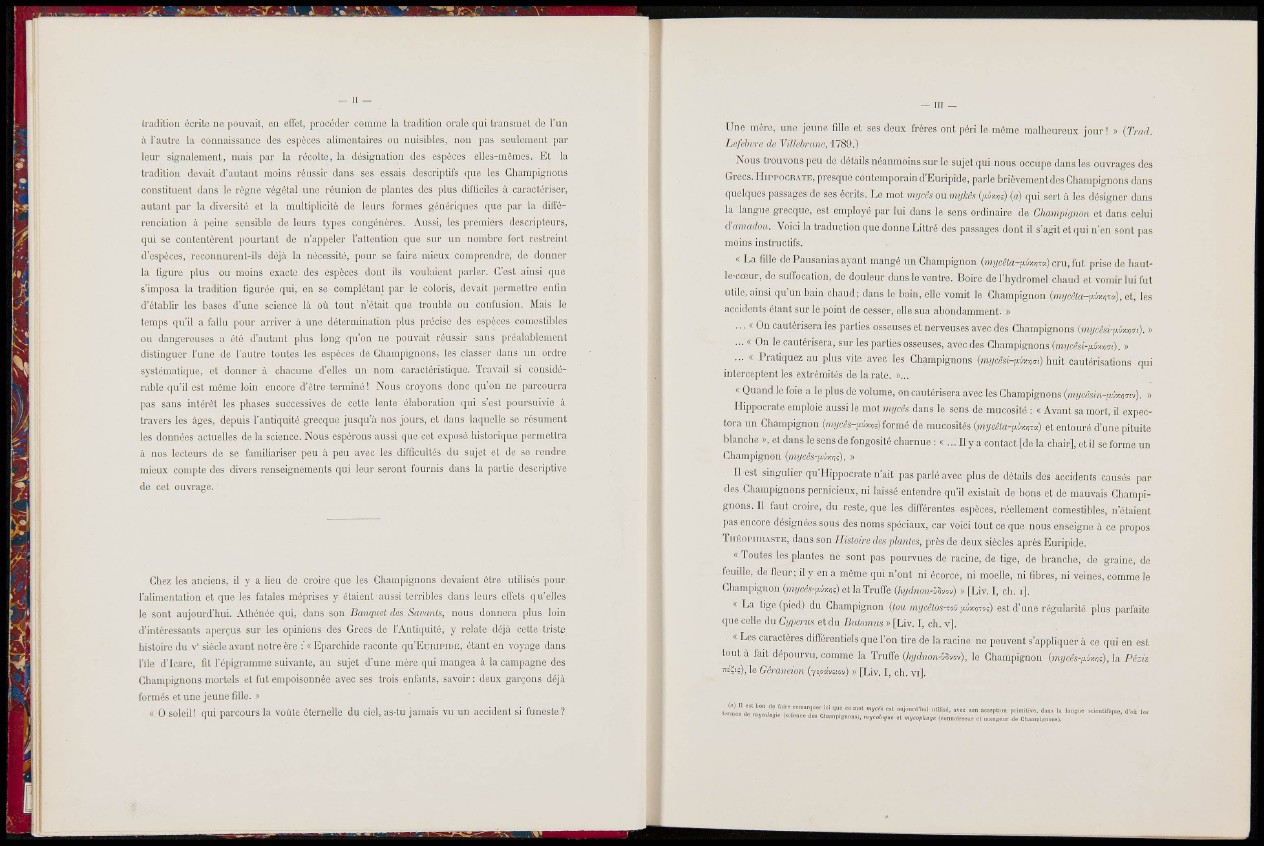
Lradilion écrite ne pouvait, en eil'et, procéder comme la tradition orale qui transmet de l'un
à l'autre la connaissance des espèces alimentaires ou nuisibles, non pas seulement par
leur signalement, mais par la récolte, la désignation des espèces elles-mêmes. Et la
tradition devait d'autant moins réussir dans ses essais descriptifs que les Champignons
constituent dans le règne végétal une réunion de plantes des plus difliciles à caractériser,
autant par la diversité et la multiplicité de leurs formes génériques que par la dilïérenciation
à peine sensible de leurs types congénères. Aussi, les premiers descripteurs,
qui se contentèrent pourtant de n'appeler l'attention que sur un nombre fort restreitit
d'espèces, reconnurent-ils déjà la nécessité, pour se faire uiieux comprendre, de donner
la figure plus ou moins exacte des espèces dont ils voulaient parler. C'est ainsi que
s'imposa la tradition figurée qui, en se complétant par le coloris, devait permettre entiu
d'établir les bases d'une science là où tout n'était que trouble on confusion. Mais le
temps qu'il a fallu pour arriver à une détermination plus précise des espèces comestibles
ou dangereuses a été d'autant plus long qu'on ne pouvait réussir sans préalablement
distinguer l'une de l'autre toutes les espèces de Champignons, les classer dans un ordre
systématique, et donner à chacune d'elles un nom caractéristique. Travail si considérable
qu'il est même loin encore d'être terminé! Nous croyons donc qu'on ne parcourra
pas sans intérêt les phases successives de cotte lente élaboration qui s'est poursuivie à
travers les âges, depuis l'antiquité grecque jusqu'à nos jours, et dans laquelle se résument
les données actuelles de la science. Nous espérons aussi ([ue cet exposé historique permettra
à nos lecteurs de se familiariser peu à peu avec les difficultés du sujet et de se rendre
mieux compte des divers renseignements qui leur seront fournis dans la partie descriptive
de cet ouvrage.
Cbez les anciens, il y a lieu de croire que les Champignons devaient être utilisés pour
l'alimentation et que les fatales méprises y étaient aussi ten'ibles dans leurs effets qu'elles
le sont aujourd'hui. Athénée qui, dans son Banquet des Savants, nous donnera plus loin
d'intéressants aperçus sur les opinions des Grecs de l'Antiquité, y relate déjà cette trisl£
histoire du v'' siècle avant notre ère « Epa r chide raconte qu'EunipioE, étant en voyage dans
l'île d'Icare, fit l'épigramme suivante, au sujet d'une mère (pii mangea à la campagne des
Champignons mortels et fut empoisonnée avec ses trois enfants, savoir : deux garçons déjà
formés et une jeune tille. »
<i 0 soleill qui parcours la voûte éternelle du ciel, as-tu jamais vu un accident si funeste?
Une mère, une jeune fille et ses deux frères ont péri le même malheureux jour I » (Tirid.
Lefebvre de ViHebrune, 1780.)
Nous trouvons peu de détails néanmoins sur le sujet qui nous occupe dans les ouvrages des
Grecs. lIirrocn.vTE, presque contemporain d'Euripide, parle brièvement des Champignons dans
quelques passages de ses écrits. Le mot mycês ou mylés {¡¡¿y-vi) (a) qui sert à les désigner dans
la langue grecque, est employé par lui dans le sens ordinaire de Champignon et dans celui
d'amadou. Voici la traduction que donne Littré des passages dont il s'agit et qui n'en sont pas
moins instructifs.
« La fille lie P aus ani a s ayant mangé un Champignon {mt jcêta-^m) cru, fut prise de hautle
coeur, de sulTocation, de douleur dans le ventre. Boire de l 'hydromel chaud et vomir lui fut
utile, ainsi qu'un bain chaud; dans le bain, elle vomit le Champignon (mycêta-pi-m,^), et, les
accidents étant sur le point de cesser, elle sua abondamment. »
... t On cautérisera les parties osseuses et nerveuses avec des Champignons (mijcisi-iiiy.-m). »
... « On le cautérisera, sur les parties osseuses, avec des Champignons (imjeêsi-p.h'.-ria). »
... t Pratiquez au plus vite avec les Champignons (mijcési-iJ.iy.vG!) huit cautérisations qui
interceptent les extrémités de la rate. s...
« Q u a n d le foie a le plus de volume, on cautérisera avec les Champignons (im/césin-p-faï)«»). ¡>
Hippocrate emploie aussi le mot mycés dans le sens de mucosité : « Avant sa mort, il expectora
un Champignon (mi/ccs-n«-«;)formé de mucosités (mycêta-iiAai^.i) et entouré d'une pituite
blanche », et dans le sens de fongosité charnue : « . . . Il y a contact [de la chair], et il se forme un
Champignon (mycSs-iJ-uy-vç). »
11 est singulier qu'Hippocrate n'ait pas parlé avec plus de détails des accidents causés par
des Champignons pernicieux, ni laissé entendre qu'il existait de bons et de mauvais Champignons.
Il faut croire, du reste, que les difl'érentes espèces, réellement comestibles, n'étaient
pas encore désignées sous des noms spéciaux, car voici tout ce que nous enseigne à ce propos
Ti-iÉornn.vsTE, dans son Histoire des plantes, près de deux siècles après Euripide.
« Toutes les plantes ne sont pas pourvues de racine, de tige, de branche, de graine, de
feuille, de fleur; il y en a même qui n'ont ni écorcc, ni moelle, ni fibres, ni veines, comme le
Champignon {mycês-¡,iy.K) et la TruD'e (hydnon-»io^) » [Liv. I, ch. ij.
« La tige (pied) du Champignon (tou myeêtos-.^ ¡riy-r-oi) est d'une régularité plus parfaite
que celle du Cyperus et du BiUomus i [Liv. I, ch. v].
<i Les caractères différentiels que l'on tire de la racine ne peuvent s'appliquer à ce qui en est
tout à fait dépourvu, comme la Truffe (lttjdnon-iS-:r.„), le Champignon (mycês-:J.iy.m), la Pézis
ra'Çiç), le Géraneion (-/efràaov) s [Liv. I, ch. vi].
(n) [l eu bon de feire remarquer ¡ci que ce uiol mjcê^ est aujcur,i-i,ui uliiisd, av.
leruic. Je (.dcu.e des Cb.mpis.cu.J, mjc.l.s», , l „ , „ ! „ „ (ecncui,
acce|)tion primitive, d.ins i.i iangue
ïi ro.iugeur do Ciiampignous).