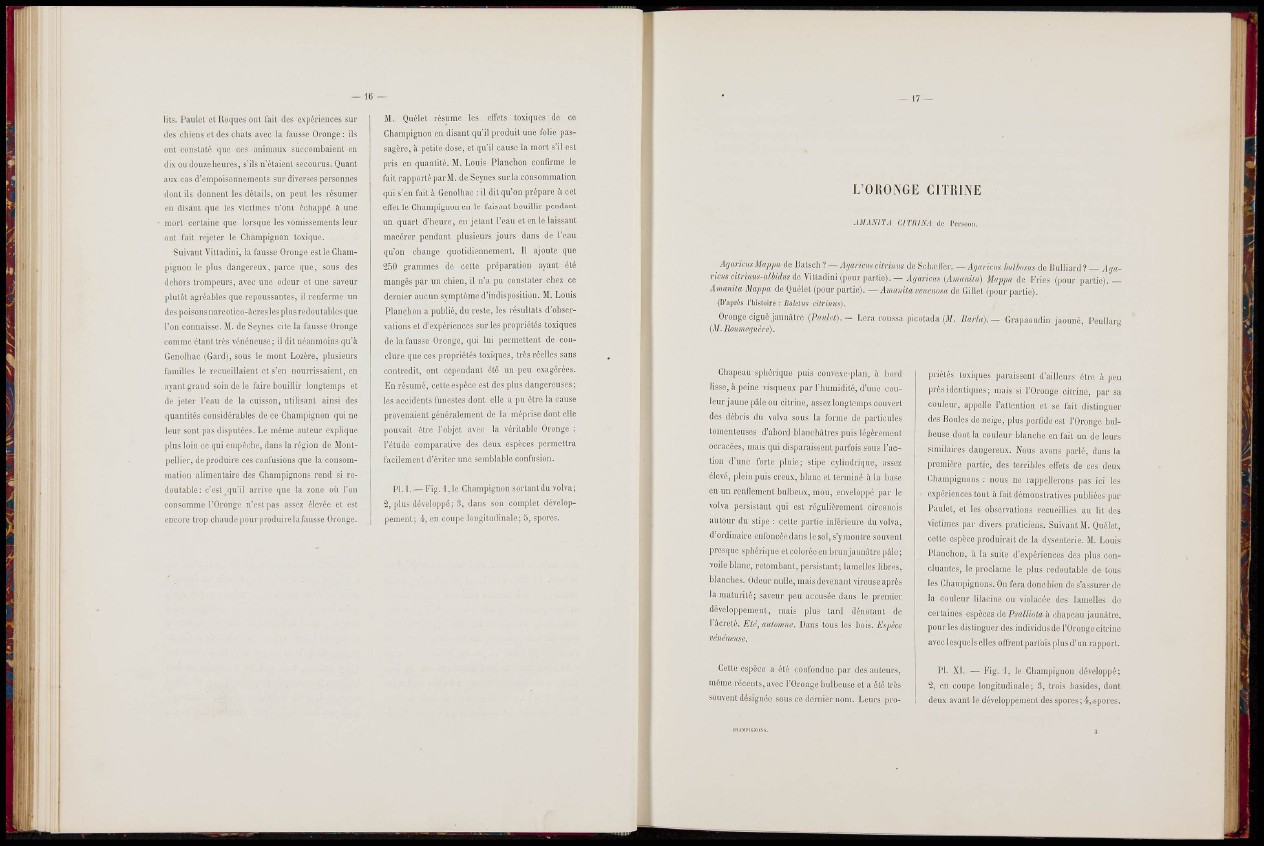
lils. Piuilel el Roques onl l'ail des cxpcricnces suv
lies chiens el des dial s avec la fausse Oronge: ils
ont conslalé que ces animaux succombaient en
tlix ou douze heures, s'ils n'élaicnl secourus. Quant
au\ cas d'cmpoisoniiemeiUs sur diverses personnes
(ioni ils donnent les détails, on peuL les résumer
en disant que les victimes n'ont échappé <\ une
• mort certaine que lorsque les vomissements leur
ont l'ait rejeler le Champignon toxique.
SuivaiU Viitadini, la fausse Oronge est le Champignon
le plus dangereux, parce que, sons des
dehors trompeurs, avec une odeur et une saveur
plutôt agréables que repoussantes, il renferme un
despoisonsnarcotico-àcreslesplusredouiablesque
l ' on connaisse. M. de Scynes cite la fausse Oronge
comme étant très vénéneuse; il dit néanmoins qu'il
Genolhac (Gard), sous le mont Lozère, plusieurs
familles le recueillaieut et s'en nourrissaient, en
ayant grand soin de le faire bouillir lonijtemps et
de jeter l'eau de la cuisson, lUilisant ainsi des
quantités considérables de ce Champignon qui ne
leur sont pas disputées. Le même auteur explique
plus loin ce qui empêche, dans la région de Montpellier,
de produire ces confusions que la consommation
alimentaire des Champignons rend si redoutable:
c'est qu'il arrive que la zone où l'on
consomme l'Oronge n'est pas assez élevée et est
encore trop chaude pour produire la fausse Oronge.
M. Quélet résume ¡es effets toxiques de ce
Champignon en disant qu'il produit une folie passagère,
à petite dose, et qu'il cause la mort s'il est
pris en quantité. M. Louis Planchón confirme le
fait rapporté par M . de Seynes sur la consommation
qui s'en fait à Genolhac : il dit qu'on prépare ii cet
effet le Champignon en le faisant bouillir pendant
u n quart d'heure, en jetant l'eau et en le laissant
macérer pendant plusieurs jours dans de l'eau
qu'on change quotidiennement. Il ajoute que
250 grammes de cette préparation ayant élc
mangés par un chien, il n'a pu constater chez ce
dernier aucun symptôme d'indisposition. M. Louis
Planchón a publié, du reste, les résultats d'observalions
et d'expériences sur les propriétés toxiques
de la fausse Oronge, qui lui permettent de conclure
que ces propriétés toxiques, très réelles sans
contredit, ont cependant été un peu exagérées.
E n résumé, cette espèce est des plus dangereuses;
les accidents funestes dont elle a pu être la cause
provenaient généralement de la méprise dont elle
pouvait être l'objet avec la véritable Oronge ;
l'étude comparative des deux espèces permettra
facilement d'éviter une semblable confusion.
PI, 1. — Fig. I. le Champignon sortant du volva;
2, plus développé; 3, dans son complet développement;
en coupe longitudinale; 5, spores.
L ' O l l O i N G E CITRINE
.IJ/.-IA7ÏV1 CJrilINÁ dL' l'ersuoii.
Aguricus.Mappa de Bnlsch-i — A'jaricui! cUrinus de Sclioellcr. —Ayanciis hulbcmis de l î i i l l iard? — /l^«-
r/ci« de Vittadini (pour partie). — ArjaricuH {AmanUa) Mapjju de Fries (pour jiartie). —
Amanita Mappa de Quélet (pour partie). — Amanita oenenosa de Gillet (pour partie).
(D'après l'histoire : Bolelus citrinus).
Oronge ciguë jauniitre {Pauln).- Leni roussa picoLada (J/. BurUi).— Grapaoudin jaouné, Peullarg
{M.Roi(inp.gticre).
Chapeau sjjhérique puis convuxe-phiu, à bord
lisse, à peine visqueux par l'humidité, d'une couleur
jaune pâle ou citrine, assez longtemps couvert
des débris du volva sous la forme de particules
tomenteuses d'abord blanchiltres puis légèrement
ocracces, mais qui disparaissent parfois sous l'action
d'une forte pliae; stipe cylindrique, assez
élevé, plein puis creux, blanc et terminé à la base
en un renilemcnt bulbeux, mou, enveloppé par le
volva persistant qui est régulièrement circoncis
autour du stipe : cette partie inférieure du volva,
d'ordinaire cnfbncécdans le sol, s 'ymont re souvent
presque spliérique et colorée en bruujauniitrepaie;
voile blanc, retombant, persistant; lamelles libres,
blanciies. Odeur nulle, mai s devenant vireuse après
ia maturité; saveur peu accusée dans le premier
développement, mais plus Lard dénotant de
l'iicreté. Été, aiUomne. Dans tous les bois. Espèce
véneneuse.
Cette espèce a été confondue par des auteurs,
môme récents, avec l'Oronge bulbeuse et a été très
souvent désignée sous ce dernier nom. Leurs propriétés
tüxi(¡ues paraissent d'ailleui'S être à peu
prés identiques; nuiis si l'Oi'onge citrine, par sa
couleur, appelle l'attention et se fait distinguer
des Boules de neige, plus perfide est l'Oronge bulbeuse
dont la couleur blanche en l'ait un de leurs
similaires dangereux. Nous avons parié, dans la
première partie, dos terribles effets de ces deux
Champignons : nous ne rappellerons pas ici les
expériences tout à faildcmonstratives publiées par
Paulet, et les observations recueillies au lit des
victimes par divers praticiens. Suivant M. Quélet,
cette espèce produirait de la dysenterie. M. Louis
Planchón, h ta suite d'expériences des plus concluantes,
le proclame le plus redoutable de tous
les Champignons. On fera donc bien de s'assurer de
la couleur lilacinc ou violacée des lamelles de
certaines espèces tie PsaUiula à chapeau jaunâtre,
pour les distinguer des individus de l'Oronge citrine
avec lesquels elles offrentparfoisplusd'un rapport.
Pl. XI. — Kig. 1, le Champignon développé;
2, en coupe longitudinale; 3, trois basides, dont
deux avant le développement des spores; 4, spores.