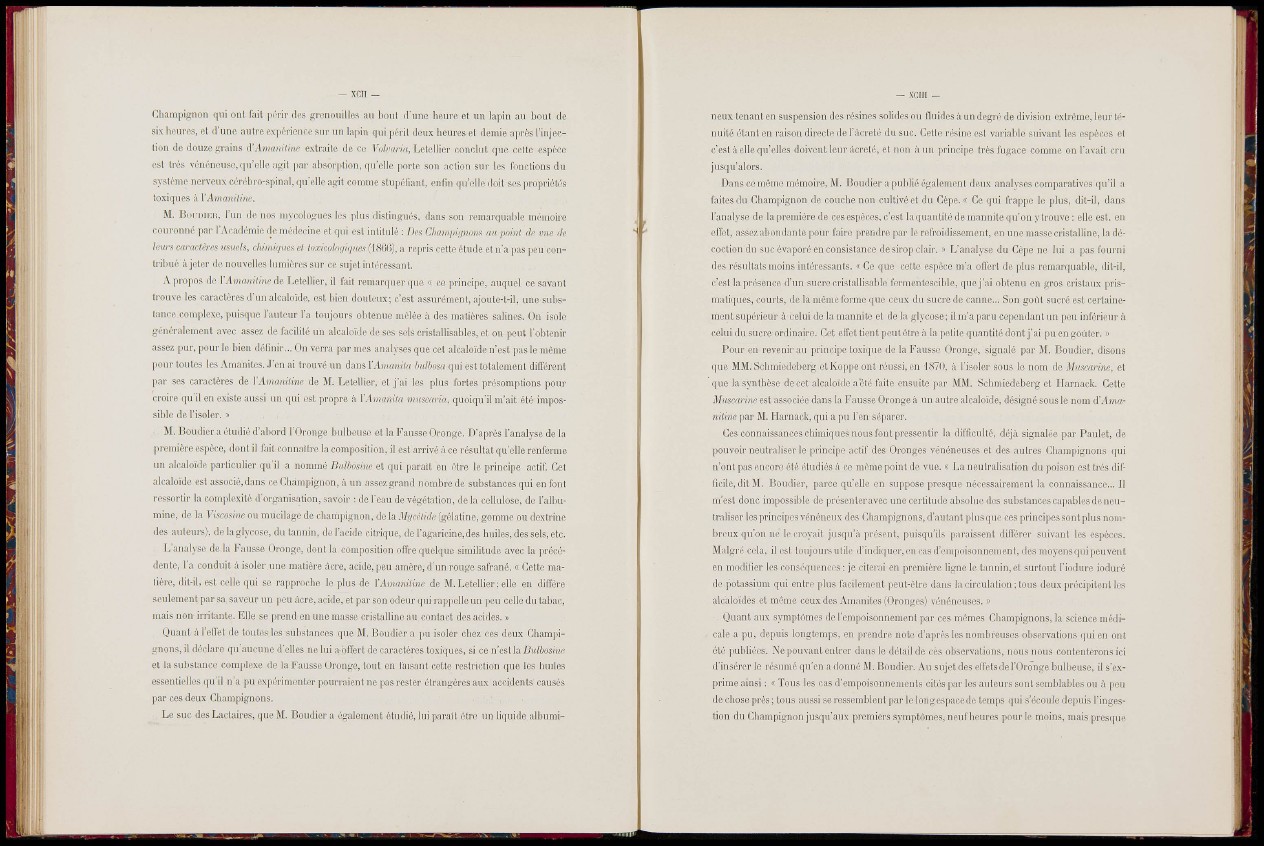
— XCII —
riiniTipignon qui onl. fait prrir des grenouilles an boni, d'une heure et un lapin au bout de
six heures, et d'une autre ex|ióriencc sur un lapin qui pófil deux heures et demie après i'injeclion
de douze grains ii'Amaihitnw extraite de ce Vulvaria, Letellier conclut que cette espèce
est Irès vén('meuse,qu'elle agit par absorption, qu'elle porte son action sur les fonctions du
système nerveux cérébro-spinal, qu'elle agit comme slupéfiant, entin qu'elle doit ses ]iropriétés
toxiques à VAmamlino.
M. Borimeli, l'un de nos mycologues les plus distingués, dans son remarquable mémoire
couronné par l'Ai'adémie de médecine et qui est intitulé : Drs Championom nu point de vue <h
hiun cararières uswh, chi m ni nés el. toxicûio(/i.qne.< (.1 tSCO), a re[iris cette étude et n'a pas peu contribué
à jeter de nouvelles lumières sur ce sujet inli'ressant.
Apropos de VAinaniline de Letellier, il fait reman^uer que « ce ¡nincipe, auquel ce savant
trouve les caractères d'un alcaloïde, est bien douteux; c'est assurément, ajoute-t-il, une substance
comjilexe, puisque l'auteur î'a toujours obtenue mêlée à des matières salines. On isole
généralement avec assez de facilité u n alcaloïde de ses sels cristallisables, et on peut l'obtenir
assez ])ur, pour le bien déllnir... On verra par mes analyses que cet alcaloïde n'est pas le même
pour toutes les Amanites. J'en ai trouvé u n dans YAniamla hnibosa qui est totalement différent
par ses caractères de ÏAmaniiine de M. Letellier, et j'ai les plus fortes présomptions pour
croire qu'il en existe aussi un qui est propre à ì'Ama.iiìla ììiuscaiw, quoiqu'il m'ait été impossible
de l'isoler. »
M. Boudier a étudié d'abord l'Oronge bulbeuse et la Fausse Oronge. D'après l'analyse delà
lu^emière espèce, dont il fait connaître la composition, i I est arrivé à ce résultat qu'elle renferme
un alcaloïde particulier qu'il a nommé Bnilmine et qui paraît en être le principe actif. Cet
alcaloïde est associé, dans ce Champignon, à u n assez grand nombre de substances qui en font
ressortir la complexité d'organisation, savoir : de l'eau de végétation, de la cellulose, de l'albumine,
de la Viscosme ou mucilage de champignon, de la Mycélide (gélatine, gomme ou dextrine
des auleurs), delaglycose, du tannin, de l'acide citrique, de l'agaricine.des huiles, des sels, etc.
L a]ialyse de la Fausse Oronge, dont la composition offre quelque shnilitude avec la précédente,
l'a conduit à isoler une matière acre, acide, peu amère, d'un rouge safrané. « Cette matière,
dit-il, est celle qui se rapproche le plus de AmcmUine de M. Letellier; elle en diffère
seulement par sa saveur un peu àcre, acide, et par son odeur qui rappelle un peu celle du tabac,
mais non irritante. Elle se ¡irend en une masse cristalline au contact des acides. »
Quant à l'effet de toutes les substances que M. Boudier a ])U isoler chez ces deux Chamjiignons,
il déclare qu'aucune d'elles n e lui a pffert de caractères toxiques, si ce n'est la/Mtemr ;
et la substance complexe de la Fausse Oronge, tout en faisant cette restriction que les huiles
essentielles qu'il n' a pu expérimenter pourraient ne pas rester étrangères aux accidents causés
par ces deux Champignons.
Le suc des Lactaires, que M. Boudier a également étudié, lui paraît être un liquide albumineux
tenant en suspension des résines solides ou ihiidesà un degré de division extrême, leur ténuité
étant en raison directe de l'àcreté du suc. Celle résine est variable suivant les espèces et
c'est à elle qu'elles doivent leur âcreté, et non à un principe très fugace comme on l'avait cru
jusqu'alors.
Dans ce même mémoire, M. Boudier a publié également deux analyses comparatives qu'il a
faites du Champignon de couche non cultivée! du Cèpe. « Ce (jui frappe le plus, dit-il, dans
l'analyse de la première de ces espèces, c'est la quai dité de manni t e (|u'on y trouve : elle est, en
eff'et, assez abondant e pour faire prendre par le refroidissement, en unemassecristalline, la décoction
du suc évaporé en consistance desirop clair. » L'analyse du Cèpe ne lui a pas fourni
des résultats moins intéressants. « Ce que cette espèce m' a offert de plus remarquable, dit-il,
c'est la présence d'un sucre cristallisable fernientescible, que j'ai obtenu en gros cristaux prismatiques,
courts, de la même forme que ceux du sucre de canne... Son goût sucré est certainement
supérieur ci celui del à mannite et de la. glycose; il m'a paru cependant un peu inférieur à
celui du sucre ordinaire. Cet effet tient peut être à la petite quantité dont j'ai pu en goûter, s
Pour en revenir au principe toxique de la Fausse Oronge, signalé par M. Boudier, disons
que MM. Schmiedeberg etKoppeont réussi, en 18/1), à l'isoler sous le nom de Mancarine, et
que la synthèse de cet alcaloïde a été faite ensuite par MM. Schmiedeberg et ITarnack. Cette
Muscarine est associée dans la Fausse Oronge à un autre alcaloïde, désigné sous le nom iXAmanitine
par M. Harnack, qui a pu l'en séparer.
Ces connaissanceschimiquesnousfontpressent i r la difficulté, déjà signalée par Paulet, de
pouvoir neutraliser le principe actif des Oronges vénéneuses et des autres Champignons f[ui
n'ont pas encore été étudiés à ce môme point de vue. c La neutralisation du poison est très difficile,
dit M. Boudier, parce qu'elle en suppose presque nécessairement la connaissance... Tl
m'est donc impossible de présenter avec une certitude absolue des substances capables de neutraliser
les principes vénéneux des Champignons, d'autant i)hisque ces principes sont plus nombreux
qu'on ne locroyaif. jusqii'à ]-)résout, puisqu'ils paraissent différer suivant les espèces.
Malgi'é cela, il est loujoursutilc d'indiquer,en cas d'empoisonnement , des moyensquipeuvent
en modilier les conséquences : je citerai en première ligne le tannin, et surtout l'induré ioduré
de potassium qui entre plus facilement peut-être dans la circulation ; tous deux précipitent les
alcaloïdes et môme ceux des Amanites (Oronges) vénéneuses. »
Quant aux symptômes de l'empoisonnement par ces mêmes Champignons, la sciencemédicale
a pu, depuis longtemps, en prendre note d'après les nombreuses observations (|ui en ont
élé publiées. Ne pouvant entrer dans le détail de ces observations, nous nous contenterons ici
d'insérer le résumé qu'en adonné M. Boudier. Au sujet des ellèts de l'Oronge bulbeuse, ii s'exprime
ainsi : « Tous les cas d'empoisonnement s cités |.)ar les auteurs sont semblables ou à peu
dechoseprés; tous aussi se ressemblent par le long espace de temps quis'écoule depuis l'ingestion
du Champignon jusqu'aux premiers symptômes, neuf heures pour le moins, mais presque