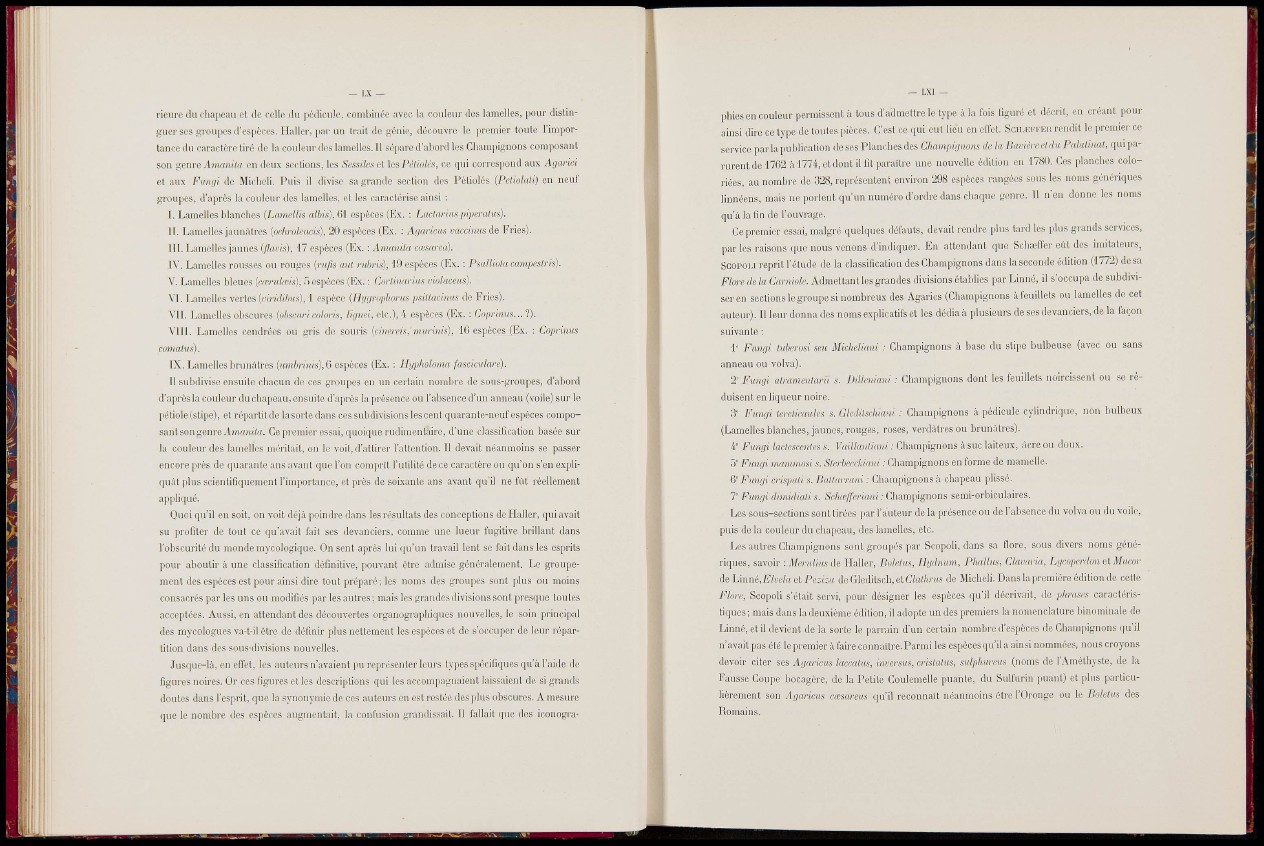
rieure du cliapeau et de celle du pédicule, combinée avec la couleur des lamelles, pour distinguer
ses lirouiies d'espèces. Ilaller, i)ar un Irait de génie, découvre le premier toute l'importance
du caractère tiré de la couleur des lamelles. Il sépare d'abord les Ciiampignons composant
son genre AmanHa en deux sections, les Sesùlea et lesiV/i'o/('.s, ce qui correspond aux Agarici
et aux Famji de Miclieli. Puis il divise sa grande section des Pôtiolés (Petiolali) en neuf
groupes, d'après la couleur des lamelles, et les caractérisé ainsi :
I. Lamelles blanches (LameUis nlbis)jyi espèces (Ex. : Laclarùis ¡¡ipmilus).
I [. Lamelles jaunâtres {ochroleuch), 20 espèces (Ex. : Agaricns vaccinus de Fries).
Ml. Lamelles jaunes {fluvia), 17 espèces (Ex. : Amauiia camroa).
\ \ . Lamelles rousses ou rouges {rnfis mil nibris), 10 espèces (Ex. : PsdUiolacampeslris).
V. Lamelles bleues (coeraloels), 5 espèces (Ex. : Cortinariiis violaceus).
\ l . Lamelles vertes (i'/r/'W)«.,s), i. espèce {niigrupJiorus psitlacimis de l^'^ries).
VII. T.amelles obscures {ohsciiri coloris, liynei, etc.), espèces : Coprlnus... ?).
VI 11. Lamelles cendrées ou gris de souris {cinereis, miirinis), 'JO espèces (Ex. ; Coprimis
comahis).
IX, Lamelles brunâtres {umbrinis),(j espèces (Ex. : Jiijpkolonia fascicalare).
II subdivise ensuite chacun de ces groupes en un certain nombre de sous-groupes, d'abord
d'après la couleur du chapeau, ensuite d'après la présence ou l'absence d'un anneau (voile) sur le
pétiole(slipe), et répartit de la sorte dans ces subdivisions les cent quarante-neuf espèces composant
son genre-AHirt?i//o. Ce premier essai, quoique rudimentaire, d'une classiiication basée sur
la couleur des lamelles méritait, on le voit, d'attirer l'attention. 11 devait néanmoins se passer
encore près de quarante ans avant que l'on comprit l'utilité de ce caractère ou qu'on s'en exj)liquàt
plus scientifiquement l'importance, et près de soixante ans avant qu'il ne fut réellement
appliqué.
Quoiqu41 en soit, on voit déjà poindre dans les résultats des conceptions delTalier, qui avait
su profiter de tout ce qu'avait fail ses devanciers, comme une lueur fugitive brillant dans
l'obscurité du mondemycologique. On sent après lui qu'un travail lent se fait dans les esprits
pour aboutir à une classification définitive, pouvant être admise généralement. Le groupement
des espèces est pour ainsi dire tout préparé; les noms des groupes sont plus ou moins
consacrés par les uns ou modifiés par les autres ; mais les grandes divisions sont presque toutes
acceptées. Aussi, en attendant des découvertes organographiques nouvelles, le soin principal
des mycologues va-t-il être de définir plus nettement les espèces et de s'occuper de leur répartition
dans des sous-divisions nouvelles.
Jusque-là, en effet, les auteurs n'avaient i)u représenter leurs types spécifiques qu'al'iiide de
figures noires. Or ces figures et les descriptions qui les accompagnaient laissaient de si grands
doutes dans l'esprit, que la synonymie de ces auteurs en est restée des plus obscures. A mesure
que le nombre des espèces augmentait, la confusion grandissait. Il fallait (pie des iconographies
en couleur permissent à tous d'admettre le type à la fois figuré et décrit, en créant ¡¡ouiainsi
dire ce type de toutes pièces. (Vest ce <iui eut lieu en clfet. Sci lkf fek rendit le premier ce
service par la publication de ses Planches des Cliauipiglions de la Bavière el du PahUinal, q lu f»arurent
de 17G2 à 177^1, e tdont il fit paraître une nouvelle édition en 1780. Ces planches coloriées,
au nombre de 328, représentent environ 298 espèces rangées sous les noms génériques
linnéens, mais ne portent qu'un numéro d'ordre dans chaque genre. Il n'en donne les noms
qu'à la fin de l'ouvrage.
Ce premier essai, malgré quelques défauts, devait rendre plus tard les plus grands services,
par les raisons iiue nous venons d'indiquer. En attendant que Scbasfièr eût des imitateurs,
SCOPOLI reprit l'étude de la classification des Champignons dans la seconde édition (1772) desa
Flore de la Carmole. Admettantles grandes divisions établies par Linné, il s'occupa de subdiviser
en secfionslegroupesi nombreux des Agarics (Champignons àfeuillets ou lamelles de cet
auteur). Il leur donna des noms explicatifs et les dédia à plusieurs de ses devanciers, de la fanon
suivante :
1" Fungi luberosi seu Miclieliam : Champignons à base du stipe bulbeuse (avec ou sans
anneau ou volva).
2' Fungi alrameniarii s. DiUeniani : Champignons dont les feuillets noircissent ou se réduisent
en liqueur noire.
3" Fitngi lerekoaules s. Gledilschiani : Cliampignons à pédicule cylindrique, non bulbeux
(Lamelles blanches, jaunes, rouges, roses, vcrdàtres ou brunâtres).
4" Fungi laclcscenles s. Vatllantiani : Champignons à suc laiteux, acre ou doux.
5" Fiingi mamrnosi s. Slerbeeckirmi : Champignons en forme de mamelle.
6" Fungi crispait s. Dallarrani : Champignons à chapeau plissé.
T Fungi dimidtali .s. Schoe/feriani : Champignons semi-orbiculaires.
Les sous-sections sont tirées par l'auteur de la présence ou de l'absence du volva ou du voile,
puis del à couleur du chapeau, des lamelles, etc.
Les autres Champignons sont groupés par Scopoli, dans sa flore, sous divers noms génériques,
savoir : Men.diu,s c\e Haller, Boletus, JJydmm, Phallus, Clavaria, Lgcoperdon ei Muoer
àeUnné,Flvela el Peziza deGleditsch,etC/(i//irzi.s de Micheli. Dans la première édition de cette
Flore, Scopoli s'était servi, pour désigner les espèces ([u'il décrivait, de phrases caractéristiques;
mais daiis la deuxième édition, il adopte un des premiers la nomenclature binominale de
Linné, et il devient de la sorte le parrain d'un certain nombre d'espèces de Champignons qu'il
n'avait pas été le premier à faire connaître. Parmi les espèces qu'il a ainsi nommées, nous croyons
devoir citer ses Agaricus laccalus, inversus, crislalii.% sidphareus (noms de l'Amétliyste, de la
Fausse Coupe bocagère, de la Petite Coulemelle puante, du Sulfarin puanQ et plus particulièrement
son Agaricus coesarem (p.i'il reconnaît néanmoins être l'Oronge oa le Bolelas des
Romains.