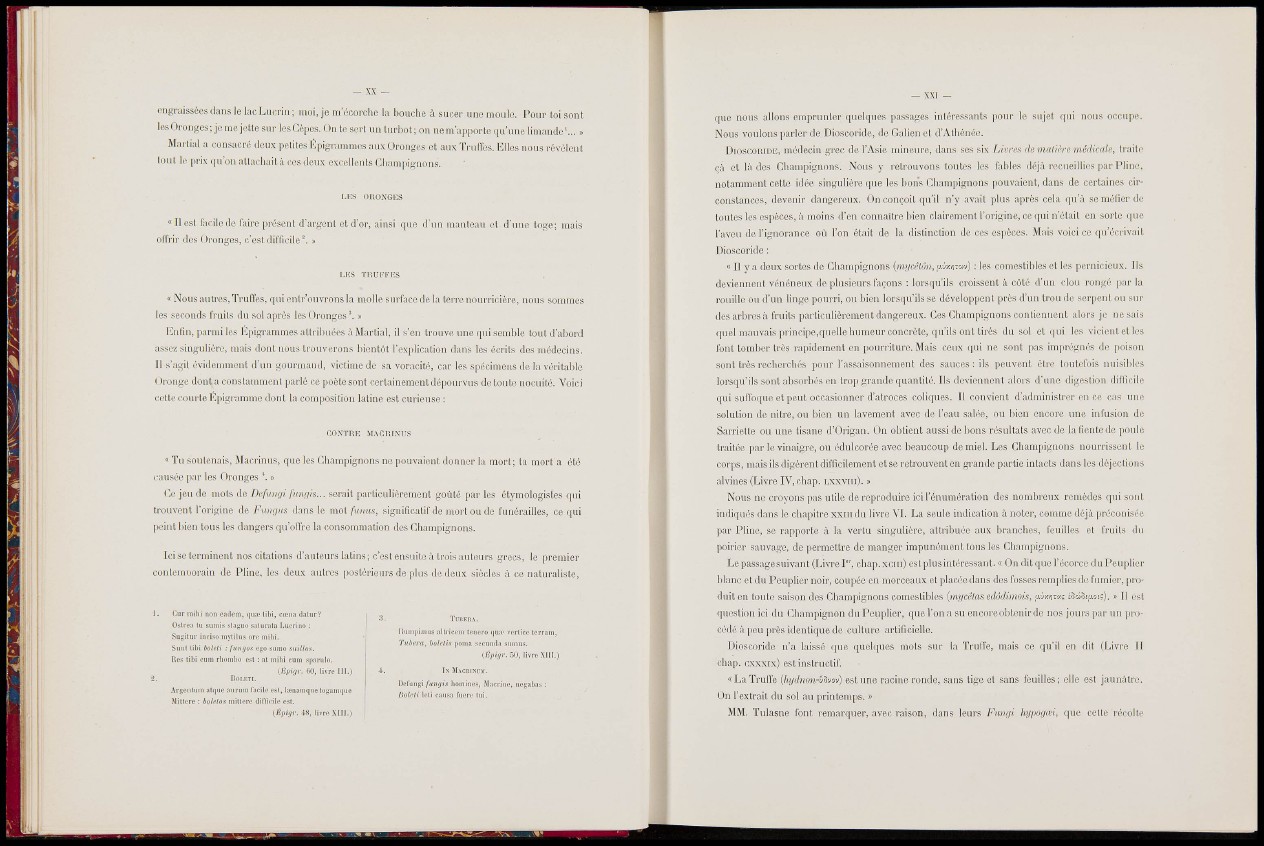
e n g r a i s s é e s dans le lac Liicriii ; moi, j e m ecorciie lu bouche à sucer une moule. Pour toi sont
les O r o n g e s ; j e me jeUe sur les Cèpes. Ou te sert uu Lurbot; ou ne m' appor t e qu'une l imande' . . . »
Martial a consacré deux petites l-]pigTammcs au.K O r o n g e s et aux 'rrulies. El les n o u s révèlent
l o n t Ir p r ixipi 'onat tachai t i ïccsi lcux CKccllonts Champignons.
LES ORONGES
« Il est i'acilc lie faire [n-osent d'ar^'cut et d'or, ainsi (pie d'un manleau et d'iuie Loge; mais
o f f r i r des < ) ronges , c'est difficile ^ »
l . l iS TUUri'ES
« N o u s aut res , Truf fes , qui e n t r o u v r o n s la molle surface de la terre nour r icière, nous sommes
les seconds IVuils du soi après lesOi'onges^. »
l ù i l i n , parmi les l'^pigrammes at tribuées àAIartial, il s'en trouve une qui s embl e lont d'abord
assez singulière, mais dont nous trouverons bientôt rexplicaliou dans les écrits des médecins.
Il s'agit évidemment d'un gourmand, victime de sa voracité, car les spécimens de la véritable
( )i'onge dont a c o n s t amme n t parlé ce poèt e sont certainement dépourvus de tont e nocuité. Voici
cetto coni'te l'^pigramme dont la composi t ion latine est cur ieuse :
r.OXTRR MACniNUS
« T u soutenais, Macrinus, que les Cl iampignons ne pouvaient donner la mort; ta mort a été
c a u s é e par les Oronges \ »
( ' e jeu de mots de Defuurji fiingis... serait particulièrement goûté par les élymologistes qni
ti'ouvent l'origine de Finifitis dans le mot fiinus, significatif de mort ou de funérailles, ce qui
l*einl bien tous les danger s qu'olfre la consommat ion des (Cliampignons.
Ici se terminent nos citations d'auteurs latins; c'est ensui t e à trois auteur s grecs, le premier
c o n t e m n o r a i n de Pline, les deux autres iiostérieurs de plus de deux siècles à ce naturaliste,
d u r milii non cailem, quic
Oslioa tu siimis .slaiiiio sitliirala Lu
Sugilur inciso mylilus oro milii.
Siiiil libi boleti : fumjo^ ego s
Res libi cum rlir.nilio est ; al m
{Épùjv.i:,0, livre ill.)
lìOMCTl.
Argunluni alijue aunim facili; esl , Irennmqite loganique
Millere : bolf'ios inillcre difficile osi,
( E i i i g r . 48, livroXIll.)
TIINF.RV.
Iiiini|iimiis alli'iceiii Kinoro I|U.T VDI'UCC terrain,
Tiihera, l/olelis poma spcunda siimiis.
{Épiyr. 50, livre Xill.)
ÌM MACRINDJI.
Dcl'iiiigi famjia lioinine?, Macrino, negaljas ;
lloìcti Idi causa fuecc lui.
q u e nous allons emprunter c[uelques yiassages intéressants pour le sujet ([iii nous occupe,
Nous voulons parler de Dioscoride, de Galien et d'Adiénée.
DioscoRinii, médecin grec de l'Asie mineure, dans ses six Livres de malins médiaile, traite
çà et là des Champignons. Nous y retrouvons toutes les fables déjà recueillies par Pline,
n o t a m m e n t cette idée singulière que les bons C^lbampignons pouvaient, dans de certaines circ
o n s t a n c e s , devenir dangereux. On conçoit qu'il n'y avait plus après cela qu'à sernclierrle
toutes les espèces, à moins d'en connaître bien clairement l'origine, ce (.|ui n'étai t en sorte (pie
l ' a v e u de l ' ignorance où l'on était de la distinction de ces espèces. Mais voici ce qu'écrivait
Dioscoride :
« Il y a deux sortes de Champignons {niycplôn, ¡j-órfjr'M) : les comestibles et les pernicieux. Ils
d e v i e n n e n t vénéneux de plusieurs façons : lorsqu'ils croissent à côté d'un clou rongé par la
r o u i l l e o u d 'un linge pour r i , ou bien lorsqu'ils se développent près d 'un trou de serpent ou sur
des a rbr e s à fruits par t icul ièrement dangereux. Ces Champignons cont iennent alors je ne sais
f[uel mauvai s principe,quelle h ume u r concrète, qu'ils ont tirés du sol et (¡ni les vicient et les
font tomber très rapidement en pourriture. Mais ceux qui ne sont pas imprégnés i.le poison
sont très recherchés pour l'assaisoniiement des sauces: ils peuvent être toutefois nuisibles
l o r s q u ' i l s sont absorbés en trop g rande quantité. Ils deviennent aloi'S d'une digestion diflicile
c|ui sulfoque et peut occasionner d'atroces coliques. Il convient d'administrer en ce cas une
s o l u t i o n de nitre, ou bien un lavement avec de l'eau sahie, ou bien encore une infusion de
S a r r i e t t e ou une tisane d'Origan. On obtient aussi de bons résultats avec de la fient e d e poule
t r a i t é e par le v inaigre, ou édiilcorée avec beaucoup de miel . Les Champignons nourrissent le
corps, mai s ils d igè r ent di f f ici lement e t s e ret rouvent en g r ande partie intact s dans les déjections
alviues (Livre IV, chap. Lxxvni). »
Nous ne croyons pas utile de reprodui r e ici r ému n é r a t i o n des nombreux remèdes qui sont
i n d i q u é s dans le chapi t r e x x n t d u livre VI. La seule indication à noter, comme déj à iiréconisée
p a r Pline, se rapporte à la vertu singulière, attribuée aux branches, feuilles et fruits du
poirier sauvage, de permet t r e de mange r impunément tous les Champignons.
L e pas sagesuivant (Livre?' ' , chap.xcin) est p lus intéres sant . « O n d i t quel 'écorce du Peuplier
b l a n c et d u Peupl ier noir, coupée en morceaux et placée d a n s des fosses r emp l i e s de f umi e r , prod
u i t e n toute saison des Champignons comestibles {mycêtas edôdiinois, aijxvjra; ¿SióSiaot;). » 11 est
q u e s t i o n ici du Champignon du Peuj)lier, que l'on a su encore obteni r de nos jour s par u n procédé
à peu près ident ique de culture artificielle.
Dioscoride n'a laissé que quelques mots sur la Truffe, mais ce qu'il en dit (Livre 11
chap, cxxxtx) est instructif.
« L a Trul l e {hydnon-û^vov) est une racine ronde, sans tige et sans feuilles ; elle est jaunâtre.
On l'extrait du sol au printemps, a
MM, Tulasne font remarquer, avec raison, dans leurs Fuiu/l hypo'joei, que celle récolte