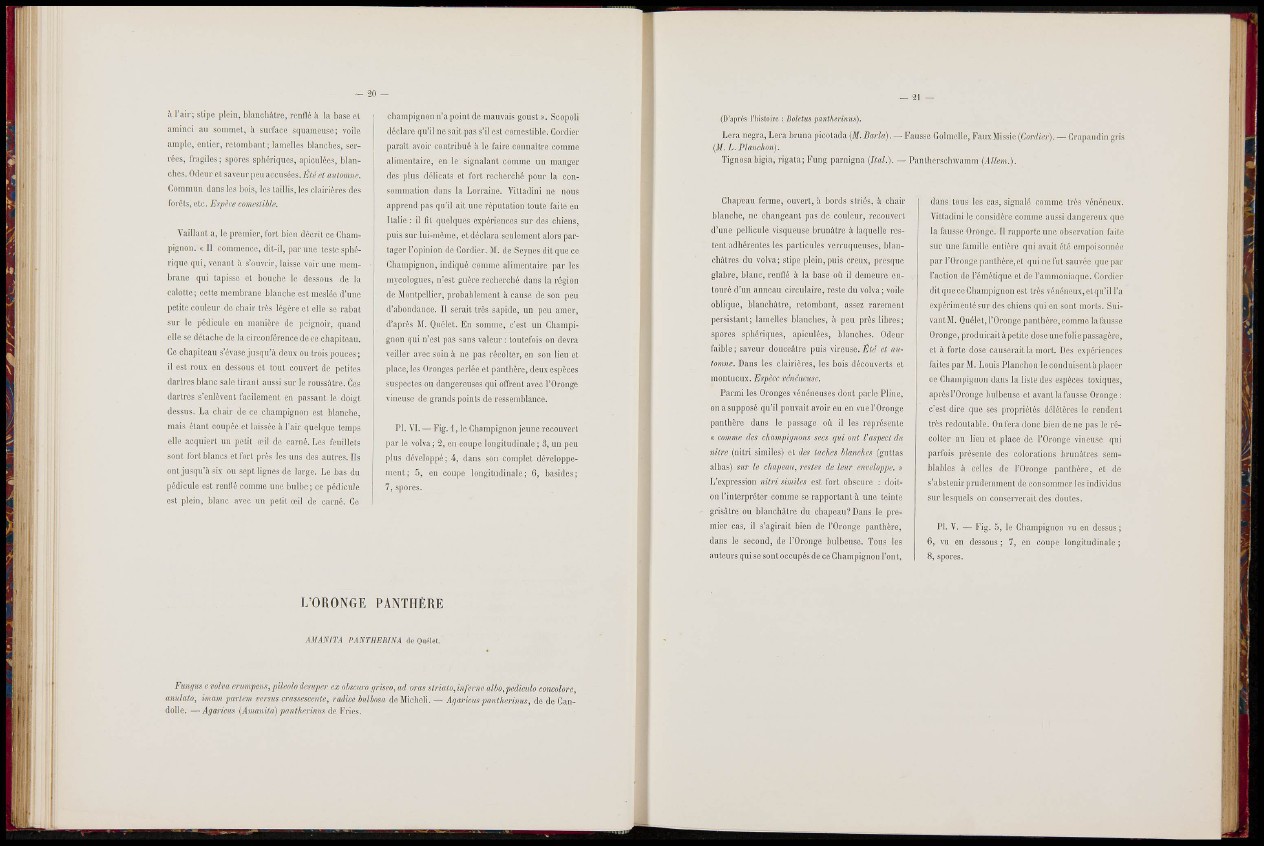
l ' a i r ; slipe plt^in, hi aneli a i r e , ranilé i\ la bnse el
aminci au soinmcl, h surface squaraeiiso; voile
am[)le, enlicr, relanibaril; lamelles blanches, serrées,
fragiles; spores sphériques, apicuïées, bhuiches.
Odeur el saveur peu accusées. ì'Jlé l't ciuloiniic.
Commun dans les bois, les laillis, les clairiiircs des
Ibrêts, etc. E-^prre comesiihle.
Vailliiiil a, le premier, ibrl bien décril ce f.liampisnon.
« 11 coiimience, dil-il, par une teste spliórique
i]ui, venaiil h s'ouvrir, laisse voir une memb
r a n e qui lapisse et. bouche le dessous de la
c a l o l l e ; celle membrane blanche est meslée d'une
pelile couleur de chair 1res légère et elle se rabat
sur le pédicule en manière de peignoir, quand
elle se détache de la c i r eonr é r enc ede c e chapiteau.
Ce chapi teau s'évase jusqu' i l deux ou trois pouces ;
il est roux en dessous et tout couvert de pcliles
d a r t r e s b l a r i c sale tirant aussi sur le roussât re. Ces
d a r t r e s s'enlèvent facilement en passant le doigt
dessus. La chair de ce champignon est blanche,
mais étant coupée et laissée à l 'ai r quelque temps
elle acquiert un petit oeil de carné. Les feuillets
sont fort b lancs et fort près les uns des autres. Ils
ont j u s q u ' à six ou sept lignes de large. Le bas du
pédicule est renflé comme une bulbe; ce pédicule
est plein, blanc avec un petit oeil de carné. Ce
champignon n'a point de mauvais gousl ». Scopoli
d é c l a r e qu'il ne sait pas s'il est comestible. Cordier
piiraît avoir contribue à le faire connaître comme
a l i m e n t a i r e , en le signalant comme un manger
des plus délicats et fort recherché pour la consommation
dans la Lorraine. Vittadini ne nous
apprend pas qu'il ait une réputation toute faite en
Italie ; il fit quelques expériences sur des chiens,
puis sur lui-même, et déclar a seulement alors partager
l'opinion de Cordier. M. de Seynes dit que ce
Champignon, indiqué comme alimentaire par les
mycologues, n'est guère recherché dans la région
de Montpellier, probablement k cause de son peu
d'abondance. Il serail très sapide, un peu amer,
d'après M. Qiiélel. En somme, c'est un Champignon
qui n'est pas sans valeur : toutefois on devra
veiller avec soin à ne pas récolter, en son lieu cl
place, les Oronges perlée et panthère, doux espèces
suspectes ou dangereuses qui oITrent avec l'Oronge
vineuse de grands points de ressemblance.
Pl. VL — Fig. '1, le Champignon jeune recouvert
p a r le volva; 2, en coupe longi tudinale; 3, un peu
plus développé; A, dans son complet développem
e n t ; r-i, en coupe longitudinale; 0, basides;
(D'après l'histoire : lioletus pantkcriniis).
Lera negra. Ler a bruna picotada (M. Baria). — Fausse Golinello, Faux Missie (Cw/w/ ' ) . — Crapandin gris
{M. L. Planchón).
Tignosa bigia, rigata; Fung parnigna {Ual.). — Panlherschwamtn {Allem.).
Chapeau ferme, ouvert, i\ bords striés, à chair
blanche, ne changeant pas de couleur, recouvert
d ' u n e pellicule visqueuse brunâtre à laquelle restent
adhérentes les particules verruquexises, blanchâtres
du volva; stipe plein, puis creux, presque
glabre, blanc, renile à la base où il demeure entouré
d'un anneau circulaire, reste du volva ; voile
oblique, blanchâtre, retombant, assez rarement
p e r s i s t a n t ; lamelles bianches, ii peu près libres;
spores sphériques, apicidées, blanches. Odeur
f a i b l e ; saveur douceSlre puis vireuse.¿"«ti' et automne.
Dans les clairières, les bois découverts et
montueux. Espèce vénéneuse.
Parmi les Oronges vénéneuses dont parle Pline,
on a suppos é qu'il pouvait avoir eu en vuel'Oronge
p a n t h è r e dans le passage où il les représente
« comme des cJumpignons secs qui ont l'aspect du
nitre (nitri similes) el des taches blanches (guttas
al bas) sur le chapeau, restes de leur enveloppe. s>
L'expression nitri similes est fort obscure : doilon
l'interpréter comme se rapportant à une teinte
g r i s â t r e ou blanchâtre du chapeau? Dans le premier
cas, il s'agirait bien de l'Oronge panthère,
dans le second, de l'Oronge bulbeuse. Tous les
autein-s qui se sont occupés de ce Champignon Ton l.
dans tous ies cas, signalé comme très vénéneux.
Vittadini le considère comme aussi dangereux (¡ue
la fausse Oronge. Il rapporte une observation faite
sur une familie entière qui avait été empoisonnée
par l'Oronge panthère,et qui ne fut sauvée quopar
l ' a c t i on de l'émétique et de l 'atnmoniaque. Cordier
dit que c eCha inpignon est très vénéneux, et qu' i l l'a
e x p é r i m e u t é s u r des chiens ((ui en sont morts. SuivanlM.
Quélel,l'Oronge panthère, comme la fausse
Oronge, produirai t à pet i te dose une folie passagère,
et h forte dose causerait la mor t . Des expériences
faites p a rM. Louis Planchón le condui s ent à placer
c e Champignon dans la liste des espèces toxiques,
a p r è s l ' O r o n g e Iiulbeuse el avani l a f aus s e Oronge :
c'est dire que ses propriétés délétères le rendent
t r è s redoutable. Onfera donc bien de ne pas le récolter
au lieu et place de l'Oronge vineuse qui
parfois présente des colorations brunâtres .semblables
à celles de l'Oronge panthère, et de
s ' a b s t e n i r p r u d e m m e n t de consommer les individus
sur lesquels on conserverait des doutes.
Pl. V. — Fig. 5, le Champignon vu en dessus;
6, vu en dessous; 7, en coupe longitudinale;
L'ORONGE PANTHÈRE
A.WAmTA PANTHESINA il» Qaflrt.
i . l î
il iC
I'll
Ftmfjíls evolva íirumpen^, pìleolo desupar Bai okctiro i/riseo, {id orm sti-mo,inferne aliio,pedículo concolore,
amlalo, imam partan versus crussescente, radice bulbosa Je Micheli. — Ai¡aricus ¡mitllieriims, de de Candolle.
—A g a r i e u s {Amanita) ¡iantherinus do Fries.