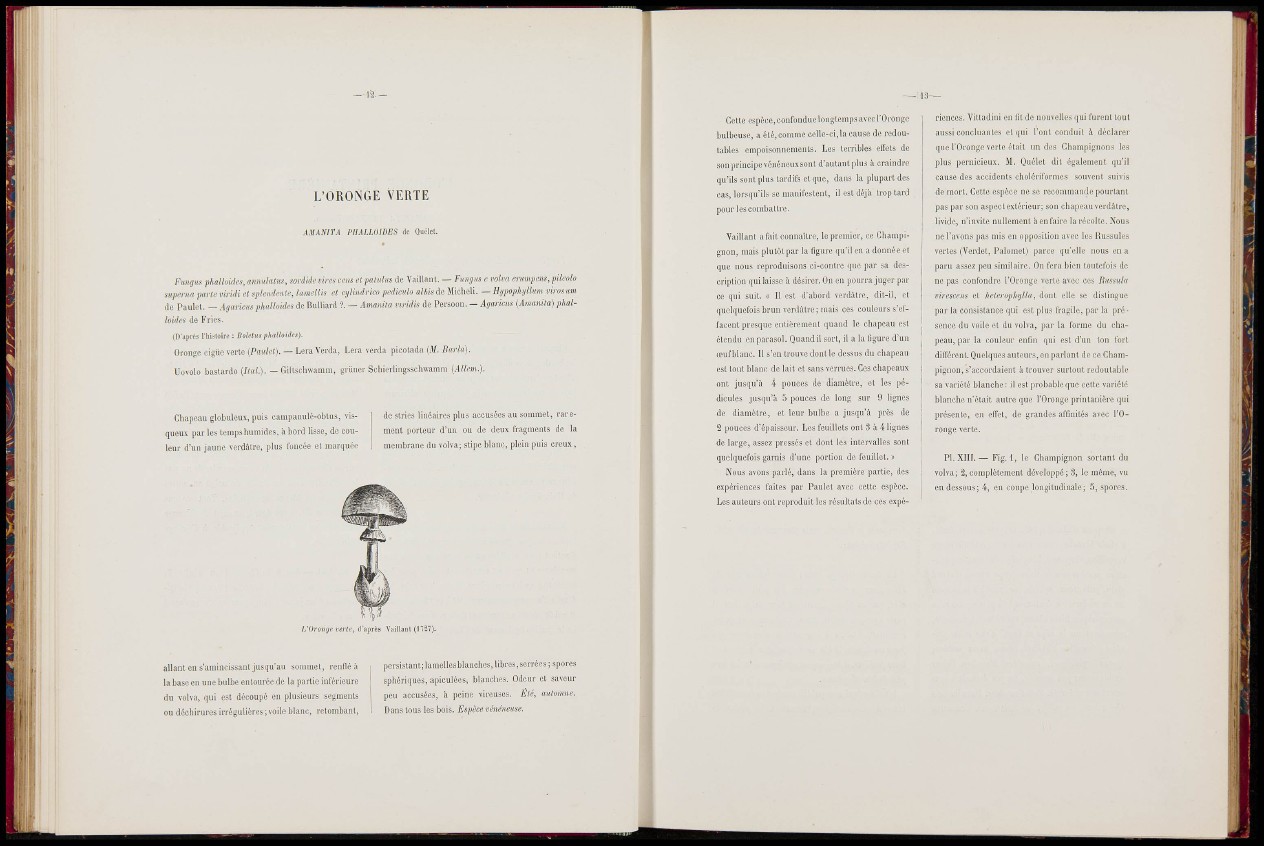
L'ORONGE VERTE
AMANITA t'IÍALLOIDES de Qu¿leL.
Fungiiít phalluides, anmdatus, sovilide vires cens ei paltdvs de YaillaiU. — Fungus e volva enimpens, pileolo
siipcnia parle viridi et splmdenie, hmeüis et cijlindrico pedículo albisde Micheli. — Ihjpophjlhim virosim
c)e Paulel . — Agaricus pkulloides de BuUiavd ?. — Amaiiila viridis de Persoon. - Ayancus {AmanUa) phalloides
de Fries.
(D'après l'histoire : Boletus phalloides).
Orouge cigüc verle (PÍTÍÍ/CÍ)- — Lera Verda, Lena verdu picotada (JV. Darla).
Uovolo bastardo [liai). — Giítscliwamm, grüner Soli ieri i i igs s chwa tnm {Allem.).
Chapeau globuleux, puis campatuilé-obtus, visqueux
par les temps humides, à bor d lisse, de couleur
d'un jaune verdâtre, plus foncée et marquée
de stries linéaires plus accusées au sommet , rarement
porteur d'un ou de deux fragments de la
membrane du volva; stipe blanc, plein puis creux,
L'Urovge tene, d'après Vaillant (17-27).
a l l a n t en s'amincissant jusqu'au sommet, renflé à
la base en une bulbe entourée de la partie inférieure
d u volva, qui est découpé en plusieurs segments
ou déchirures irréguliéres;voile blanc, retombant,
p e r s i s t a n t ; lamel lesblanches, libres, ser rées ; spores
s p h é r i q u e s , apiculées, blanches. Odeur et saveur
peu accusées, à peine vireuses. Été, automne.
Dans tous les bois. Espèce vénéneuse.
Cette espèce, confondue longtemps avec l'Oronge
bulbeuse, a été,conm-ie cclle-ci, la cause de redoutables
empoisonnements. Les terribles effets de
son p r incipevénéneuxsont d'autant plus à craindre
q u ' i l s sontplus tardifs e tque , dans la plupart des
cas, lorsqu'ils se manifestent , ilestdéjii trop lard
pour les combattre.
Vaillant a fait connaî tre, le p remier , ce Champignon,
mais plutôt par la figure qu'il en a donnée et
que nous reproduisons ci-contre que par sa description
(¡ui laisse à désirer. On en pourra juger par
ce qui suit. « Il est d'abord verdàtro, dit-il, et
quelquefois b run verdâtre; mais ces couleurs s'effacent
presque enliôremenl quand le chapeau est
étendu en parasol . Quand il sort , il a la figure d'un
oeuf blanc. Il s'en trouve dont le dessus du chapeau
est tout blanc de lait et sans verrues. Ces chapeaux
ont jusqu'il 4 pouces de diamètre, et les pédicules
jusqu'il 5 pouces de long sur 9 lignes
de diamètre, et leur bulbe a jusqu'à près de
2 pouces d'épaisseur. Les feuillets ont 3 ^ 4 lignes
de large, assez pressés et dont les intervalles sont
quelquefois garnis d'une portion de feuillet. »
Nous avons parlé, dans la première partie, des
expériences faites par Paulct avec celte espèce.
Les auteur s ont reproduit les résultats de ces expériences.
Vitladiiii en fit d e nouvelles qui furent tout
aussi concluantes ct(|ui l'ont conduit à déclarer
que l'Oronge verte était un des Champignons les
plus pernicieux. M. Quélet dit également qu'il
c a u s e des accidents cholériformes souvent suivis
de mort . Cette espèce ne se recommande pourtant
pas par son aspect extérieur; son chapeau verdiltrc,
livide, n'invite nullement àenfai r e larécolte. iNous
ne l 'avons pas mis en opposition avec les Russules
vertes (Verdel, Palomet) parce qu'elle nous on u
p a r u assez peu similaire. On fera bien toutefois de
ne pas confondre TOronge verte avec ces liussula
viresceiis et helerophylla, dont elle se dislingue
par la consistance qui est plus fragile, par la présence
du voile et du volva, par la forme du chapeau,
par la couleur enfin qui est d'un ton fort
difl'érent. Quelques auteurs, en par lant de ce Champ
i g n o n , s ' a c c o r d a i e n t il t rouver surtout redoutable
sa variété blanche : il est probabl e que cette variété
blanche n'était autre que l'Oronge printanière qui
p r é s e n t e , en cITct, de grandes affinités avec l'Oronge
verte.
Pl. X i n . — Fig. 1, le Champignon sortant du
volva; 2, complètement développé ; 3, le môme, vu
e n dessous; 4, en coupe longitudinale; 5, spores.