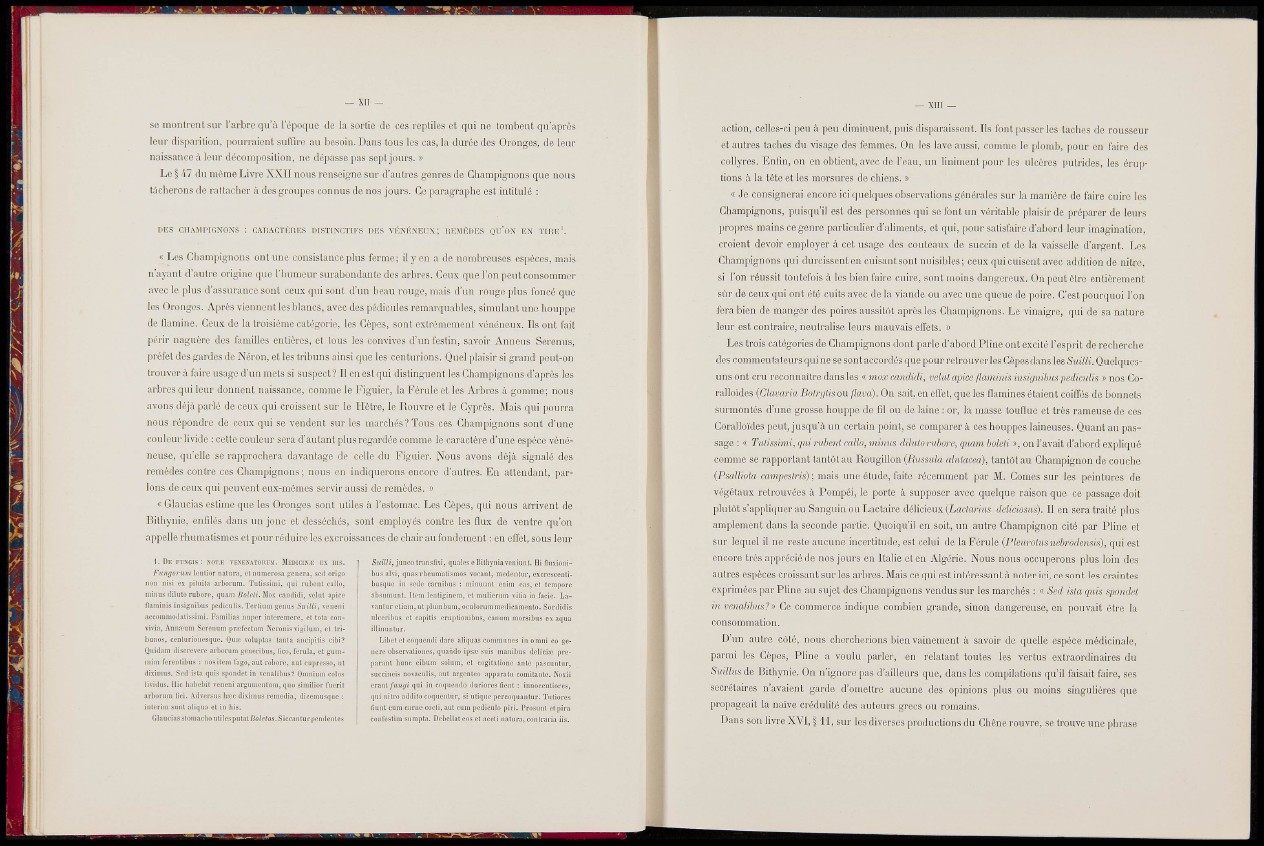
se monlrciUsur l'arbre qu'à l'époque de la sortie de ces repliles et qui ne tornbciil qu'après
leur dispiirition, pourraient suffire au besoin. Dans tous les cas, la durée des Oronges, de leiunaissance
à leur déconqiosilion, ne dépasse pas sept jours. »
Le § M du même Livre XXI I nous renseigne snr d'autres genres de Champignons que nous
lâcherons de rattacher à des groupes connus de nos jours. Ce paragraphe est intitulé :
UES CUA^U•IL;^•O^^^ t (:.A.TIACTI-:RKS PISTINCTIFS DES VKNKXEUX; REMÈDES QU'OX EN TIRE'.
« Les Champignons ont une consistance plus ferme; il y en a de nombreuses espèces, mais
n'ayant d'autre origine que l'humeur surabondante des arbres. Ceux que l'on peut consommer
avec le plus d'assurance sont ceux ([ui sont d'un beau rouge, niais d'un rouge plus foncé que
les Oronges. Après vieinient les blancs, avec des pédicules remarquables, simulant une houppe
de flamine. Ceux de la troisième catégoiie, les Cèpes, sont extrêmement vénéneux. Ils ont fait
périr naguère des familles entières, et tous les convives d'un festin, savoir Anneus Serenus,
préfet des gardes de Néron, et les tribuns ainsi que les centurions. Quel plaisir si grand peut-on
trouver à faire usage d'un mets si suspect? Il en est qui distinguent les Champignons d'après les
arbres qui leur donnent naissance, comme le Figuier, la Férul e et les Arbres à gomme; nous
avons déjà parlé de ceux qui croissent sur le Hêtre, le Rouvre et le Cyprès. Mais qui pourra
nous répondre de ceux qui se vendent sur les marchés? Tous ces Champignons sont d'une
couleur livide : cette couleur sera d'autant plus regardée comme le caraclère d'une espèce vénéneuse,
qu'elle se rapprochera davantage de celle du Figuier. Nous avons déjà signalé des
remèdes contre ces Champignons; nous en indiquerons encore d'autres. En attendant, parlons
de ceux qui peuvent eux-mêmes servir aussi de remèdes. »
« Glaucias estime que les Oronges sont utiles à l'estomac. Les Cèpes, qui nous arrivent de
Bilhynie, enfilés dans un jonc et desséchés, sont employés contre les flux de ventre qu'on
appelle rhumatismes et pour réduire les excroissances de chair au fondement ; en effet, sous leur
1. DE FUNGIS : KOT.E VESENATORDI. MEDICK Suini,i\ meo transfixi, quali ? s e B ¡tbyniaveniunt. Ili nnxioni-
Ftiiigonim leiUior natura, et numerosa gener a, sed oriso bus alvi, qnas rbeumalisrao. s Yoc; int, medentur, oxcrescenlinon
nisi ox y liluila arborum. Tutissiini, qui ri iLcnt callo, basque , in sede carnibus : minu lunt eiiim cas, et lemporD
minus (îihiior ubort", ijuam lioleli. Mox candidi, vehu apice absumur it. Item lontiginem. , et m ulicrum vitia in facic. Laa.
minis insigi lilius pediculis. Terlium gcnus Su iiiì, vcneni vantar etiam,ut plumbum, ( )culoi •nm medicamento. Sordidis
accommodai i s simi. Familias nuj-er inieremere, et tota con- al ce ribas ' et capitis eraptia .nibu5 i, cannin morsibus ex aqua
vivia, Annaîur n Sercnum pricfectum Neronisvigi lum, et tri- illinunta
bu nos, cenlur ionesque. Qum voluptas tanta an< ùpilis cibi? Libet i ;l coquendì dare ai iqnas communes in omui eo ge-
Quidam discn ìvere arbornm geiieribus, ileo, fern la, et gam- nere observationes, quando ipsaì 1 snis manibus delici;R preuiim
ferenlibu is : nos item fogo, aut robore, aut ( mpresso, ut parant li une cibum solnm, et Ci ogitationc ante pascnntnr,
dixinuis. Sed i5ta (¡uis spondet in vcnalilius? On inium colos succineis iiovaciilis, aat arg onteo apparatii comitante. Noxii
iividus. Hic lu il)ebil veneiii arguraeiilum, quo sin lilior fuerit crani fai igi qui in coqucnd. D dur iores fient : innocentiores.
arbornm Qci.. Adversas íiaic diximus remedia, di cemusqiie : qui nitro addilo coquentur, i 5i mir ine |)ercoquantur. Tiiliores
interim sunl a liqua et in Iiis. iiunt cun 1 carne codi, aat cu m pei liculo piri. l'rosnntetpira
Giauciassto macboulilespulatßo/iios.Siccanlu r pendentes con festin 1 sumpta. Debellatiî os et aceti natara , contraria iis.
action, celles-ci peu à peu diminuent, puis disparaissent. Ils font passer les taches de rousseur
et autres taches du visage des femmes. On les lave aussi, comme le plomb, pour en faire des
collyres. Enfin, on en obtient, avec de l'eau, un liniment pour les ulcères putrides, les éruj)-
tions à la tète et les morsures de chiens. »
« .le consignerai encore ici quelques observations générales sur la manière de faire cuire les
Champignons, puisqu'il est des personnes qui se font un véritable plaisir de préparer de leurs
pro])res mains ce genre particulier d'aliments, et qui, pour satisfaire d'abord leur imagination,
croient devoir employer à cet usage des couteaux de succin et de la vaisselle d'argent. Les
Champignons qui durcissent en cuisant sont nuisibles; ceux qui cuisent avec addition de nitre,
si l'on réussit toutefois à les bien faire cuire, sont moins dangereux. On peut être entièrement
sûr de ceux qui ont été cuits avec de la viande ou avec une queue de poire. C'est pourfjuoi l'on
fera bien de manger des poires aussitôt après les Champignons. Le vinaigre, qui de sa nature
leur est contraire, neutralise leurs mauvais effets. »
Les trois catégories de Champignons dont parle d'abord Pline ont excité l'esprit de recherche
des commentateurs qui ne se son t accordés que pour retrouver les Cèpesdans les M / i . Quelquesuns
ont cru reconnaître dans les « mox candidi, vehit apice /laminis insignikispediculis » nos Coralloïdes
{Clavaria Bolryiis ou flava). On sait, en elTet, que les flamines étaient coiiïés de bonnets
surmontés d'une grosse houppe de fil ou de laine : or, la masse toudue et très rameuse de ces
Coralloïdes peut, jusqu' à un certain point, se comparerà ces houppes laineuses. Quant au passage
: « Talissimi, qui rubenl callo, minus dihUorubore, guani boîeli », on l'avait d'abord expliqué
comme se rapportant tantôt au Rougillon {Russida alnlacea), tantôt au Champignon de couche
{Psalliola campestris) ; mais une étude, faite récemment par M. Comes sur les peintures de
végétaux retrouvées à Pompéi, le porte à supposer avec quelque raison que ce passage doit
plutôt s'appli(|uer au Sanguin ou Lactaire délicieux {Laciariiis deliciosus). Il en sera traité plus
amplement dans la seconde partie. Quoiqu'il en soit, un autre Champignon cité par Pline et
sur lequel il ne reste aucune incertitude, est celui de la Férule {Pleurolus nebrodensis), qui est
encore très apprécié de nos jours en Italie et en Algérie. Nous nous occuperons plus loin des
autres espèces croissant sur les arbres. Mais ce qui est intéressant à noter ici, ce sont les craintes
exprimées par Pline au sujet des Champignons vendus sur les marchés : « Sed ista qui s spondei
in venalibus?» Ce commerce indique combien grande, sinon dangereuse, en pouvait être la
consommation.
D'un autre côté, nous chercherions bien vainement à savoir de quelle espèce médicinale,
parmi les Cèpes, Pline a voulu parler, en relatant toutes les vertus extraordinaires du
Snilhis de Bithynie. On n'ignore pas d'ailleurs que, dans les compilations qu'il faisait faire, ses
secrétaires n'avaient garde d'omettre aucune des opinions plus ou moins singulières que
propageait la naïve crédulité des auteurs grecs ou romains.
Dans son livide XVI, 111, sur les diverses productions du Chêne rouvre, se trouve une [ilirase