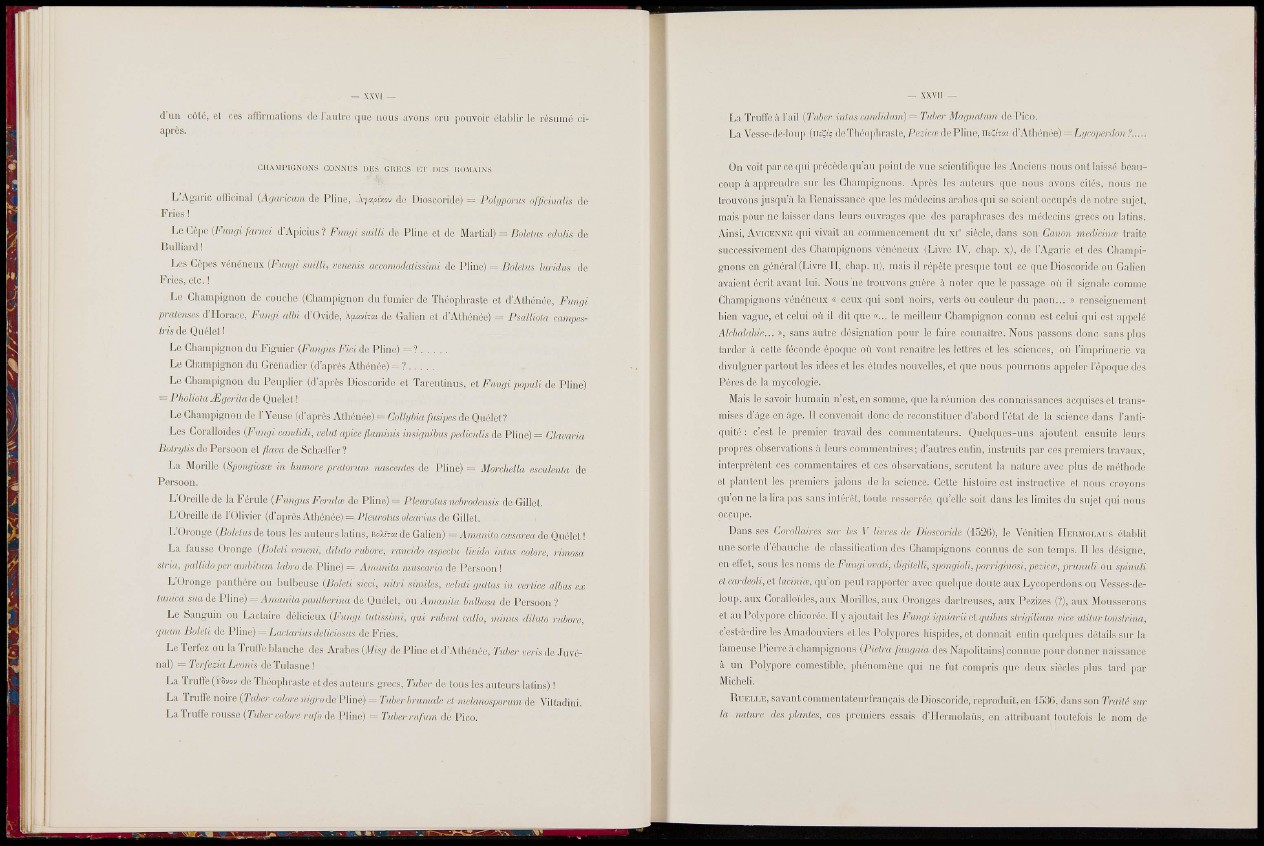
d'iui côlc, el ces affiniuilious Je 1 aut re i|ue nous avons cru pouvoir élaljlii' le résumé ciaprès.
CUAJIt'IGNUiNS CONNUS DES GRECS El DES HUMAINS
L'Agaric officinal (AijnrirAun de Pline, .V/cipráv de Uioscoride) = Poli/poms ofliciimlis de
Fries !
1-e C.ciie (F/uiî;; furnei d'Apicius ? Fiuijji suilii île Pline ol de Martial) = Buklus ediilis de
Bulliiii'd!
l . e s Cùpes vénéneux {Fiiiuji sniUt, venenis acmmudalissimi de Pline) = Bolelus liindus do
l-'ries, etc. !
L e Cliamiiignon de couche (Clianipignon du fumier de Théopliraste et d'Athénée, Fiinrii
pratenses d'Horace, Fmiui albi d'Ovide, de Galion et d'Athénée) = Psalliola campesîi'is
de Quéiet !
L e Champignon du Figuier (Fimgns Fici de Pline) = ?
L e Champignon du Grenadier (d'après Athénée)
L e Chaiu|)ignon du Peuplier (d'après Dioscoride et Tarentiniis, et Fungi popuU de Pline)
PlwUoki JFgerita de ( Jnelet !
L e Champignon de l'Yeuse (d'après Athénée) = CollyUa fnsipes de Quélet?
L e s Coralloides {Fungi candidi, velut apice flaminis insignibns pediadis de Pl ine) = Clavaria
Bolrglis de Per soon et ¡lava de Schadler ?
L a Morille (Spongiosoe in immore pralorurn naseenles de Pline) = MoreMla esculenla de
Persoon.
L'Oreille de la Férul e {Fungus Fernloe de Pline) = Pkurolus nebrodensis de Gillet.
L'Oreille de l'Olivier (d'après Adiénée) = Pleurotus dearius de Gillet.
L'Oronge {Boletus de tous les auteurs latins, lie«™ de Galien) = Amanita coesarea de Quélet I
l . a fausse Oronge {Boleti veneni, diluto rubare, rancido aspeclu livido intus colore, rimosa
stria, pallido per andjilum labro de Pl ine) = Ainanila muscaria de Persoon !
L ' O r o n g e |ianlhérc ou bulbeuse {Boleti sicci, nitri similes, veluli gallas in vertice albas ex
tunica sua de Pl ine) Amanitapantherina de Quélet, ou AmanUa bulbosa de Persoon ?
L e Sangum ou I-actairo délicicux {Fungi lutissimi, qui rubent callo, -minas dilulo rubare,
quant Boleti de l'Um) = Lactarius ileliciosus deFries.
L e 'L'erfez ou la ï r i i l l e bianche des Arabes {iJisij de Plui e et d'Alhé'née, Tubcr oeris de .Juven
a l ) = Terfezia Leouis de Tul a sue !
L a Truire(r8»oï do 'l'héophrasle et des auteurs grecs. Tuber de tous les auteurs latins) !
L a Trulfe noire {Tuber colore u.igro de Pl ine) = Tuber tn-umale et melanosporum de 'Vitîadini.
I . a T ruf f e rousse {Tuber colore rufo de Pline) = Tuber rufum. de Pico.
L a Triilfe à l'ail {Tidier intus randirliim.) = Tuher Magnalum de T'ico.
L a A^essc-ile-loiip (nsÇi'c deTl iéo¡ )brasíe, / V^/RRP de PI ine, tisÇî-îîî d'Atbénée) Lgcoperdou ?..
On voit par ce qui précède qu'au point de vue scienlilique les Anciens nous ont laissé ])eaucoiip
à apprendre sur les Champignons. Après les auteurs que nous avons cités, nous ne
trouvons jusqu' à la Pienaissance que les médecins arabes qui se soient occupés de notre sujet,
mais pour ne laisser dans leurs ouvrages que des paraphrases des médecins grecs on latins.
Ainsi, AVICENNE qui vivait an commencement du x f siècle, dans son Canon medieinai Iraite
successivement des Champignons vciiéueiix (Livre TV, chap, x), de l'Agaric et des Champignons
en général (Livre 1!, cbap. ii), mais il répète presi;[ue tont ce que Dioscoride on Galien
avaient écrit avant lui. Nous ne trouvons guère à noter que le passage où il signale comme
Champignons vénéneux « ceux qui sont noirs, verts ou couleur du paon... » renseignement
bien vague, et celui où il dit que «... le meilleur Champignon connu est celui qui est appelé
Alcliulidiie... », sans autre désignation pour le faire connaître. Nous passons donc sans |ilus
tarder à cette féconde époque où vont renaître les lettres et les sciences, où l'imprimerie va
divulguer partout les idées et les éludes nouvelles, et que nous ]iourrions appeler l'époque des
Pères de la mycologie.
Mais le savoir lumiain n'est, en somme, que la réunion des connaissances acquises et transmises
d'âge en âge. Il convenait donc de reconstituer d'abord l'état de la science dans l'antiquité'
: c'est le ]iremier travail des commentateurs. Quelques-uns ajoutent ensuite leurs
propres observations à leurs commenlaires; d'autres enfin, instruits par ces ]iremiers travaux,
interprètent ces commentaires et ces observations, scrutent la nature avec plus de méthoile
et plantent les premiers jalons delà science. Cette histoire est instructive el nous croyons
qu'on ne la lira pas sans intérêt, toute resserrée qu'elle soit dans les limites du sujet qui nous
occupe.
Dans ses Corollaires sur les T lirres de Dioscoride (1020), le Vénitien IlEu.vrOLArs établit
une sorte d'ébauche île classification des Champignons connus de son temps. Il les désigne,
e n elfet, sous les n oms de Fnngi orati, digitelli, spongioli, porriginosi, pezicoe, prunuli ou spinuli
el cardcoli, et tacinioe, qu'on |icnt rapporter avec ijuelque doute aux Lycoperdons ou Vesses-deloup,
aux Coralloïdes, aux .Morilles, aux Oronges dartreuses, aux Pezizes (?), aux Mousserons
et au Polypor e chicorée. Il y ajoutai t les Fungi igniarii et qu.itMS strigilium vice ntitur tonslrina,
c'est-à-dire les Amadouviers et les Polypores liispides, et donnait enfin i|ueli]ues détails sur la
fameuse Pierre à champignons {Pielra fungaia des Napolitains) connue pour donner naissance
à un Polypore comesfible, phénomène qui ne fut compris que deux siècles plus tard par
Micheli.
RUEU.E, savant commentateur français de Dioscoride, reproduit, en L.îîG, dans son Traild sur
la nature des plantes, ces |)remiers essais d'Herrnolaüs, en atlrlbnaiit toutefois le nom de