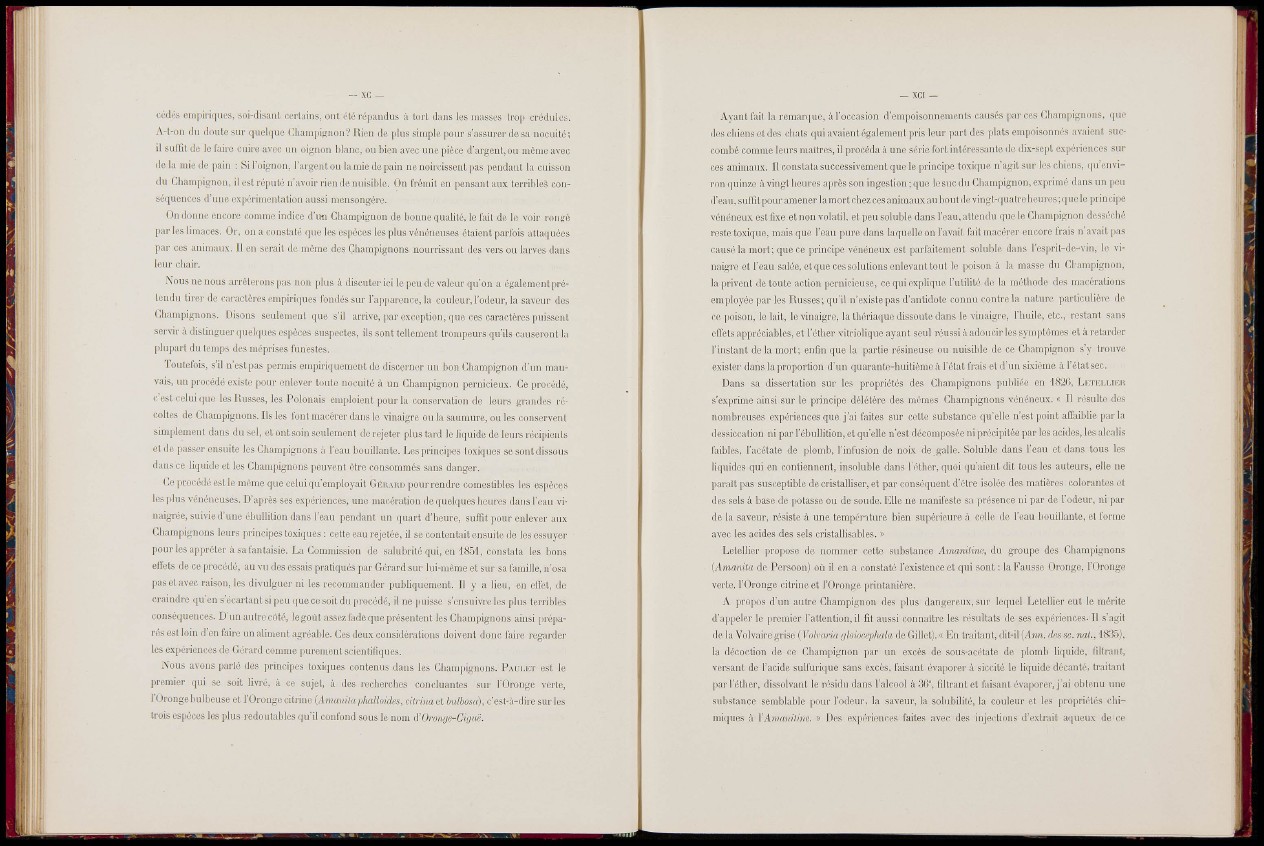
- - se -
cédés eiiiiiiriqucs, soi-disant certains, ont ,Hé répandus à tort dans les masses trop crédules.
AH-on du doute sur quelque Clianipignon? liien de plus simple pour s'assurer de sa nocuité;
il surfit dû le l'aire cuire avec uti oignon blanc, ou bien avec une pièce d'argent, ou môme avec
de la mie de pain ; Si l'oignon, l'argent ou la mie de pain ne noircissent pas pendant la cuisson
ilu Champignon, il est réputé n'avoir rien de nuisible. On frémit en pensant aux terribles conséquences
tl'uiie expcnmentation aussi mensongère.
Oiulonne encore comme indice cl'im Champignon de boime qualité, le fait de le voir rougè
parles limaces. Or, on a constaté que les espèces les plus vénéneuses étaient parfois attaquées
par ces animaux. Il en serait de même des Champignons nourrissant des vers ou larves dans
leur chair.
,\ous ne nous arrêterons pas non plus à discuter ici le peu de valeur qu'on a égalemeiitprétendu
tirer de caractères empiri(|ues fondés sur l'apiiarence, la couleur, l'odeur, la saveur des
Champignons. Disons seulement que s'il arrive, par exception, (|ue ces caractères puissent
servir à distinguer quelques espèces suspectes, ils sont tellement trompeurs qu'ils causeront la
plupart du temps des méprises funestes.
Toutefois, s'il n'est pas permis empirii|uemont de discerner nu bon Champignon d'un mauvais,
un procédé existe pour enlever toute nocuité à un Champigoon pernicieux. Ce procédé,
c'est celui I|ue les liiisses, les Polonais emploient pour la conservation de leurs grandes récoltes
de Champignons. Ils les font macérer dans le vinaigre ou la saumure, ou les conservent
simplement dans du sel, et ont soin seulement de rejeter plus tard le liquide de leurs récipients
et de passer ensuite les Champignons à feau bouillante. Lesprincipes toxiques se sont dissous
dans ce liquide et les Champignons peuvent être consommés sans danger.
Ce procédé est le même que celui qu'employait GÉii.ino pourrendre comestibles les espèces
les |.lus vénéneuses. D'après ses expériences, une macération de quelques heures dans l'eau vinaigrée.
suivie d'une ébullition dans l'eau pendant un quart d'heure, suffit pour enlever aux
Champignons leurs principes toxiques : cette eau rejetée, il se contentait ensuite de les essuyer
pour les apjiréter à sa fantaisie. La Commission de salubrité qui, en -ISil, constata les bons
effets de ce procédé, au vu des essais pratiqués par Gérard sur lui-même et sur sa famille, n'osa
pas et avec raison, les divulguer ni les recommander publiquement. Il y a lieu, en ellet, tie
craindre (lu'en s'écartant si peuque ce soit du procédé, l ine ]iuisse s'ensuivre les plus terribles
conséquences. D'un autre coté, legoût assezfade que présentent les Champignons ainsi préparés
est loin ifen faire un aliment agréable. Ces deux considérations doivent donc faire regarder
les ex[)ériences de Gérard comme purement scientiliques.
Mous avons parlé des principes toxiiiues contenus dans les Champignons. Paoi.ht est le
premier qui se soit livré, à ce sujet, à des recherches concluantes sur l'Oronge verte,
l'Orongebulbeuse eL l'Oronge citrine {Annuiitu ¡ihalloidBS, cilHnaal bulbosii), c'est-à-dire sur les
trois espèces les plus redoutables qu'il conioiid sous le nom li'Oronge-Ctguë.
— XCI —
Ayant rail la remar(|ue, à l'occasion d'empoisonnements causés parces Cliampignons, (pic
des chiens et des cliats qui avaient également pris leur part des plats empoisonnés avaient succombé
comme leurs maîtres, il procéda à une série (brl intéressante de dix-sept expériences sur
ces animaux. Il constata successivement que le jn'incipe toxique n'agit sur les chiens, qu'cnvirnn
quinze àvingllieures après son ingestion ; que iesuc du Cliampignon, exprimé dans un peu
d'eau.sufiilpour amener la mort chez ces animaux au boni de v i ngt-(|uatre heures; (pie le principe
vénéneux est fixe et non volatil et peu soluble dans l'eau, attendu (pie le Champignon desséché
reste toxir|ue, mais que l'eau pure dans laquelle on l'avait Tait macérer encore Trais n'avait pas
causé la mort; que ce principe vénéneux est parCaiteaient soluble dans l'esprit-de-vin, le vinaigre
et l'eau salée, etque cessolutions enlevant tout le i^oison à la masse du Champignon,
la ])rivent de toute action pernicieuse, ce qui explique Tutihté de la méthode des macérations
employée par les Russes; qu'il n'existe pas d'antidote connu contre la nature particulière de
re poison, le lait, le vinaigre, la thériaque dissoute dans le vinaigre, l'huile, etc., restant sans
effets appréciables, et l'éther vitriolique ayant seul réussi à adoucir les symptômes et à retarder
l'instant delà mort; enfin que la partie résineuse ou nuisible de ce Champignon s'y trouve
exister dans la proportion d'un quarante-huitième à l'état frais et d'un sixième à l'état sec.
Dans sa dissertation sur les propriétés des Champignons publiée en 182(3. L[':'nîi.Ln=:H
s'exprime ainsi sur le principe délétère des mêmes Champignons vénéneux. « Il résulte des
nombreuses expériences que j'ai faites sur cette substance qu'elle n'est point affaiblie parla
dessiccation ni par l'ébullition, et qu'elle n'est décomposée ni précipitée par les acides, les alcalis
faibles, l'acétate de plomb, l'infusion de noix de galle. Soluble dans l'eau et tlans tous les
liquides qui en contiennent, insoluble dans l'éther, quoi ¡[u'aient dit tous les auteurs, elle ne
paraît pas susceptible de cristalliser, et par conséquent d'être isolée des matières colorantes et
des sels à base de potasse ou de soude. Elle ne manifeste sa présence ni par de l'odeur, ni par
de la saveur, résiste à une température bien supérieure à celle de l'eau bouillante, et forme
avec les acides des sels cristallisables. »
Letellier pr0i)0se de nommer cette substance Amaniiine, du groupe des Champignons
{Amanita de Persoon) où il en a constaté l'existence et qui sont : la Fausse Oronge, l'Oronge
verte, l'Oronge citrine et l'Oronge printanière.
A propos d'un autre Champignon des plus dangereux, sur lequel Letellier eut le mérite
d'appeler le premier l'attention, il fit aussi connaître les résultats de ses expériences- 11 s'agit
de la Volvaire grise ( Vnlvima filoiooepkala de Gill et). « E n traitant, dit-il {Ann. des se. nat., 1835),
la (lécoction de ce Champignon par un excès de sous-acélate de plomb h(]uide, filtrant,
versant de l'acide sulfuri(|ue sans excès, faisant (évaporer à siccité le liquide décanté, ti'aitant
]>ar l'éther, dissolvant le r(%idu dans l'alcool à 36°, filtrant et faisant évaporer, j"ai obtenu une
substance semblable pour l'odeur, la saveur, la solubilité, la couleur et les propriétés chimi(
pies à YAmamtinc. T> Des expc'riences faites avec des injections d'extrail a(pieux de ce