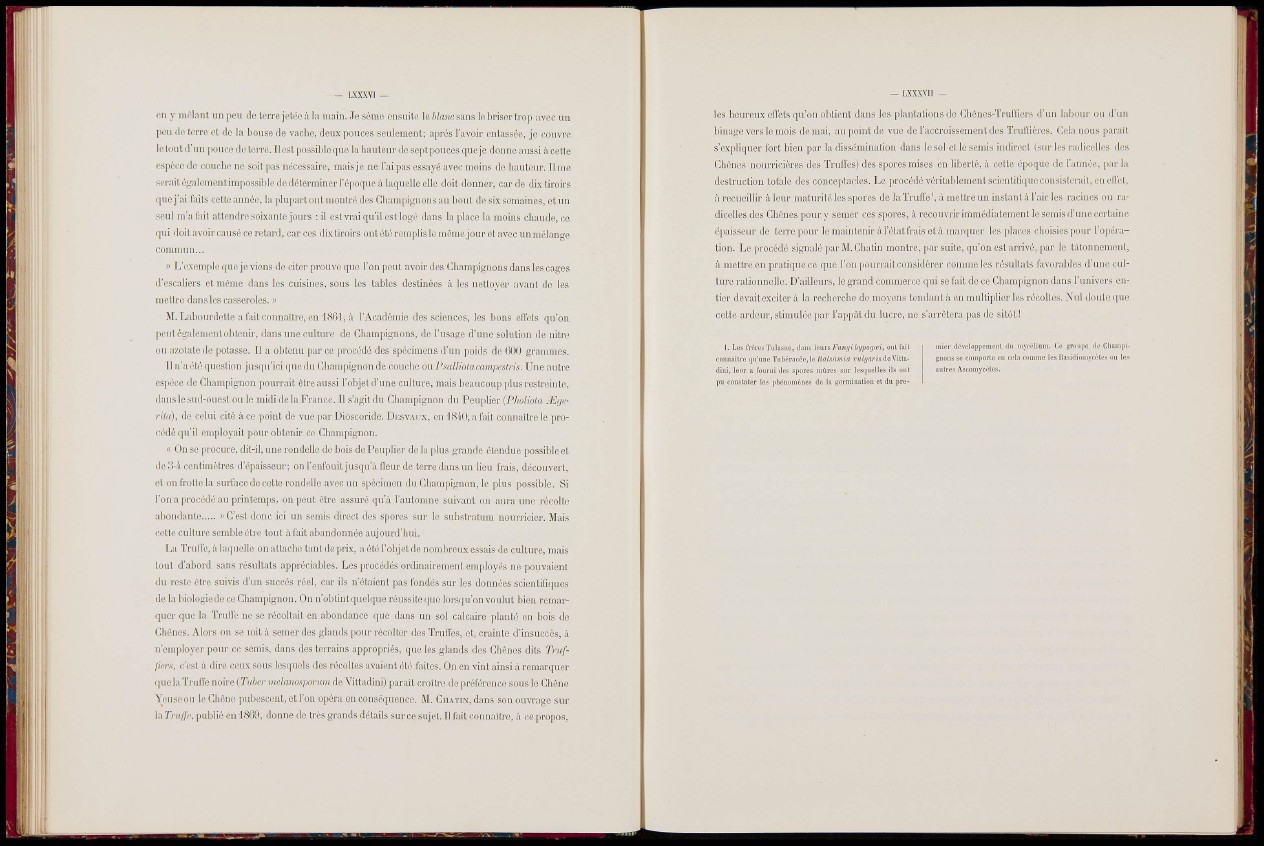
- LXXXVI —
iMi Y mrl;int unpen de ton'e j e l é e à l a main. J e sème cnsnilo le Wane sans le briser trop avec un
peu (le terre et de In. bouse de vache, deux pouces seulement; après l'avoir entassée, je cou\Te
le lout d'im pouce do terre. .11 est possible que lu hauteur de sept pouces que je donne aussi à cette
espèce de couche ne soit pas nécessaire, mais je ne l'ai pas essayé avec moins de hauteur. Il me
sci'aitcgalcmenlimpossible de déterminer l'époque à laquelle elle doit donner, carde dix tiroirs
(pie j'ai faits cette année, la i)lupart ont montré des Champignons an bout de six semaines, et un
seid m'a lait attendre soixante jours : il est vrai qu'il est logé dans la place la moiiis chaude, ce
(¡ni doit avoir causé ce retard, car ces dix tiroirs ontétérem])l islemèmejour et avec u n mélange
commun...
» L'exempl(.u[uc je viens de citer prouve que l'on peut avoir des Champignons dans les cages
d'escaliers et même dans les cuisines, sous les tables destinées à les nettoyer avant de les
mettre dans les casseroles. «
M. Labourdet t e a l'ait connaître, en 1801, à l'Académie des sciences, les bons effets qu'on
peiitégaiementobtenir, dans une culture de Champignons, de l'usage d'une solution de nitre
ou azotate de potasse. Il a obtenu par ce pro.cédé des spécimens d'un poids de flK) grammes.
Il n'a été question jusqu'ici que du Champignon de couche on PsalUolucampesIns. Une autre
es]>èce de Champignon pourrait être aussi l'objet d'une culture, mais beaucoup plus restreinte,
dans le sud-ouest ou le midi de la France, il s'agit du Champignon du Peuplier {Pholiola .Egerila),
de celui cité à ce point de vue par Dioscoride. Di iSVArx, en '1810, a fait connaître le procédé
qu'il employait pour obtenir ce Champignon.
« On se procure, dit-il, une rondelle de bois de Peuplier de la plus grande étendue possible et
(Ie3-'i centimètres d'épaisseur; on l'enfouit jusqu' à fleur de terre dans un lieu frais, découvert,
et on frotte la surface de cette rondelle avec u n spécimen du Chaaipigiion, le plus possible. Si
l'on a i^'orédé au printemps, on peut être assuré qu'à l'automne suivant on aura une récolte
abondante » C'est donc ici un semis direct des spores sur le substratum nourricier. Mais
celte cullure semble être tout à l'ait abandonnée aujourd'hui.
La Truffe, à laquelle on attache tant de prix, a été l'objet de nombreux essais de cullure, mais
tout d'abord sans résultats appréciables. Les procédés ordinairement employés ne pouvaient
du reste être suivis d'un succès réel, car ils n'étaient pas fondés sur les données scienliQques
de la biologiede ce Champignon. On n'obtint quelque réussite (jue lorsqu'on voulut bien remarquer
que la Truffe ne se récoltait en abondance que dans un sol calcaire planté en bois de
Chênes. Alors on se mit à semer des glands pour récolter des Truffes, et, crainte d'insuccès, à
n'employer pour ce semis, dans des terrains appropriés, que les glands des Chênes dits TruflieTS,
c'est à dire ceux sous lesquels des récoltes avaient été laites. On en vint ainsi à remarquer
(|uela Truffe noire {Tiiher inelanosponim de Vittadini) parait croître de préférence sous le Chêne
Yeuse ou le Chêne pubescent, et l'on opéra en conséquence. M. CHA TÎN, dans son ouvrage sur
la Truffe, publié en 1869, donne do très grands détails sur ce sujet. Il fait connaître, à ce ])ropos,
— LXXXVH —
les heureux effets qu'on obtient dans les plantations de Chènes-Truffiers d'un labour ou d'un
binage vers le mois de mai, au point de vue de l'accroissemeiil des Trul'lièrcs. ('ola nous paraît
s'expliquer fort bien par la dissémination dans lesol ei le semis indirect (siu^ les radicellcs des
Chênes nourricières des Truffes) des spores mises en liberté, à cette époque de l'aimée, pat- ia
destruction totale des conce]>tacles. Le procédé vérital.)lement scientifique consisterait, eu diet,
à recueillir à leur maturité les spores de la Truf fe' , à mettre un instan l à l'air les racines ou radicelles
des Chênes pour y semer ces spores, à recouvrir immédiatement le semis ( Tu ne certaine
épaisseur de terre pour le maintenir àl'étatfrais et à marquer les places choisies pour l'opéicition.
Le procédé signalé par M.Chatin montre, par suite, qu'on est arrivé, par le tâtonnement,
à mettre en pratique ce que l'on pourrait considérer comme les résultais favorables d'une culture
rationnelle. D'ailleurs, legrand commerce qui se fait de ce Champignon dans l'univers entier
devaitexciter à la recherche de moyens tendant à en multiplier les récoltes. Nul doute (lue
cette ardeur, stimulée par l'appât du lucre, ne s'arrêtera pas de sitôt !
]. Les frèresTdiasiie, dans ]a\i\'5Fmujihypogcei, o((l fail
connaîlre (|u'une Tubcrac6c,leiifl/!irt»ii:ii rMÎf/arîsdeVitta-
(liiii, leur a fourni des spores mûres sur lesquelles ils onl
pu constater les phénomène s de l a g e rmina l ion et dii premier
développemenl du myc(''lium. Ce g r o d p e ik' Cliampignons
se coinpoi'le en cela comme les Basidio(nyc(!;le.s ou les
autres Aseomycctes.