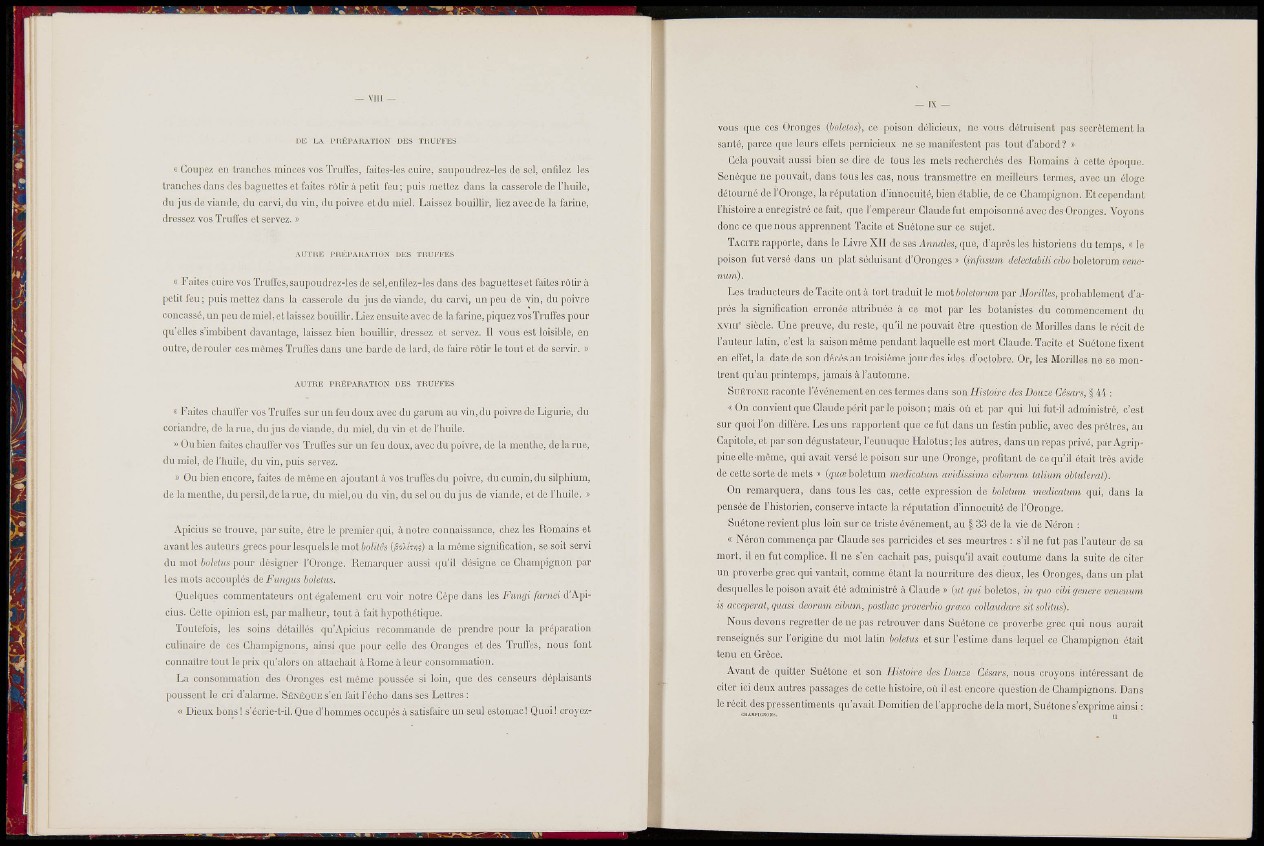
DE LA l'KÉPAHATION DES TUUFFKS
« Coupez en Lrimclies minces vos Truires, l'aites-les cuire, saupoudrez-les de sel, enfilez les
tranches dans des baguet tes et faites rôtir à petit feu ; puis mettez dans la casserole de l'huile,
du jus de viande, du carvi, d u vin, du poivre et du miel. Laissez bouillir, hezavecde la farine,
dressez vos Trul ïes et servez. »
AUTIOE l'KISPAUATlUN DES TllUFFES
« Fai tes cuire vos Trui res,saupoudrcz- les de sel,enlilez-les dans des baguetleset laites rôtir à
petit feu ; puis mettez dans la casserole du jus de viande, du carvi, un peu de vin, du poivre
concassé, u n peu de miel, et laissez bouillir. Liez ensuite avec de la farine, piquez vos T ruf f e s pour
qu'elles s'imbibent davantage, laissez bien bouillir, dressez et servez. Il vous est loisible, en
outre, de rouler ces même s Trulfes dans une barde de lard, de faire rôt i r le tout et de servir. »
AUTRE PRÉPARATION DES TRUFFES
<1 Fai tes cbauller vos Trutl'es sur un feu doux avec du garum au vin, du poivre de Ligurie, du
coriandre, de la rue, du jus de viande, du miel, du vin et de l'huile.
» Ou bien faites chaulTer vos Trulfes sur un feu doux, avec d u poivre, de la menthe, de la rue,
d u miel, de l'huile, du vin, puis servez.
» Ou bien encore, faites de même en ajoutant à vos truiTes du poivre, du cumin, du silplnum,
de la menthe, du persil, de la rue, du miel,ou du vin, du sel ou du jus de viande, et de l'huile. »
Apicius se trouve, par suite, être le premier qui, à not r e connaissance, chez les Romains et
avant les auteur s grecs pour lesquels le mot ôo/iiês (/SoXtr/î?) a la même signification, se soit servi
du mot i/o/eiws pour désigner l'Oronge. Remarquer aussi qu'il désigne ce Champignon par
les mot s accouplés àeFimgus boleius.
Quelques commentateurs ont également cru voir notre Cèpe dans les Fmgi faniei d'Apicius.
Cette opinion est, par malheur , tout à fait hypothétique.
Toutefois, les soins détaillés qu'Apicius recommande de prendre pour la préparalion
culinaire de ces Champignons, ainsi que pour celle des Oronges et des Trulfes, nous font
connaître tout le prix qu'alors on attachait à Rome à leur consommation.
La consommation des Oronges est même poussée si loin, que des censeurs déplaisants
poussent le cri d'alarme. SÉXÈQUE s'en l'ait l'écho dans ses Lettres :
« Dieux bons I s'écrie-t-il. Que d'hommes occupés à satisfaire u n seul estomac ! Quo i ! croyezvous
que ces Oronges {bolelos), ce poison délicieux, ne vous détruisent pas secrètement la
santé, parce que leurs effets pernicieux ne se manifestent pas tout d'abord? »
Cela [louvait aussi bien se dire de tous les mets recherchés des Romains à cette époque.
Senèque ne pouvait, dans tous les cas, nous transmettre en meilleurs termes, avec un éloge
détourné de l 'Oronge, la réputat ion d'innocuité, bien établie, de ce Champignoii. Et cependant
l'histoire a enregistré ce fait, (|ue l'empereur Claude fut empoisonne avec des Oronges . Voyons
donc ce que nous apprennent Tacite et Suétone sur ce sujet.
TACITE rapi 'or te, dans le Livre XI I de ses Annales, (jue, d'après les historiens du (emps, « le
poison fut versé dans un plat séduisant d'Oronges » {¿nfusuin delectahili cibo hoielorum venenum).
Les traducteurs de Tacite ont à tort traduit le mot bolGlonm par Morilles, probablement d'après
la signification erronée attribuée à ce mot par les botanistes du commencement du
x v n r siècle. Une preuve, du reste, qu'il ne pouvait être question de Morilles dans le récit de
l'auteur latin, c'est la saison même pendant laquelle est mor t Claude. Tacite et Suétone fixent
en effet, la date de son décès au troisième jour des ides d'octobre. Or, les Morilles ne se montrent
qu'au printemps, jamais à l'automne.
SUÉTONE racont e l'événement en ces termes dans son lïisloire des Douze Césars, § 41 :
«On convient que Claude périt par le poison; mais où et par qui lui fut-il administré, c'est
sur quoi l'on diffère. Les uns rapportent que ce fut dans un festin public, avec des prêtres, au
Capitole, et par son dégustateur, l 'eunuque llalotus; les autres, dans u n repas privé, par Agrippine
elle-même, qui avait versé le poison sur une Oronge, profitant de ce qu'il était très avide
de cette sorte de mets » (çuceboletum medicaium avidissimo cÂborum talium obluleral).
On remarquera, dans tous les cas, cette expression de boleium medicaium qui, dans la
pensée de l'historien, conserve intacte la réputation d'innocuité de l'Oronge.
Suétone revient plus loin sur ce triste événement , au i 33 de la vie de Néron :
1 Néron commença par Claude ses parricides et ses meurtres : s'il ne fut pas l'auteur de sa
mort, il en fut complice. Il ne s'en cachait pas, puisqu'il avait coutume dans la suite de citer
u n proverbe grec qui vantait, comme étant la nourriture des dieux, les Oronges, dans un plat
desquelles le poison avait été administré à Claude » {ul qui boletos, in quo cibi genere venenum
is acceperat, quasi deorum cibimi, poslhac proverbio groeco collaudare sit soUlus).
Nous devons regretter de ne pas retrouver dans Suétone ce proverbe grec qui nous aurait
renseignés sur l'origine du mot latin boleius et sur l'estime dans lequel ce Champignon était
tenu en Grèce.
Avant de quitter Suétone et son Histoire des Douze Césars, nous croyons intéressant de
citer ici deux autres passages de cette histoire, où il est encore question de Champignons. Dans
le récit des p res sent iment s qu'avait Domitien de l'approche del à mort, Suétone s'exprime ainsi :