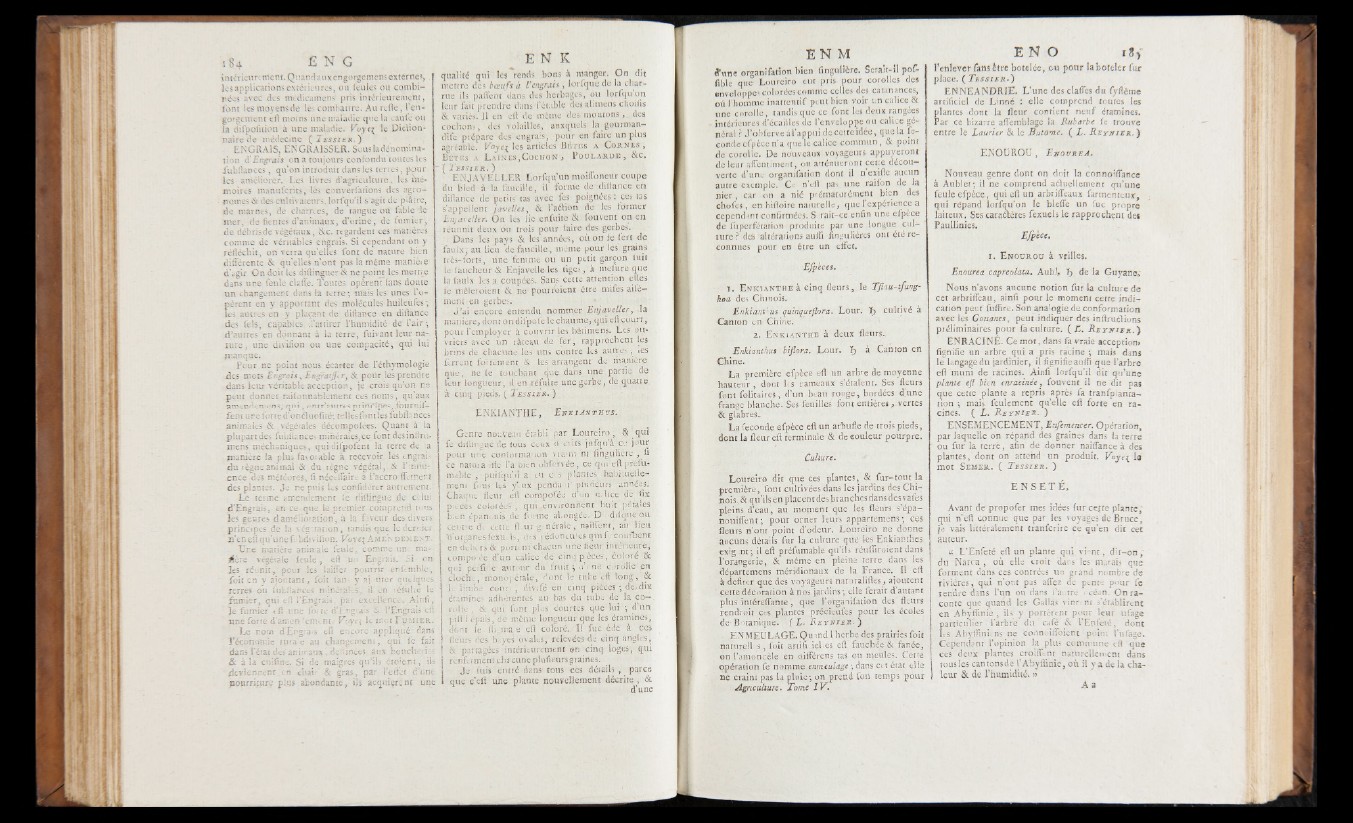
H H H
1 8 4 fi N G
intérieuretiîcüf. Quand aux engorgemeus externe?,
ksapplications extérieures, ou (eûtes ou combinées
f
avec des medicamens pris intérieurement,
l'ont tes moyens de les combattre. Au refte, l’en-
OTgcment eft moins une maladie que ta caule ou
difpofition à une maladie. Voye[ le Dictionnaire
de médecine (Jessier. )
ENGRAIS, ENGRAISSER. Sous la dénomination
d'Engrais on a toujours confondu'ioutes tes
iubO.ances, qu’on introduit dans tes tertes, pour
les améliorer. Les livres d’agriculture, les mémoires
manuferits, les conversations des agronomes
& des cultivateurs, lori'qu'il s agît de plâtre,
de marnes, de charrces, de tangue ou fable de
mer, de fientes d’animaux, d'urine, de fumier,
de débris de végétaux, &c. regardent ces matières
comme de véritables engrais. Si cependant on y
réfléchit, on verra qu’elles font de nature bien
différente & qu’elles n’ont pas la même maniée e
d’agir On doit les diftinguer & ne point les meme
dans une feule claffe. Toutes opèrent (ans doute
un changement dans la terre ; niais les unes l’opèrent
en y apportant des molécules huileùfes y
les autres en y plaçant de diflance en difiance
des tels, capables d’attirer l’humidité de l’air y
d’autres en donnant à la terre, fuivant leur natu
re , une divifion ou une compacité, qui lui
manque.
Peur ne point nous écarter de l’éthymologie
des mots Engrais, Engraijjlry & polir les'prendre
dans leur véritable acception, je crois qu’on ns
peut donner rai 1 onnablemeni ces noms, qu’aux
amendemens, qui, entr’f utrts principes, fourr.il-
fent une forte d’onélucfiré; tellcsfiontles fubftp.nces-
animalts & végétales décompofées. Quant à la
plupart des fubiiaoçes minérales,ce font desinfiriV
mens méchaniques, qui dilpofent la terre de a
manière la plus favotable à recevoir les engrais
du règne animal & du règne végétal, «St lbnùu-
ence des météores, fi néceffair- à i’accro (Tarer t
des plantes. Je ne puis les confidérer autrement.
Le terme amendement fe riifiingue de celui
d’Engrais, en ce que le premier comprend tous
les genres daméiioiation, à la faveur des divers,
principes de la vég'janon. tandis que. le dernier
n’eneftqu’uneL-bdivilion. Voye\ A m e V.d e m e n t .
Une matière animale feule, comme un ma-
«ère végétale leule , eft ur- Engrais. Si on
les réunit, pour les laiffet pourrir enlcmble,
foit en y ajoutant, (bit fan y aj uter quelques
terres ou lit béances minérales-, il en ;é(ulie le
fumier, qui efi l’Engrais par excellence-, Ainli,
le fumier eft une forré d'Éngra.s 0, l’Engrais cil
une forte d’amen‘enunt. Voyei le inorFuMiER.
Le nom d Erg-aô efi encore appliqué dans
l ’économie rnra e au changement, qui fe fait
dans l’état des animaux , de-'inées. aux bouche; tes
& à la cuifine. Si de maigres qu’ils éroient , ils
deviennent en citai' & gras, par l’effet d’une
nourriture plus abondante, ils acquiersnt une
y E N K
qualité qui les rends bons à manger. On dit
mettre des boeufs h Vengrais , iorfque de la charrue
ils paffent dans des herbages, ou lorfqu on
leur fait prendre dans l’étable des aliinens eboifis
& variés. Il en efi de même des moutons, _ des
cochons, des volailles, auxquels la gourman-
dife prépare des engrais, pour en faire un plus
agréable. V o y c% les articles Bêtes a C ornés ,
Bêtes a L a in es,C ochonj Po u l a r d e , &c.
( T e s s i e r . )
ENJAVELLER Lorfqu’un moiffoneur coupe
du bled à la faucille, il forme de diliance en
diflance de petits tas avéc fes poignées : ces tas
s’appellent ja v e lle s , & l’aélion de les Idrmer
Enjaveller. On les lie enluite & fouvent on en
réunnit deux ou trois pour taire des gerbes.
• Dans les pays & les années, ou on (e (ert de
faulx, au lieu de faucille, même pour les grains
très-forts, une femme ou un petit garçon luit
le faucheur &£ En javelleles tiges, A mefure que
la faulx lésa coupées. Sans cette attention elles
le mêleroient & ne pourvoient être miles âifé-
ïnenc en gerbes. •* '■
J ’ai encore entendu nommer Enjayeller r -\a
manière, dont on. difpole le chaume, qui eft court,
pour l’employer à couvrir les bôtimens. Les ouvriers
avec un râteau de fer, rapprochent les
brins de chacune- les uns contre les autre- , »es
ferrent fortement & les arrangent de îhanière
que, ne le touchant que dans Une partie de
. leur longueur, il en réfulre une gerbe, de quatie,
à cinq pieds. ( T e s s i e r . )
ENKIANTHE, E n k i a n t h v s .
Genre nouveau établi par Loureiro . & qui
fe dilling-ue de tous ceux ci cvifs jufqu’a ce jour
pour une conforma’ 100 vrauu.ru fihgulière , fi
ce natuia î-lie l’a bien übfervée , ce qui eft préfu-
mable , puifqu’ il a eu c- s plantes habiaielie-
mem lbus les ybüx pendu: i piuneùrs années!
Chaque fleur eft compofée d’un c.-Uce fié fix
pièces colorée?, qui environnent huit pétales
bien épanouis,de forme al.ongée. D . dilquë Ou
centre d. cette fl ur g-néralè, naiftent, au lieu
‘d’organes fexm là, des {èdontu'es qui f f courbent
en d eh o rs & portant chacun une (leur intérieure,
compo ée d’un calice de cinq pèces , coloré &
qui per fi e autour du fruit y u ; ne corolle en
cloche, monopéraie, dont le tube eft long, &
!.. limbe cour' , divifé en cinq pièces ; de-dix
étamine? adhérentes au bas du tube de la corolle
. & qui font plus dourtes que lui -, d’un
pift l épais, ce même longueur que les étamines,
dont le fiigma e eft coloré.. Il fuc ède à ces
fleurs des bayes ovales, relevées de cinq angles,
& partagées intérieurement en cinq loges, qui
renferment eha cune plu Heurs graines.
Je fuis entré dans' tous ces détails , parce
que c’eft une plante nouvellement décrite , &
d’une
ENM
d’nne organiCation bien fingulière. Serait-il pof-
fible que Loureiro eut pris pour corolles des
enveloppe? colorées comme celles des catanances,
où l’homme inattentif peut bien voir un calice &
une corolle, tandis que ce font les deux rangées
intérieures d’écailles de l’enveloppe ou calice général
? J’obferve â l’appui de cette idée, que la fécondé
efpèce n’a que le calice commun, & point
de corolle. De nouveaux voyageurs appuyeront
de leur aflentiment, ou anémieront cette découverte
d’une organifation dont il n exifle aucun
autre exemple. Ce n’eft pas une raifon de la
nier, car on a nié prématurément bien des
chofes, en hiftoire naiurelle, que l’expérience a
cependant confirmées. Serait-ce enfin une efpèce
de fuperfétâtion produite par une longue culture?
des altérations auffi fingulières ont été reconnues
pour en être un effet.
Êfpèces.
1. Eneianthe à cinq fleurs, le Tfiau-tfung-
hoci des Chinois.
EnkianTus quinqueflora. Lour. ï) cultivé à
Canton en Chine.
2. En eian th e à deux fleurs.,
Enkianthus biflora. Lour. î> à Canton en
Chine.
La première efpèce eft un arbre de moyenne
hauteur , dont les rameaux s’étalent. Ses fleurs
font folitaires, d’un beau rouge, bordées d.une
frange blanche. Ses feuilles font entières, vertes
& glabres..
La fécondé efpèce eft un arbufle de trois pieds,
dont la fleur eft terminale & de couleur pourpre.
Culture.
Loureiro dit que ces plantes, & fur-tout la
première, font cultivées dans les jardins des Chinois,
& qu’ils en placent des branches dans des vafes
pleins d’eau, au moment que les fleurs s’épa-
nouiffenty pour orner leurs appartenions y ces
fleurs n’ont point d’odeur. Loureiro ne donne
aucuns détails fur la culrure que les Enkianth.es
exigmty il eft préfumable qu’ils réuffiroient dans
l’orangerie, & même en pleine rerre dans les
départemens méridionaux de la France. Il eft
à defirer que des voyageurs naturalises, ajoutent
cette décoration à nos jardins*, eile ferait d’autant
plus intéreffame, que l’organifation des fleurs
rendroit ces plantes précieufes pour les écoles
de-Botanique. ( L- R e y n i e r ■ )
ENMEULAGE, Qumd 1 herbe des prairies foit
naturell s , foit artifi.ielies eft fauchée & fanée, I
on l’amoncèle en différens tas ou meules. Cette j
opération fe nomme enmeulagc \ dans ctt état elle I
ne craint pas la pluie y on prend fon temps pour I
Agriculture. Tome IV .
EN O rJ>
l’enlever fans être botelée, ou pour Iaboteler fur
place. ( T e s s i e r . )
ENNEANDRIE. L ’une des claffes du fyflême
artificiel de Linné : elle comprend toutes les
lantes dont la fleur contient neuf étamines,
âr ce bizarre aflëmblage la Rubarbe fe trouve
entre le Laurier & le Butome. ( L . R e y n ie r . )
ENOL'ROU, E n o u r e a .
Nouveau genre dont on doit la connoiffance
à Aubier ; il ne comprend actuellement qu’une
feule efpèce, qui eft un arbriffeaux farmemeux,
qui répand lorfqu’on le bleffe un fuc propre
laiteux. Ses caractères fexuels le rapprochent des
Paullinies.
Efpèce.
1. E nourou à vrilles.
Enourea capreolata. AubJ» T) de la Guyane*
Nous n’avons aucune notion fur la culture de
cet arbriffeau, ainfi pour le moment cette indication
peut' fuffire. Son analogie de conformation
avec les Gouanes, peut indiquer des inftructions
préliminaires pour fa culture. ( L . R e y n i e r . )
ENRACINE. Ce mot, dans fa vraie acception»
lignifie un arbre qui a pris racine ; mais dans
le langage du jardinier, il fignifieauffi que l’arbre
eft muni de racines. Ainfi lorfqu’il dit qu’une
plante efi bien enracinée, fouvent il ne dit pas
que cette plante a repris après fa tranfpianta-
tion y mais feulement qu’elle eft forte en racines.
( L . R e y n i e r . )
ENSEMENCEMENT, Enfemencer. Opération,
par laquelle on répapd des graines dans la terre
ou fur la rerrè, afin de donner naiffance à des
plantes, dont on attend un produit. Voye{ la
mot Semer. ( T e s s i e r . )
E N S É T É .
Avant de propofer mes idées fur cette plante,'
qui n’eft connue que par les voyages de Bruce,
je vais littéralement tranferire ce qu’en dit cet
auteur.
« L’Enfeté eft un plante qui vi~nt, dit-on,'
du Narca , ou elle croît dars les* marais que
forment dans ces contrées un grand nombre de
rivières, qui n’ont pas affez de pente pour fe
rendre dans l’un ou dans l’autre ; céan. On raconte
que quand les Gallas vinr nt s’établirent
en Abyffinie , ils y portèrent pour leur ufage
particulier l'arbre du café & l’Enleré, dont
les Abyflînùns ne cohnoiffoient point l’ufage.
Cependant l’opinion la plus commune eft que
ces deux plantes croiffènt naturellement dans
I tous les cantons de l’Abyffinie, où il y a de la cha-
| leur & de l’humidité, n
A a