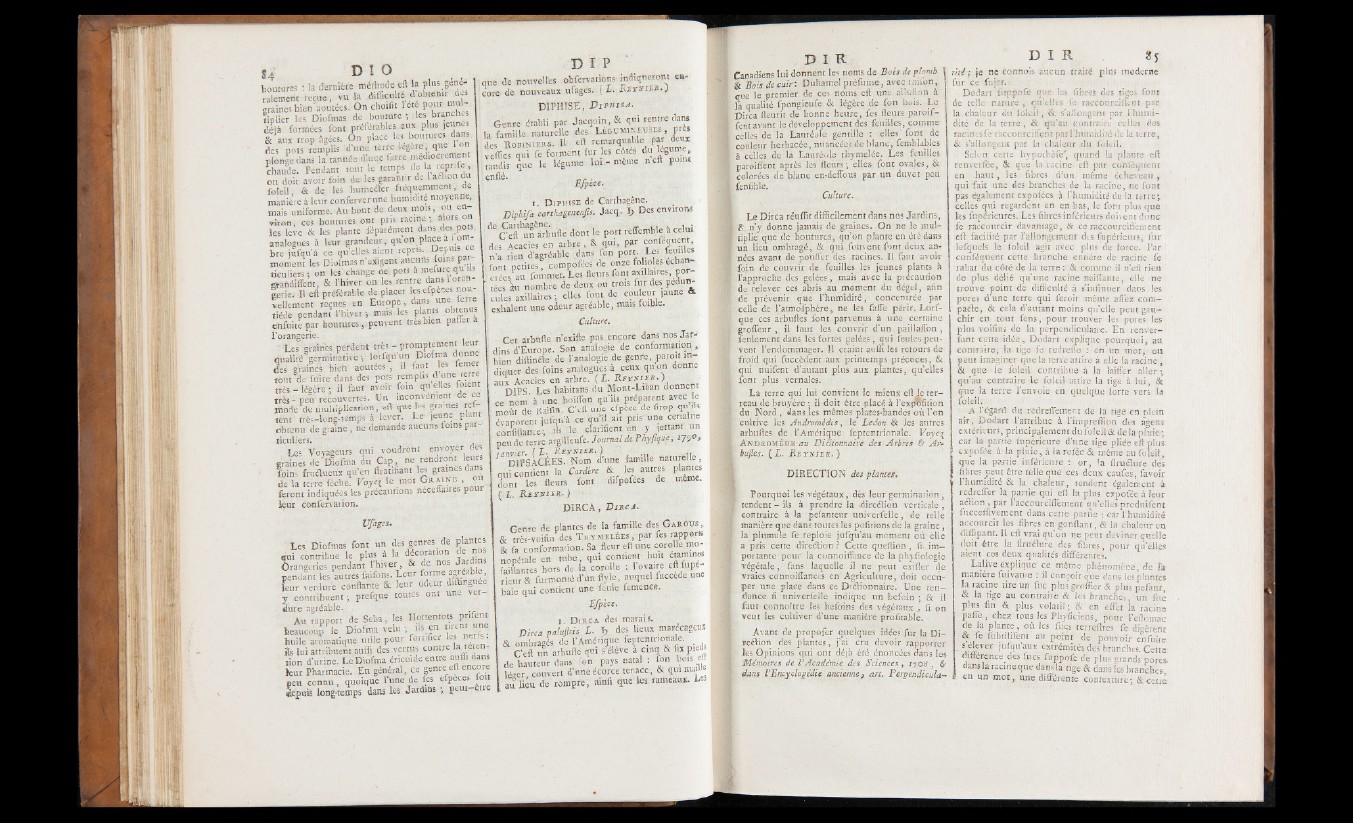
* 4 D I O
boutures : la Jernièi'e méthode eft la plus généralement
reçue ; vu la difficulté, d obtenir .des
graines bien aoûtées. On chotfit 1 été pou_ ,
tiplier les Diofmas de bouture ; les branches
déjà formées font préférables, aux plus jeunes
& aux trop âgées. On place les boutures dan
des pots remplis d'une terre légère SUsXon
plonge dans la tannée diuue ferre médiocrement
chaude. Pendant tout le temps de L . J M M
on doit avoir foin de les garantir de 1 aflion du
foleii & de les humeéler. fréquemment, de
manière à leur conferverune humidité moyenne,
mais uniforme. Au bout de deux mois, on e
viron, ces boutures ont pris racine; alu
les levé & ies plante féparément dans .des pots,
analogues à leur grandeur, qu on place à 1 ombre
iufqu’à ce qu'elles aient repris. Depuis ce
moment les Diofmas n’exigent aucuns foins particuliers
; on les' change ne. pots à mefure qu
grandiflem, & l'hiver on les rentre dans loran
gerie. Il efl préférable de placer les efpèces nouvellement
- reçues •. pn Europe, dans une. ferre
tiède pendant l’biyer ; mais les plants
enfuite par boutures ..peuvent très bien palier a.
l ’orangerie. '
■ Les grahies perdent très - promptement leur
qualité germinative ; loilquun Diofma ”
des graines bien aoûtées, il faut les femer
tout de fuite dans des pots remplis d une je, rc
très - 'légère ; il faut avoir foin quelles loient
très- pem recouvertes. Un inconvénient de ce
mode de multiplication, efl que les graines relient
' très-long temps à lever. Le jeune, plant
obtenu de graine, ne demande aucuns loins par-
ticuliers.
Les Voyageurs qui voudront envoyer des
graines de Diofma du Cap ne rendrontleur
foins fma'ueu'x qu'en flratifiant les graines dans
de la terre fèche. Voyci le mot G r a in j , ou
feront indiquées les précautions neceffaires pour
leur confervaiion.
Ufages.
Les Diofmas font un des genres de plantes
qui contribue le plus à la décoration de nos
Orangeries pendant l’hiver, & de nos ,
pendant les autres faifons. Leur formea ré,jb
leur verdure cônflante & leur odeur diftmguée
y contribuent; prefque toutes ont une ver-
dure agréable.
Au rapport de Seba, les Hottentots prifent
beaucoup le Diofma velu ; iis en .
huile aromatique utile pour fortifier les n .rfs.
Ils lui attribuent auffi des vertus contre la ret™-
,ion d’urine. Le Diofma éricoïde entré aufli dans
leur Pharmacie. En général, ce genre efl encore
peu connu, quoique 1 une de fes efpèces, loit
iepuis long-temps dans les Jardins peut e
D I P "
que de nouvelles obfervations indiqueront encore
de nouveaux ufages. ( L. h z r x iïR -J
DIPHISE, DiTmSst.
Genre établi par Jaequin, & qui rentre dans
la famille, naturelle des L égumineuses. Près
des R obiniers. U efl remarquable par deux
veflies qui fe forment (ur les côtés
| tandis que le légume lui.-même ne# point
! enflé. r ,
EJpece.
t. D iphise de Carthagène.
Diphifa carthagcncnjîs. Jacq. X> Des environs
de C efl un arbufte dont le port reffemble à celui
des Acacies en arbre, & qui, par cqnfe|oeut
n'a rien d'agréablç dans fon port. Le, feuilles
font petites , compofées de. onze folioles écb
crées au fommet. Les fleurs font axillaires por
tées \ u nombre de deux ou trois fur des pédun-
cules axillaires; elles font de couleur jaune &
exhalent une odeur agréable, mais foible.
Culture.
Cet arbufte n’exifte pas encore dans nos Jar-i
! dins d’Europe. Son analogie de . conformation ,
bien diflinfte de l’analogté de genre, ,Par01t
diquer des. foins analogues à^ceux quon donne
aux Acacies en arbre. ( L. R e y n i e r . )
DIPS Les habitans du Mont-Liban donnent
ce nom* à une .boiffon qu’ils préparent avec le
moût de Rabin. C’eft une efpèce de iirop q» il»
évaporent jui'qu'à ce qu’il au pris' une certaine
confiftance*; - ils le clarifient en y jettant un
peu de terre argiUeufe. Journal dc.Phyfym m ° >
anvier. ( L. Re y n i e r . ) '
DIPSACÈES. Nom d’une famille naturelle,
qui contient la Cardire & les autres plantes
dont les fleurs font difpofées de même.
Q L . R e y n i e r - )
DIRCA, Dirca.
Genre de plantes de la famille des G aroto, ;
& très-voifin des T h ï melées , par fes rapports
& fa conformation. Sa fleur efl une corolle mo-■
nppétale en tube, qui contient huit étammos
faillantes hors de la corolle : 1 ovaire eflVupé
rieur & furmonté d’un flyle, auquel fuccède une
baie qui contient une feule femence.
Efpèce.
i . Dirca des marais.
Dirac palujlris L. ï> des lieux marécageux
& ombragés de l’Amérique feptenir, onale. _
C’eft un arbufte qui s’élève a cinq & fix pieds
I de hauteur dans fon pays natal : fou bois e»
léger, couvert d’une écorce tenace, & qui maille
au lieu de rompre, àinfi que les.rameaux. Les
Canadiens lui donnent les noms de Bois de plomb j
& Bois de cuir: Duhamel préfume, avec iaiion,
que le premier de ces noms eft une alîufion à
la qualité fpongieufe & légère de fon bois. Le
Dirca fleurit de bonne heure, fes fleurs paroif-
fent avant le développement des feuilles, comme
celles de la Lauréole gentille : elles font de
couleur herbacée, nuancées de blanc, femblables
à celles de la Lauréole tfaymelée. Les feuilles
paroi fient après les fleurs; elles font ovales, &
[ colorées de blanc en-deffous par un duvet peu
; fenfible.
Culture.
Le Dirca réuffit difficilement dans nos Jardins,
l & n’y donne jamais de graines. On ne le multiplie
que de boutures ; qu’on plante en été dans
un lieu ombragé, & qui fotrvent font deux années
avant de pouffer des .racines. Il faut avoir
! foin de couvrir de feuilles les jeunes plants à
i’approche des gelées, mais avec la précaution
de relever ces abris 'au moment du dégel, afin
de prévenir que l’humidité, concentrée par
celle de l’atmofphère, ne les fafle périr, Lorf- :
que ces àrbuftes font parvenus à une certaine
groffeur , il faut les couvrir d’un paillaflbn,
feulement dans les fortes gelées, qui feules peuvent
l’endommager. Il craint auffi les retours de
froid qui fuccèdent aux printemps précoces, &
qui nuifent d’autant plus aux plantes, qu’elles
font plus vernales.
La terre qui lui convient le mieux efl le terreau
de bruyère ; il doit être placé à l’expofition
du Nord, dans les mêmes plates-bandes où l’on
cultive les Andromèdes, le Ledon & les autres
[ arbüfles de l'Amérique feprentrionale. Voyei
; A ndromède au ViBionnaire des Arbres & Ar-
1 bufies. ( L. R e y n i e r . )
DIRECTION des plantes.
Pourquoi les végétaux, dès leur germination,
! tendent - ils à prendre la -direéHon verticale ,
ï contraire à la pefanteur u n iv e r fe lle d e telle
| manière que dans toutes les polirions de la graine,
f la plumule fe reploie jufqu’au moment où elle
[ a pris cette direction ? Cette queflion , fi. im-
[ portante pour la connoilTance de la phyfiologie
r végétale, fans laquelle il ne peut exifler de
vraies connoifîances en Agriculture, doit occuper
une place dans ce Dïtlionnaire. Une tendance
fi univerfelle indique un befoin ; & il
-faut connoître les befoins des végétaux , fi en
veut les cultiver d’une manière profitable.
Avant de propofer quelques idées fur la Di-
[ reétion des p la n te s j’ai cru devoir rapporter
les Opinions qui ont déjà éfé énoncées dans le$-
; Mémoires de VAcadémie des Sciences, iyo8 &
; dans l’Encyclopédie ancienne? art. Perpendicularité
; je ne connois aucun traité plus moderne
fur ce fnjer.
Dodart fup.pofe que les fibres des tiges font
de telle nature , qu’elles fe raccourciflènt par
la chaleur du foleii, & s'allongent par l ’humidité
de la terre., & qu’au contraire celles des
racines feraccoiircifi’e-nt parl’bumidité de la terre,
& s’allongent par la chaleur du foleii.
Selon- cette hypothèfe' quand la plante efï
renverfée, & que la racine eft par conféquent
en haut, les fibres d’un même écheveau ,
qui fait une des branches de la racine, ne font
pas également expofées 'à l’humidité de la terre ;
celles qui regardent en en bas, le font plus que
les fupérieures. Les fibres inférieurs doivent donc
fe raccourcir davantage, & ce raccourcifiement
efl facilité .par 1 allongement dis fupérieurs, fur
lefquels le foleii agit avec plus de force. Par
conféquent cette branche entière de racine fé
rabat du côté de la terre : & comme il n’efl rien
de plus délié qu’une racine naiiïante, elle ne
trouve point de difficulté à s’infinuer dans les
pores d’une terre qui feroit même aflèz com-
paèle, & cela d’autant moins qu’elle peut gauchir
en *tout fens, pour trouver les pores les
plus voifins de la perpendiculaire. En renversant
cette idée, Dodart explique pourquoi, au
contraire; la tige fe redrefle': en un mot, on
peut imaginer que la terre attire à elle la racine ,
& que le foleii contribue à la laifler aller ;
qu’au contraire le foleii attire la tige à lu i, &
que la terre l’envoie en quelque forte vers 1«
. foleii.
A l’égard du redreffemert de la tige en pfem
air , Dodart l’attribue à l’imprefiion des âpens
extérieurs, principalement du foleii & de la pluie *,
car la partie fnpérieure d’une tige pliée efl plus
| expofée à la pluie, à larofée & même au foleii,
que la partie inférieure : or, la flru&ure dès
! fibres peut être telle que ces deux csufes, favoir
l’humidité & la chaleur, tendent également à
redrefler la partie qui efl la pins expofée à leur
aètion , par l’accourciflèment qu’elles preduifent
fucceffivemenr dans cette partie ; car 1 humidité
accourcit les fibres en gonflant, & la chaleur en
diffipant. Il efl vrai qu’on ne peut deviner quelle
doit être la flruélure des fibres, pour quelles,
aient ces deux qualités différentes.
Lalive explique* ce même phénomène, de la-
manière fuivanie : il conçoit que dans les plantes
la racine tire un fuc plus greffier & plus pefanr
&. la tige au contraire & les branches, un fuc
plus fin ■ & plus volatil ; & en effet la racine
pafle, chez tous les Phyficiens, pour l’eflomac
de la plante, où les fuçs terreflres fe digèrent
& fe fubiilifent au point de pouvoir enfuite
- s élever jufqu’aux extrémités des branches. Cette:
différence des fues fuppofe de plus grands pores»
dans la racine que dansla tige & dans les branches "
en un mot, une différente contexture-, & cette