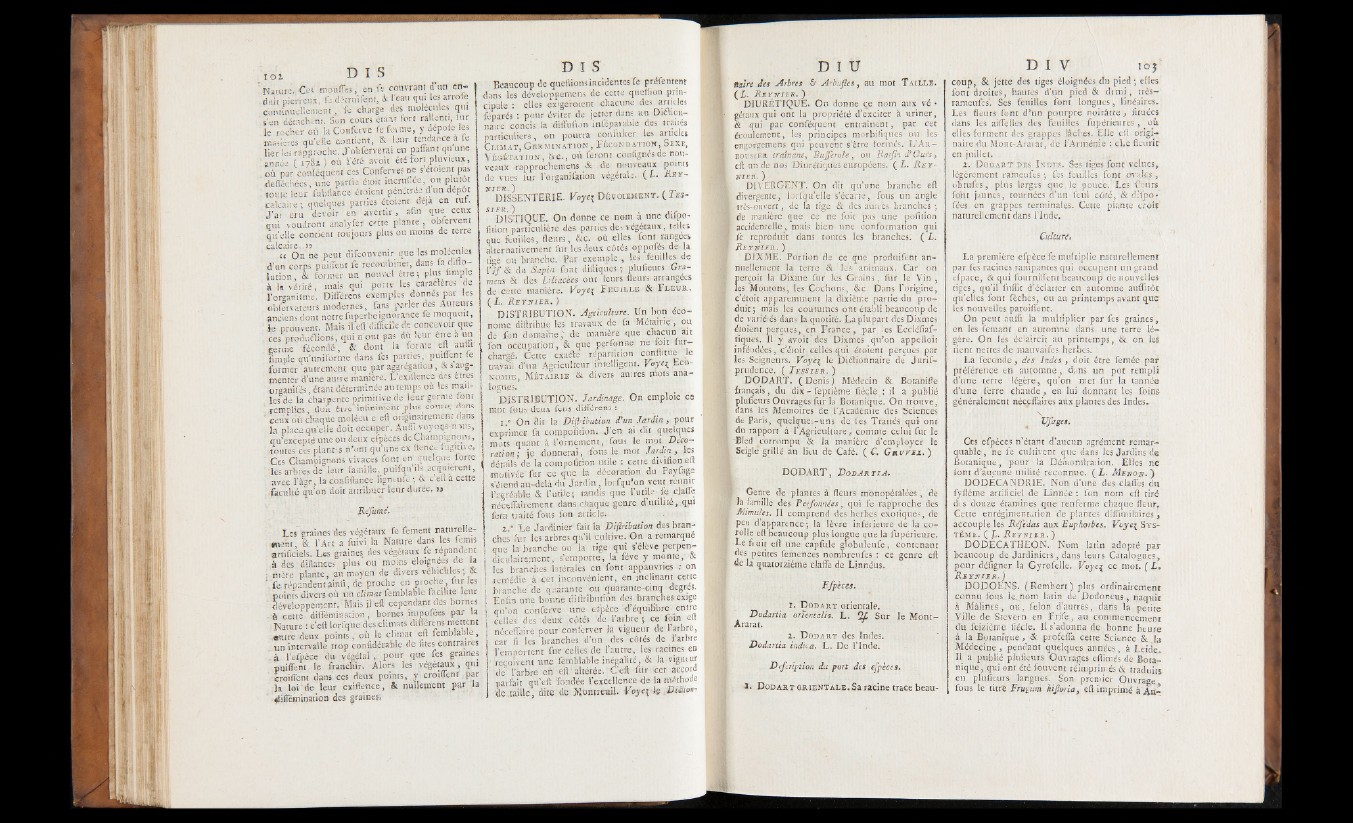
l o i D I S
Nature. Ces moufles, en fe couvrant fl un enduit
pierreux, lo dén uifenr, i l'eau qui les arrofe
continuellement j le charge des molécules qui
s'en détachent. Son cours étant fort ra ient;; lur
le rocher où la Conferve le forme, y dépole les
mstié-es quelle Contient, & leur tendance a le-
lier les rapproche. J ’obferverai en paflam qu une
-nnée ( 1781) où l’été avoit été fort pluvieux,
où par conïéqtient ces Conferve? ne s'étoient pas
deflediées, une partie étoit incrufiée, ou plutôt
toute leur fubllar.ee étoient pénétrée d un dépôt
calcaire; quelques parties étoient déjà en tut.
J'ai cru devoir ' en avertir, afin que ceux
qui voudront analyfer cette plante , obfervent
ntt’i'ile contient toujours plus ou moins de terre
C<' et On ne peut difeonvenir que les molécules
d'un corps puilTent lé recmnbiner, dans fa diflç-
lution, & former un nouvel être; plus ümple
ù la vérité, mais qui porte les caractères de
l’organiime. Différens exemples donnés par les
obt'erv tireurs modernes, fans parler des Auteurs
anciens dont notrefuperbeignorance fe moquoit,
le prouvent. Mais il eft difficile de concevoir que
ces produirions, qui n om pas dû leur être a un
germe fécondé, & dont U forme en aulfi
dm pie qu’uniforme dans lès parties, piaillent fe
former autrement que par agprégâuon, S s augmenter
d’une autre manière. L ’exiftencc des êtres
organifés, étant déterminée au temps où les malh
les de la charpente primitive de leur germe font
. remplies, doit être infiniment plus courte dans
’ ceux où chaque moléeu'e eft originairement dans
la place qu'elle doit occuper. Audi voyoqs-n ans,'
qu’excepté une ou deux elpèces de Champignons,
toutes ces.plantés n’ ont qu’uneex llençc fugitive.
Ces Champignons vivaces font en quelque lorte
lés arbres de leur famille, puifqu’ils acquièrent,
avec l’âge, la cônliftance ligneule ; & c en à cette
faculté qu’on doit attribuer leur durée. »
j Refume.
Les graines des végétaux fe fernent naturelle^
ment, & l'Art a fuivi la Nature dans les femis
artificiels. Les graines, des végétaux fe répandent
à des diftanccs plus ou moins éloignées de la
mère plante, au moyen de divers véhicules; St
fe. répandent ainü, de proche en proche,.lu r les
points divers où .un climat femblable facilite leur
■ développeurepr. Mais il eft cependant dés bornes.
è cette diffamation,, bornes impofées .par la
Nature : c’eft lorfque des climats différens mettent
entre deux points, où le climat eft femblable,
un intervalle trop conüdétsable de fîtes contraires
à l’efp.èce du végétal, pour que les graines
puiffenc le franchir. Alors les végétaux, qtu
croiffem dans ces deux points, y croiffent par
la loi de leur exiftence, & nullement par la
difféminaiion des graines;
D I S
Beaucoup de queflions incidentes fe préfentent
dans les développe mens de cette qiiellion principale
: elles exige'roient chacune des articles
féparés : pour éviter de jetter dans un Diéfion-
naire concis la diffulion inlépaiabie des traites
particuliers, on pourra conlulter les articles
Ci.iàiAT, Germination , F écondation, Sexe,
V égétation’ , S c . , où feront coniignés de nouveaux
rapprochemcns & de nouveaux points
de vues fur l’organilaiion végétale. (F . Rxr-
^DISSENTEKIE. Voye^ Dévoiement. { T es-
StJTE. ) ,
DISTIQUE. On donne ce nom a une chlpo-
lîtion particulière des parties des végétaux, telles
que feuiiies, fleurs, &c. où elles font rangées
alternativement fur les deux côtés oppofés de- la
lise ou branche. Par exemple , les. feuilles de
Y I f & du Sapin font diftiques ; plufieurs Gra-
mens Si des Ldi actes ont leurs fleurs, arrangées
de çette manière. Voyt[ F euille & F l eu r ,
( L. R e y n i e r . )
DISTRIBUTION. Agriculture. Un bon économe
diftribueles travaux de fa Métairie , ou
de fon domaine f de manière que chacun ait
fon occupation , & que perfonne ne foit fur-
chargé. Cette exaéle répartition conftitüe le
travail d’un Agriculteur intelligent. Voye\ Economie,
Métairie & divers autres mots analogues.
DISTRIBUTION. Jardinage. On emploie ce
mot fous deux febs différens :
1 l.° On dit la Difiribution d’un Jardin , pour
exprime« fa compofition. J ’en ai dit quelques
mots quant à l ’ornement, fous le mat Décoration
; je donnerai, Tous le mot Jardin , les
détails de la compofition utile : cette divifion eft
motivée fur ce que la décoration du P.ayfage
s’étend au-delà du Jardin, lorfqu’on veut réunir
l’agréable & l’utile; tandis que l’utile’ fe clatle
néceflairement dans chaque genre d’utilité, qui
fera traité fous fon article.
2.0 Le Jardinier fait la Diftribution des branches
fur les arbres qu’il cultive. On a remarqué
S que la branche ou la tige qui s’élève perpen-
} dieu! ai renient, s’emporte, la fève y monte,' &
les branches latérales en font appauvries : on
! remédie à cet inconvénient, en inclinant cette
j branche de quarante ou quarante-cinq degrés.
I Enfin une bonne diftribution des branches exige
I qu’on conferve une eîpèce d’équilibre entre
| celles des deux cotés, de l’arbre ; ce foin eft
néceffaire pour conferver la vigueur de l’arbre,
car fi les branches, d’un des côtés de 1 arbre
l’emportent fur celles de l’autre, les racines en
reçoivent une femblable inégalité, & la vigueur
de i’ârbre eh eft altérée. C’eft Tür cet accord
parfait qu’eft fondée l’excellence de la méthode
dç.taille, dite' de Montreuil. Voyt\M, JDtôiw
D I U
nuire des Arbres & Arbujles, au mot T aille.
(£ . Re ynier . )
DIURÉTIQUE. On donne ce nom aux vé •
gétaux qui ont la propriété d’exciter à uriner,
& qui par conféqüent entraînent, par cet
écoulement, les principes morbifiques ou les
engorgemens qui peuvent s’être formes. L ’A r bousier
traînant, Bujferole, ou Raijii d10 ufs,
eft un de nos Diurétiques européens. ( L. Re y nier.
)
DIVERGENT. On dit qu’une branche eft
divergente, lorfqu’elle s’écarte, fous un angle
très-ouvert, de la tige & des aùrres branches ;
| de manière que ce ne foit pas une pofition
1 accidentelle, mais bien une conformation qui
fe reproduit dans toutes les branches." ( L.
Reynier. )
DIXME. Portion de ce que produifent annuellement
la terre & les animaux. Car on
Îierçoit la Dixme fur les Grains, fur le Vin ,
es Moutons., les Cochons, &c. Dans l’origine,
c’étoit apparemment la dixième partie du produit
j mais les coutumes ont établi beaucoup de
de variétés dans la quotité. La plupart des Dixmes
étoient perçues, en France, par les Eccléfiaf-
tiques. Il y avoit des Dixmes qu’on appelloit
inféodées, c’étoit celles qui étoient perçues par
les Seigneurs. Voyé% le Dictionnaire de Jurif-
prudence. ( Tessier. )
DODART. ( Denis ) Médecin & Botanifle
français, du dix - feptième fiécle : il a publié
plufieurs Ouvragés fur la Botanique. On trouve,
dans les Mémoires de l’Académie des Sciences
de Paris, quelques-Un s de fes Traités qui- ont
du rapport à l’Agricuhùre 3 comme celui fur le
'Bled corrompu & la manière d’employer le
Seigle grillé au lieu de Café. ( C. G n u v s z . )
DODAR T, V odartia.
F ' Genre de plantes à fleurs monopétalées, de
la famille des Perjonnées, qui fe rapproche des
Mimules. 11 comprend desherb.es exotiques, de
peu d’apparence ; la lèvre inférieure de la corolle
eft beaucoup plus longue que la fupérieure.
Ee fruit eft une capfule globuleufe, contenant
des petites femences nombreufes : ce genre eft
de la quatorzième clafle de Linnéus.
Efpeces.
i . Dodart orientale.
Dodariia orïentalis. L . % Sur le Mont-
Ararat.
1 . Dodart des Indes.
Dodartia indica. L. De l’Inde.
Defcription du port des efpeces.
J. Dodart orien ta le. Sa racine trace beau-
D I V i o j
coup, & jette des tiges éloignées du pied; elles
font droites, hautes d’un pied & demi, très-
rameufes*. Ses feuilles font longues , linéaires.
Les fleurs font d’ un pourpre noirâtre , fituées
dans les aiffelles des feuilles fupérieures, où
elles forment des grappes lâches. Elle \eft ■ originaire
du Mont-Ararat, de l ’Arménie : ebe fleurit
en juillet.
2. Dodart des I ndes. Ses tiges font velues,
légèrement ram eu fes ; fe s ,feuilles font Oraiqs,
obtufes, pins larges que le pouce. Les ^fleurs
font jaunes, tournées d’un feul côté, & difpo-
fées en grappes terminales. Cette plante oroîs
naturellement dans l’Inde.
Culture»
La première efpèce fe multiplie naturellement
par Tes racines rampantes qui occupent un grand
efpace, & qui fournirent beaucoup de nouvelles
tiges, qu’il fuffit d’éclatter en automne auffitôt
qu’elles font fèches, ou au printemps avant que
les nouvelles paroiflenr.
On peut aulfi la multiplier par fes graines,
en les (èmant en automne dans une terre légère.
On les éclaircit au printemps, & on les
tient nettes de mauvaifes herbes.
La fécondé, des Indes , doit être femée par
préférence en automne, cEns un pot rempli
d’une terre légère, qu’on met fur la tannée
d’une ferre chaude , en lui donnant les foins
généralement nécpffaires aux plantes des Indes.
\
^ Ufages.
Ces efpèces n’étant d’aucun agrément remarquable,
ne fe cultivent que dans les Jardins de
Botanique, pour la Démonstration. Elles ne
font d’aucune utilité reconnue. ( L. M enon. )
DODÉCANDRIE. Non d’une des claffes du
fyfiême artificiel de Linnée : fon nom eft tiré
de s douze étamines que renferme chaque fleur.
Cette enrégimentation de plantes diffimilaires,
accouple les Refédas aux Euphorbes. Voye^ Sy st
em t . ( L. R e y n i e r . )
DODÉCATHEON. Nom latin adopté par
beaucoup de Jardiniers , dans leurs Catalogues,
pour défigner la Gyrofelle. Voyei ce mot. ( L .
Re ynie r . )
DODOENS. ( Rembert ) plus ordinairemenf
connu fous ie^norn latin de Dodoneus, naquit
à Mâlines, ou, félon d’autres, dans la petite
Ville de Stevern en Frife, au commencement
du feizième fiécle. Il s’adonna de bonne heure
à la Botanique , ■ &. profefla cette Science & la
Médecine , pendant quelques années, à Leide.
Il a publié plufieurs Ouvrages efiimés de Botanique,
qui ont été fouvent réimprimés & traduits
en plufieurs langues. Son premier Ouvrage
fous le titre Eru^um kifloria, eft imprimé à A n -