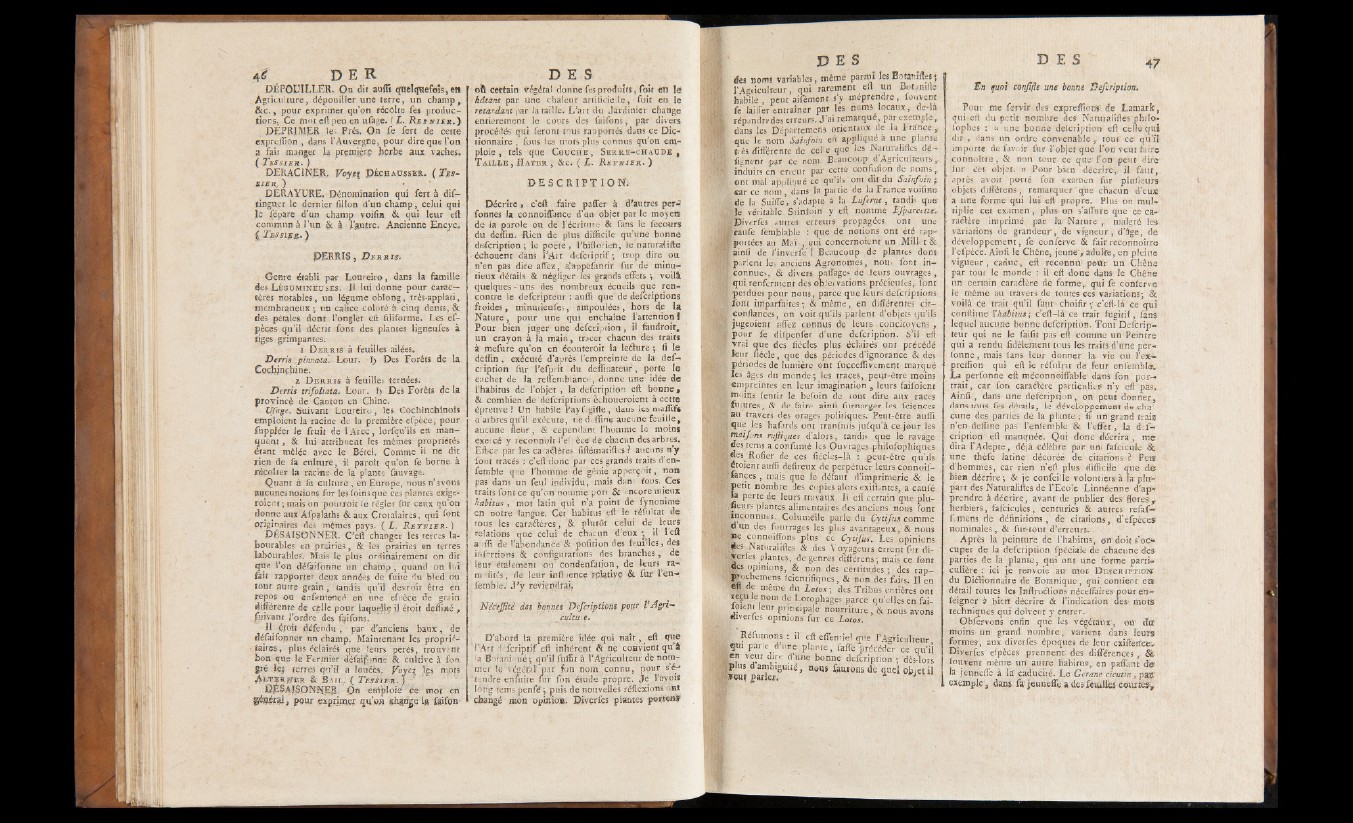
■ 0. ' D E R
DÉPOUILLER. On dit aufli quelquefois, «1
Agriculture, dépouiller une terre, un champ,
& c . , pour exprimer qu’on récolte fes productions;
Ce mot eft peu en ufage, ( L. Re y n ie r . )
DÉPRIMER les Prés. On (e fort de cette
exprefllon , dans l’Auvergne, pour dire que l’on
a Fait manger la première herbe aux vaches.
( T es sier. )
DERACINER,. V°y?l Déchausser® ( T es-
SIER, ) '
DE RAYURE. Dénomination qui fert à distinguer
le dernier fiUon d'un champ, celui qui
Je fépare d’un champ voifin & qui leur eft
commun à l ’un & à 1 autre. Ancienne Encyc,
| Tessier» )
PER R IS , D e r r i s .
Genre établi par Loureiro, dans la famille
des L égumineuses. Il lui donne pour caractères
notables, un légume oblong, très-applati,
membraneux ; un calice coloré à cinq dents, 3c
des pétales dont l’onglet eft filiforme. Les espèces
qu’il décrit font des plantes ligneufçs à
tiges grimpantes.
i D erris à feuilles ailées.
Derris pinna/ta. Lpur. ï> Des Forêts dç la
Cpçhmçhine.
2. Der r is à feuilles ternées.
Derris trifoliata. Lotir. ï) Des Forêts de la
provincè de Canton en Chine.
Ufage. Suivant Loureiro, les Coçhinchinois
emploient la racine de la première efpèce, pour
fuppléer le fruit de 1 Arec, lorfqu’ils en manquent,
& lui attribuent les mêmes propriétés
étant mêlée avec le Bétel. Comme il ne dit
rien de fa culture, il paroît qu’on fe borne à
récolter la racine de la plante fauvage.
Quant à fa culture , en Europe, nous n’avons
{aucunes notions fur les foins que ces plantes exige*
roient; mais on pourroit fe régler fur ceux qu’on
donne aux Afpalaths & aux Crotalaires, qui f ° nt
originaires des mêmes pays. ( L. R e y n i e r . )
DÉRAISONNER. C'eft changer les terres labourables
en prairies, & les prairies en terres
labourables. Mais le plus ordinairement on dit
que l’on défaifonne un champ, quand on lui
fait rapporter deux années de fuite du bled ou
tout aurre grain, tandis qu’il devroit être en
yepos ou enfgmeneé en une efnèce de grain
différente de celle pour laquelle il étoit deftiné ,
fgîvan* l’ordre des f?ifons.
II étoit défendu f par d’anciens baux, de
défaifoiiner un champ. Maintenant les propriétaires,
plus éclairés que leurs pétés, trouvant
bon que le Fermier défaifonne & cultivé à' fon.
gré le| terres qu’il a louéès, Voye\ les m.Ots
'& B a U.. ( TpsèiE*. y 1
DERAISONNER, Qn emploie? ce mot en
$8#**}, pour exprimer qu’op shgnje 1# (»fon
D E S
oh certain végéta! donne fes produits, foit en le
hâtant par une chaleur artificielle, foit en le
retardant par la taille. L ’art du Jardinier change
entièrement le cours des faifons, par divers
procédés qui feront tous rapportés dans ce Dictionnaire
, fous ies mots plus connus qu’on emploie
, tels que Co u ch e , Se r r e - chaude #
T a ill e , Hâter , &c. ( L. R e y n ie r . )
D E S C R I P T I O N .
Décrire, c’eft faire paffer à d'autres per-
Tonnes la connoiffance d’an objet parle mojen
de la parole ou de l ’écriture & fans le feeours
du deflin. Rien de plus difficile qu’une bonne
defeription ; le poète , l’hiflorien, le naturalifte
échouent dans $%rt deferiptif; trop dire ou
n’en pas dire affez, slappefanrir fur de minutieux
détails & négliger ies grands effets ; voilà
quelques - uns des nombreux écueils que rencontre
le deferipteur : aufli que de jdeferiptions
froides, minutieufes, ampoulées, hors de la
Nature, pour une qui enchaîne l'attention !
Pour bien juger une defeription, il faudroit#
un crayon à la main, tracer chacun des traits
à mefure qu’on en écouteroit la leélure ; fi le
deflin , exécuté d’après l’empreinte de la def—
cription fur l'efprit du deflinateur, porte le
cachet de la reffernblance, donne une idée de
l'habitus de l’objet , la defeription eft bonne,
& combien de deferiptions échoueroient à cette
épreuve! Un habile Payf gifle, dans les maflifs
a arbres qu’il exécute, ne dr fline aucune feuille,
aucune fleur, & cependant l’homme le moins
exercé y reconnôît i’efr ècerde chacun des arbres.
Efl-ce par les caractères fiftématiftes ? aucuns n’y
font tracés : c’eft donc par ces grands traits d’en-
femble que l’homme de génie apperçoit, non
pas dans un feul indivjdu, mais dan - tous. Ces
traits font ce qu’hn nomme porr & encore mieux
habitus, mot latin qui n’a point de fynonime
en notre langue. Cet habitus eft le réfuhat de
rous les caractères , & plutôt celui dé leurs
relations que celui de chacun d’eux ; il left
a iffi de l’abondance & polition des feuilles, des
infr-rtions & configurations des branches, de
leur étalement ou condenfation, de leurs ra-
mnfités, de leur infl iencç relative & fur l’en-,
femble. J 'y revjçqdrah
Nâdcjfité des bonnes Defcriptiçns pour VAgri—
jci/iltwe.
D’abord la première jdée qui n aît, eft que
l’Art d feriptif eft inhérent & né convient qu’â
ia B'jiani ué; qu’il fuffit à l’Agriculteur dè nommer
îeVégér'.il par fon nom connu, pour s’é-*
'tendre enfuite fur fon étude propre. Je Pavois
lô’ifg fems penfé; puis de nouvelles réflexions ont
changé mon opinio*. Divçrfes plantes portent
6es noms variables, même parmi lesBotanifes;
l ’A c t icu lte u rq u i rarement en un Botmifle
habile , peut aifément s’y méprendre, fouvent
fe Iaiffer entraîner pair les noms locaux, de-la
répondre des erreurs. J’ai remarqué, par exemple,.
dans les Départemens orientaux de la France:-,,
que le nom Sainfoin eft appliqué à Aine plante
très différente de celle que les Naturaliftes d é -
I fignenr par ce nom Beaucoup d Agriculteurs-,,
I induits en erreur par cette confafion de roms ,■
1 ont mal appliqué ce qu'ils ont dit du Sainfoin }
car ce nom, dans la partie de la France voifrne
de la Suiffe, s’adapte à la Lufeme, tandis que
le véritable Sainfoin y eft nommé Efparcetts:
Diverfes autres erreurs propagées ont une
Bèaufe femblable : que de notions ont été rap^-
Iportées au Mai-, oui concernoient un Millet & s
| ainfi de l’inverfe j Beaucoup de plantes dont
I parlent les anciens Agronomes, nour font in-
I connues, & divers paflages de leurs ouvrages,
I qui renferment des obiervarions précieulcs*. font
ï perdues pour nous, parce que leurs deferiptions I font imparfaites; & même, en différentes ciF-~
I confiances, on voit qffils parlent d’objets qu’ ils
K jugeoient affez connus de leurs concitoyens ,
I pour lé difpenfer d’une defeription. S’il eft
! vrai que des liécles plus éclairés' ont précédé
leur fiécle, que des périodes d’ignorance & des
périodes de lumière ont fucceflîvement marqué
| les âges du monde; les traces, peut-être moins
| empreintes en leur imagination , leurs faifoient
moins fentir le befoin de tout dire aux races
ifutures, & de faire ainli furnarger les fciences
f au travers des orages politiques. Peut-être aufli
j que les hafards ont tranfmis jufqu’à ce jour les
vmaijons rufliques d’alo/s, tandis que le ravage
Ides rems a confumé les Ouvrage.sphilofophiques
Ides-Rofier de ces fiécles-là : peut-être qu’ils
l'étoient aufli defireux de perpétuer leurs connoif-
|fances , mais que le défaut d’imprimerie & le
.petit nombre des copies alors exiftsntes, a caufë
la perte de leurs travaux. Il eft certain que plu-
pffeurs plantes alimentaires des anciens nous font
inconnues., Columdle parle du Cytijus comme
dun des fourrages les plus avantageux, & nous
|fie connoiffons .plus"’ ce Cytifus. Les opinions.
I le s Naturaliftes & des V oyageurs errent fur di-
verfes plantes, de genres différens; mais ce font
des opinions, & non des certitudes,; des rap-
feientifiques, & non des faits. Il en
S I même du Lotos ; des Tribus entières ont
reçu le nom de Lorophages parce quelles en fai-
xoient leur principale nourriture, & nous avons
eiveries opinions fur ce Lotos.
Réfumons : il eft efienrie! que l’Agriculteur
|qui parie d’ure plante, faflé précéder ce qu’il
|en veut dire d’une bonne defeription ; dès lors'
jplus d ambiguité nous (aurons de quel objet il
parler.- u u j
En quoi confiée uni bonne Defeription.
Pour me fervir des: expreflions' de Lamark,
qui'eft du petit nombre deÿ Naturaliftes philo*
fophes- : « une bonne delcription eft celle qui
d i t , dans un ordre convenable,, tout: c e qu’il
importe de fiivoir fur L’objet que L’on veut faire
connoître, & non tour ce que l'on peut dire
fur cet objet. » Pour bkn décrire,, il faut,
après avoir porté fon examen fur plufieurs-
objets différens, remarquer que chacun d’eux
a une forme qui lui eft propre. Plus on multiplie
cet examen, plus on s’aflure que ce ca-
ra&ère imprimé par la Nature ,, malgré les
variations de grandeur, de vigueur, d’âge, de
développement, fe confervo & faitreconnoîrre
F efpèce. Ainfi le Chêne, jeune-* adulte, en pleine
vigueur, caduc , eft reconnu! pour un Chêne
par tout le monde : il eft donc dans le Chêne
un certain caractère de forme,, qui fe conferve
le même au travers de toutes cés vàriations ; &
voilà ce trait qu’il faut choifir ; c’efl-là ce qui
conftitue l'habitus; c’eft-là ce trait fugitif, fans
lequel aucune bonne defeription. Tout Deferipteur
qui ne le faifit pas eft comme un Peintre
qui a rendu fidèlement tous les traits d’une per-^
lonne, mais fans- leur donner la vie ou l’e x -
preflïon qui eft le réfuirat dé leur enfemble*
La perfonne eft méeonnoiffable' dans fon portrait,
car fon caractère partieuliv.r n’y eft pas.
Ainfi , dans une defeription, on' peut donner,
dans tous fes détails, le développement de chacune
des parties de la plante ; h un grand traie
n’en deflin e pas l’enfemble & I effet, la d t f-
cription eft manquée. Qui donc décrira , me
dira l’Adepte, déjà célèbre par uni fafcicuie &
une thèfe latine décorée de effarions ? Peuî
d’hommes, car rien n’eft plus difficilè que de
Bien décrire; & je confeiile volontiers à là plupart
des Naturaliftes de l’Ecole Linnéenne d’ap^
prendre à décrire, avant de publier des- flores f
herbiers, fafcicules , centuries & autres refaf—
f. mens de définitions, de citations, d’efpèces
nominales v & fur-tout d'erreurs.
Après la peinture de l’habitus, oit doit s’occuper
de la defeription fpéciale de chacune des
parties de la plante, qui ont une forme particulière:;
ici je renvoie au' mot Description:
du Diéfionnaire de Boranique, qui contient em
détail toutes les Infiruèlions néceffaires-pour en-
feigner à bictf décrire & l’indication des mots
techniques qui doivent y entrer.-
Obfervons enfin que les végétaux, ou! diï
moins: un? grandi nombre ,, varient dans leurs
formes, aux diverfes époques de leur exiftèirce^
Diverfes efpèGêS prennent: des- différences &
fouvent même- un autre habitus,, en paflànt dis
la jeuneffe à là' caducité. Le Gerant cicutin, pa^-
exemple, dans fà: jeuneffe a des feuilles coiutesy