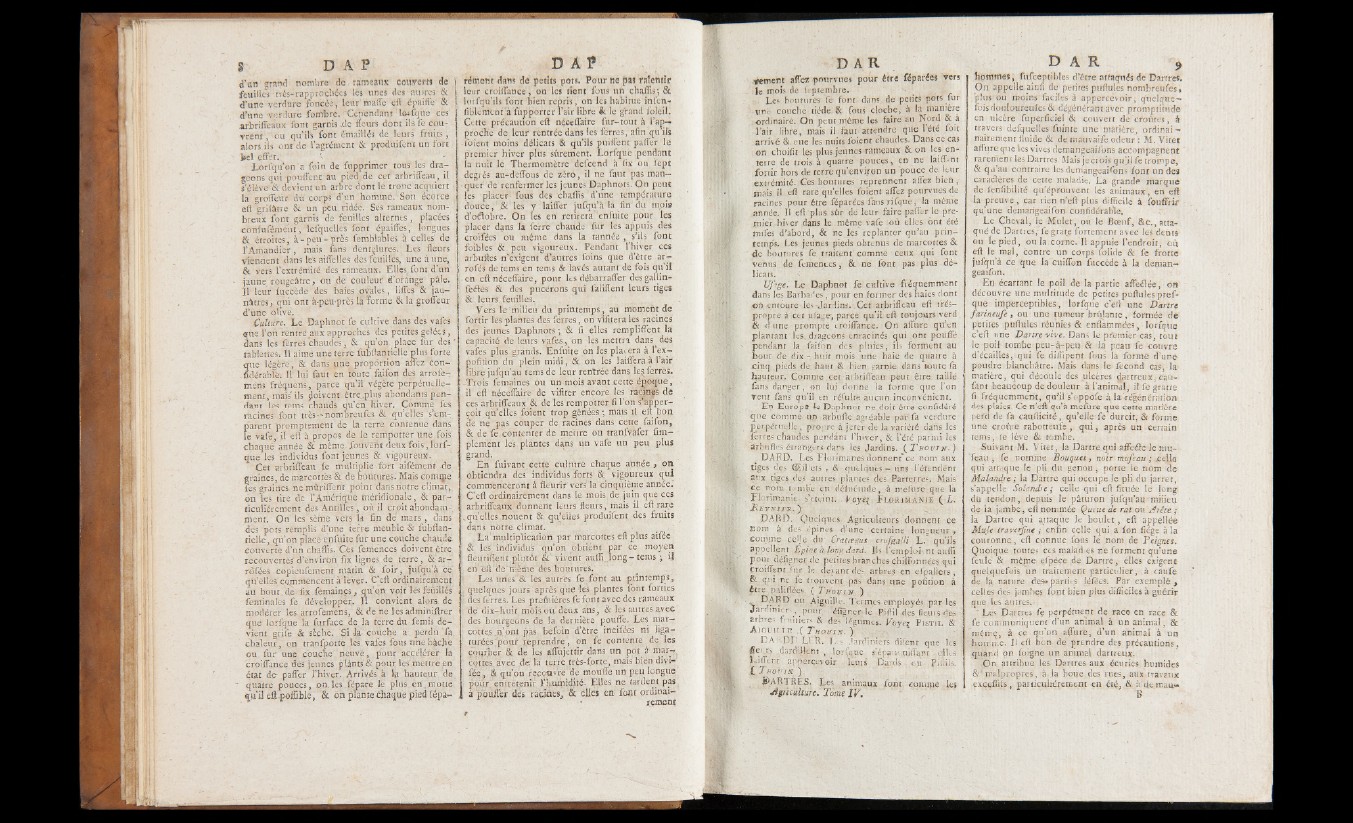
5 D A P
d'un grand nombre de rameaux couvert! de I
feuilles très-rapprocMcs les unes des arn-res &
d’une verdure foncée, leur niaffe éft épaiffe & !
d’une verdure fombre. 'Cependant l&sfqiie cès |
arbrifleaux font garnis-de fleurs dont ils fe cou- 1
vr.ent , ’ ou qu’ ils font émaillés de leurs' fruits,
alors iis ont de l'agrément & p^oduifeht un fort
bel effet. ’ , _
to r fq u ’on a foin de fnpprimer tous les drageons
qui pouffent au pied de cet arbriffeau, il
s’élève' & devient un arbre dont le tronc acquiert •
la groflevtf dit corps d’un homme. Son écorce (
eft griiâtre & un peu ridée. Ses rameaux nombreux
font garnis de feuilles alternes, placées
confafémént, lesquelles font épaiffes, longues
6 étroites, à -p e u -p rè s femblables à celles’ de
l’Amandier, mais fans dentelures. Les fleurs
viennent dans les aiffelles des feuilles, une aune,
& vers l’extrémité des/àmeaux. Elles, font d’un
jaune rougeâtre, ou de couleur d’orange pâle.
11 leur fuccède des baies ovales, liffes & jaunâtres,
qui ont à-peu-près là forme & la groffeur
d’urie Olive. >
Culture. Le Daphnot fe cultive dans des vafes
que l’on rentre'.aux approches des petites gelées,
dans les ferres chaudes, & qu’on place fur des ’
tablettes! Il.aime une terre fubftanrielie plus forte
que légère, & dans une proportion affez con-
-fidérablè. Il lui faut en toute faifon des arrofer
mens fréquens, parce qu’il végète perpétuelle- ;
menti, mais" ils jloiv-ent être^plus abondants pendant
les teins chauds qu’en hiver. Comme fes
racines font très I- nontbreufes & qu’elles's’emparent
promptement de la terre contenue dans
le vafe, il eft à propos de le remporter une fois
chaque année & même,fouvënt deux fois, lorfque
lés individus font jeunes & vigoureux.
Cet arbriffeau le multiplie fort aifément de
graines, de marcottés &. de boutures. Mais comipe
fes graines ne munirent point dans notre climat,,
on les tire de l’Amérique méridionale, & particulièrement
des Antilles, oit il 'croit abondamment.
On 'les sème vers' la fin dé mars, dans
dés pots remplis d'une teriae meuble & fubftan-
tielle, qu on place cnlttitc fur une couché chatidé
couverte d’un chaflis. Ces: fenienceis doivent être,
recouvertes d’environ fix lignes de .terre , & ar-
rofées côpieufemènt matin & fo ir , jufqu’à ce,
qu elles c.ojjimèncenf àièVer. C’eft ordm.air.emept
au bout.de fix.femaines, mi’qnr voit lès'feuilles
feminales fe développer:. 11 convient alors, de
modérer les arrofemens, & de ne les adminiftrer
que lorfque la futface de, la terre du ferais devient
gril'e & sèche. Si la couche; a perdu fa
c h a le u r o n tranfportè les vafes fous une bâche
ou fur une couche"'neuve, pour accélérer la
croiffanoe dés'jeunes plànts'& pour les’mettre en
état de palier l’hiver. Arrivés à la hauteur de
r quatre pouces, ,qn.les.fépare le plus eh,motte
qu’il eft.poifible, & on plante chaque pied fëpa-
D A P
rémcîît dans de petits pots. Pour ne pas ralentir
leur croiffancei on lès tient fous un chaflis•, &
lorfqu’ils font bien repris / on les habitué ihfen-
fibloment à fnpportér l’air libre & le grand foleil.
Cette précaution eft n£ceffaire fur-tout à fap—
proche de leur rentrée dans les ferres, afin qu iis
foient moins délicats & qu’ils puiflent paffer le
premier hiver plus sûrement. Lorfque pendant
la nuit 4e Thermomètre defeend à fix ou fept
degrés au-dèffous de zéro, il ne faut pas manquer
de renfermer les jeunes Daphnots. On peut
les placer fous des chaflis d’une température
d o u t é , l e s ' y laiffer jufqu’à là fin du moi»
d’odtobre. On les en retirera enfuite pour les
placer dans la ferre çhaiide fur lès appuis des
croifées ou même dans la tannée , s'ils font
foibles & peu vigoureux. Pendant l’hivçr ces
arbuftes n’exigent d’autres foins que d’être àr-^
rôfés de tems en rems & lavés autant de fois qu’il
en eft néceflaire, pour les débarraffer desgallin-
feétes & des pucérons qui lklifient leufs tiges
& leurs, feuilles.
Vers le "milieu du printemps, au moment de
fortir les plantes des ferres, on vifiterales racines
des jeunes Daphnots & fi elles remplirent la
capacité de leurs vafes, on les mettra dans des
vafes plus grands. Enfuite on les placera à l’ex—
pofition du plein micji, & on les laiffera à l’air
libre jufqu’au tems de leur rentrée dans le^ ferres.
Trois femaines ou un mois avant cette époque ,
il eft néceflaire de vifirer encore les racines de
ces arbrifleaux & de les remporter fi l’on s apper-
çoit qu’elles foient trop gênées ; mais il en bon
de ne pas- couper de racines dans cette faifon,
& de fe.contenter de mettre ou tranfvâfer Amplement
les plantes dans un vafe un peu plus
grand.
En fui van t. cette culture chaque année / on
obtiendra des individus forts & vigoureux qui
commencêront à fleurir vers la cinquième année.
C’eft ordinairement dans le mois. de juin que ces
arbrifleaux donnent leurs fleurs, mais il eft rare
v quelles nouent & qu'elles produifent des fruits
dans nôtre climat. 1
L a ‘multiplication par marcottes eft plus aifée
& les/individu/ qu’on obtient par ce moyen
fleuritient'plutôt & vivent auflir.long- teins j il
s eri' eft aè' même des boutures. '
■ Les unes’& les autres fe font au printemps,
| quelques jours après que les plantes font forties
j; des ferres. Les premières fe font avec des rameaux
de' dix-huit môî/ou deux ans, & les autres avec
des bourgeons de la dernière pouffe. Les marcottes
.n’ont pas befoin d’être incifées ni liga-
! turéès pour réprendre, on fe contente de les
çogfbér & de les affujettir dans un pd.t/à-
côttes avec de; fa terre très-forte, mais bien divi-
fë e , dt qü’on recouvre de moufle un peu longue
1 pour' entretenir )’humidité. Elles ne fardent pas
à pôiifTèr dés racines,, '& éllés en font ordinaU-
• renient
D A R
cément affez pourvues pour être féparées vers
Je mois de Lptembre. >■ ;,/ ,
Les boutures fe font dans de petits pots fur
une: couché tiède, & fous cloche, à la manière
ordinaire. On peut même les faire au Nord & à
Pair libre, mais il faut attendre que l été/oit
arrivé &. eue les nuits loient chaudes.. Dans ce cas
on choifit les plus jeunes rameaux & on les enterre
de trois à quatre pouces, en ne laiffunt
fortir hors de terre qu’envrron un pouce de. leur
extrémité. Ces bourures reprennent à fiez bien,
mais il eft rare qu’elles foient affez pourvues de
racines , pour être féparées fans rifque, la même
année. Il eft plus sûr de' leur faire paffer le premier
-hiver dans le même vafe où elles ont été
mîtes d'abord, & ne lés replanter qu'au printemps.
Les jeunes pieds obtenus de marcottes &
de boutures fe traitent'comme ceux qui font
venus de fc-mentes, & ne font pas plus délicats.
'
Ufnge.' Le Daphnot fe cultive fréquemment
dans les Barbades, pour en former des haies dont
on entoure-les Jardins.fiCet arbrifleau eft très-
propre à cet uiage*, parce qu’il eft toujours verd
& d une prompte troiffance. On affure qü’en
plantant les, drageons enracinés qui ont pouffé
pendant la faifon des pluies, ils forment au
bout de dix - huit mois une haie de quatre à
cinq pieds de. haut & bien garnie dans Doute fa
hauteur. Comme .cet arbriffeau peut être, taillé
fans danger, on lui donne la forme que l’on
veut fans qu’il en féluhe aucun inconvénient.
En Europe le Daphnor ne, doit être confidéré
que comme un arbufle .agréable par fa verdure
perpétuelle , propre à jeter de la variété dans les
ferres chaudes pendant l’hiver, & l’été parmi les
arbuftes étrangers dans jes Jardins. ( T houijj. )
DARD. Les Florimanes donnent* ce nom aux
tiges des OEihets , & quelques - uns l’étendent
aux çiges de/ autres plantes des. Parterres, Mais
ce nom t -mbe en déiuétude, .à mëfure que la
Florimanie. s’éteint. Voyt{. F l priman ie ( L.
Meynijch. y
DARD. Quelques/ Agriculteurs donnent ce
nom à des épines d’une certaine longueur,
comme cèlje du Cratoegus crujgalli L. qu’ils
appellent Epine à long dard. Ils l ’emploi-nt aufli
pour fléfigner de petites branches Chiffonnées qui
çroiffent fur le devant des arbre/:en. efpaüers ,
& p|| ne fe trouvent pàs dans une pofition à
être pâli fiées. ( T hou in )
DARD ou Aiguille. Termes employés parles
Jardinier- , ponr; éflgner- le Riflil des fleurs des
arbre" fruitiers & des légumts. Voyez Pistil &
A iguii t.tî . ( T houin. )
DA:'..DT?;LER/ I. s Jardiniers difenr que les
. .dardaient , iorÇque s’épa^v uillant elles '
V iffènI apperçevoir leurs Dards . ou Piiîils.
I T hOUIN ); •
^)ARTRE$. Les animaux font comme les
■ Agriculture, Tome ÎV ,
D a R 9
hommes, fufeepcibles d’être attaqués de Dartres.
On. appelle ainfi de petites puflules nombreufési
plus ou moins faciles à appercevoir, quelque—
fois dpiiloufeules & dégénérant avec promptitude
en ulcère fuperficiei & couvert de 'croûtes, à
travers defquelles fuinte une matière, ordinai-
nairemenr fluide & de mauvaife odeur : M. Vitet
affure que les vives demangeaifons accompagnent
rarement les Dartres. Mais je crois qu’iJ fe trompe,
& qu’au contraire les demangeaifons font un des
caractères de cette maladie. La grand«* marque
de fenflbilité qu’éprouvent les animaux, en eft
la preuve , car rien n’eft plus difficile à fouffrir
qu’une démangeaifon confidérable.
Le Cheval, je Mulet, ou le Boeuf, &c., attaqué
de Dartres, fe grate fortement avec les dents
ou le pied, ou la corne. Il appuie l’endroit, où
eft le mal, contre un corps folide & fe frotte
jufqu’à ce que la cuiffon fuccèdé à la deman-
geaifon.
En écartant le poil de la partie affeélée, on
découvre une multitude de petites puftules pref-
que imperceptibles, lorfque c’èfl une Dartre
farineufe, ou une tumeur brûlante, formée de
petites puflules réunies & enflammées, lorfque
c’eft une Dartre vive. Dans le premier cas, tout
le poil tombe peu-à-peu & la peau fe couvre
d’écailles, qui fe diflipent fous la forme d’une
poudre blanchâtre. Mais dans le fécond cas, la
matière, qui découle des ulcères dartreux,-cau-
fànt beaucoup de douleur à l’animal, il fe gratte
fi fréquemment, qu'il s’oppofe à. la-régénération
des plaies. Ce n'eft qtvà mefure que cette matière
perd de fa caufticité, qu’elîe-fe durcit, & forme
une croû:e rabotteufe , q u i, après un certain
rems, le lève & tombe.
Suivant M. Vitet, la Dartrequi affe&e le mti-
'fe.au , fe nomme Bouquet, noir mufeau ; .celle
qui attaque le pli du genou, porte le nom de
Malandré ; la Dartre qui occupe le pli du jarret,
s’appelle Solandte; celle-qui eft fituée le' long
du tendon, depuis le pâturon jufqu’au iniiieu
de iâ jambe, eft nommée Queue de rat on A j été;
la Dartre qui attaque le boulet, eft appellée
Mule traverjîne ; enfin celle qui a fon fiége à la
couronne, eft connue fous le nom de Teignes.
Quoique toutes ces malad es ne forment qu’une
feulé & même efpèçe de Dartre, elles exigent
quelquefois un traitement particulier, à caufe
de là;-nature des» partit s léfées. Par exemplé ,
celles des jambes font bien plus difficiles à guérir
que les autres.'
" Lès Dartres fe perpétuent de race en race &
fe communiquent d’un animal à un animal, &
même, à ce qu’on affure, d’un animal à un
homme. Il eft ben de prendre des précautions,
quand on (oigne un animal dartreux.
On attribue les Dartres aux écuries humides
& 'malpropres , -à-la boue, des rues, aux travaux
exceffiis , par ticuliérenriehi en été, & à de.mau**
B